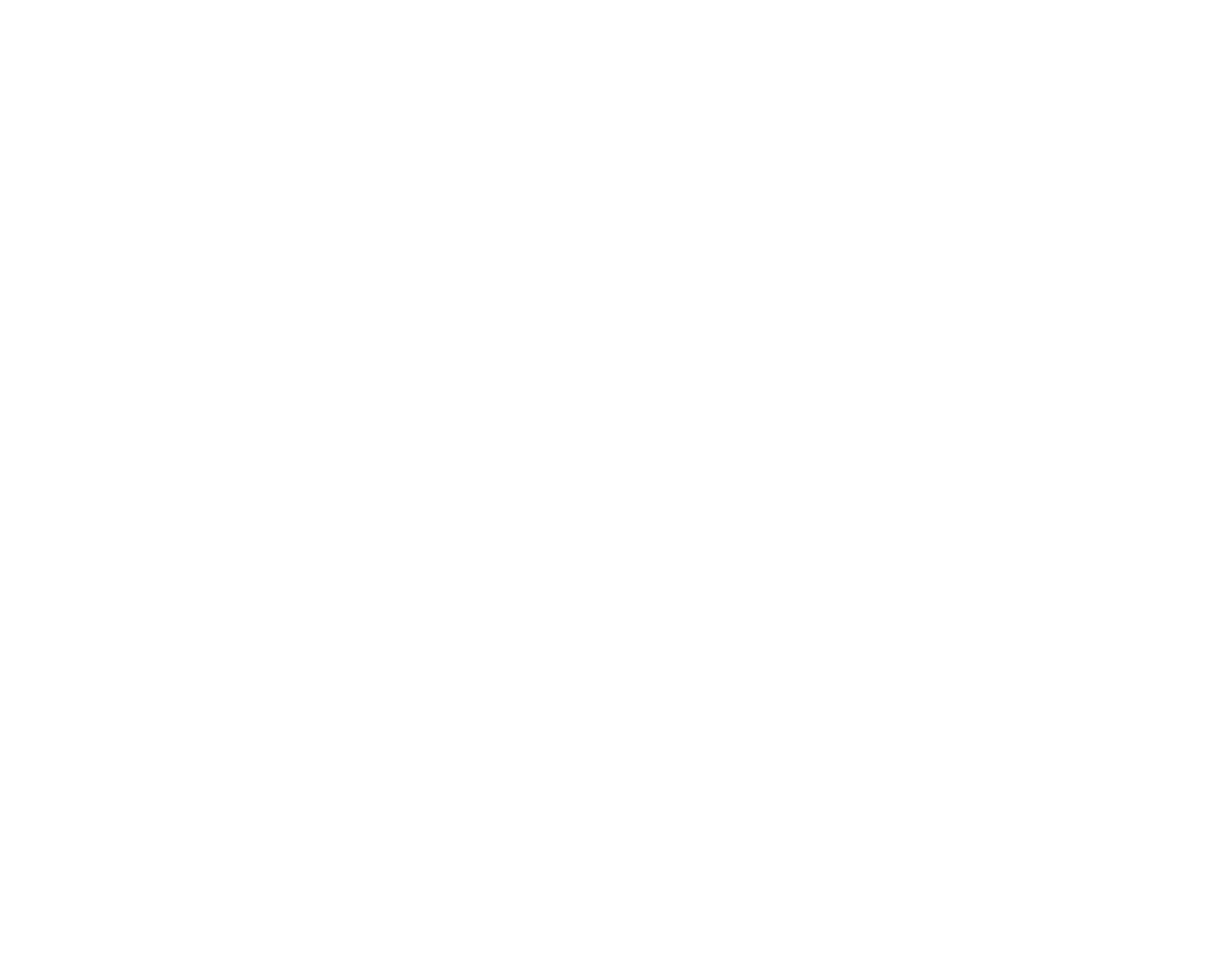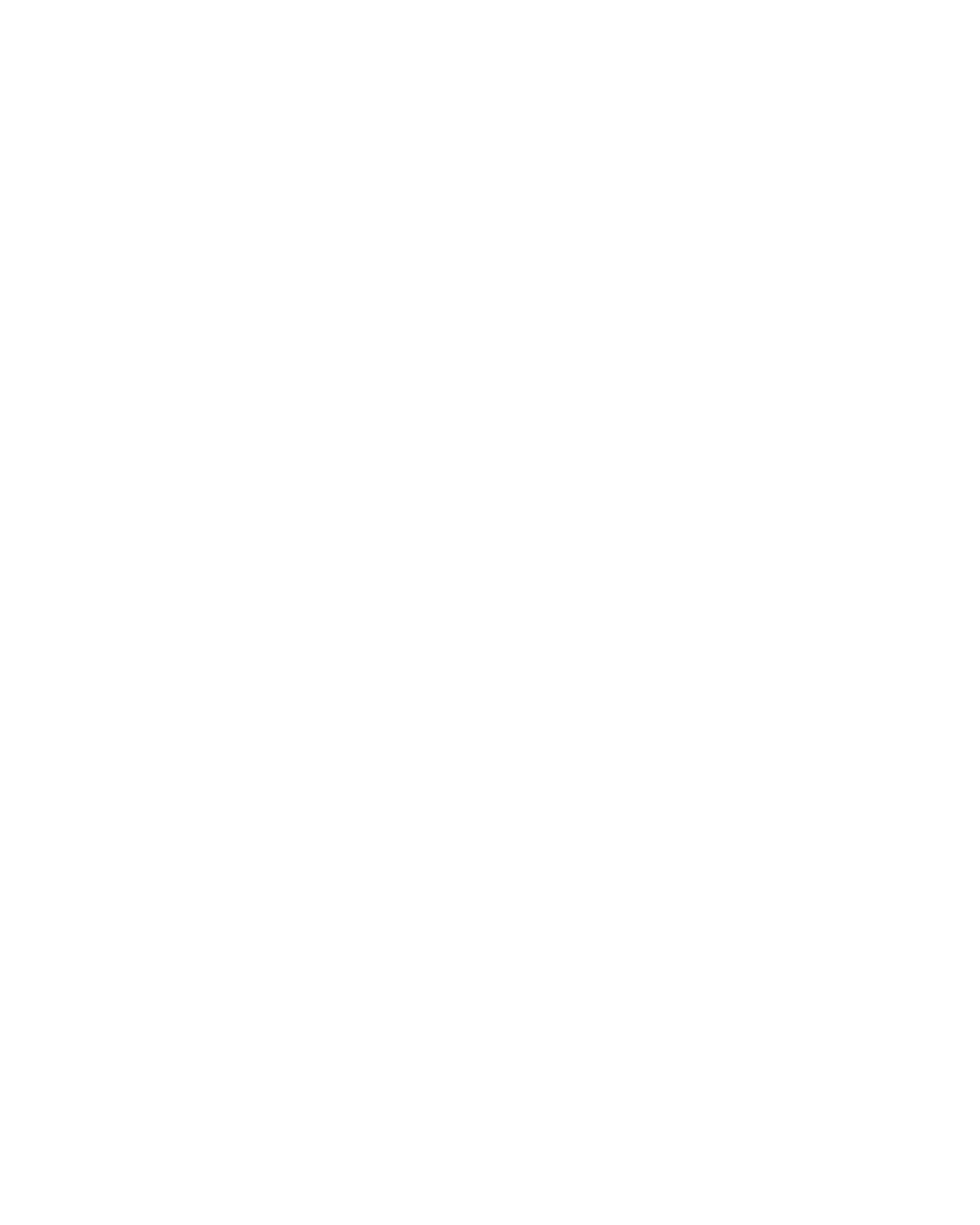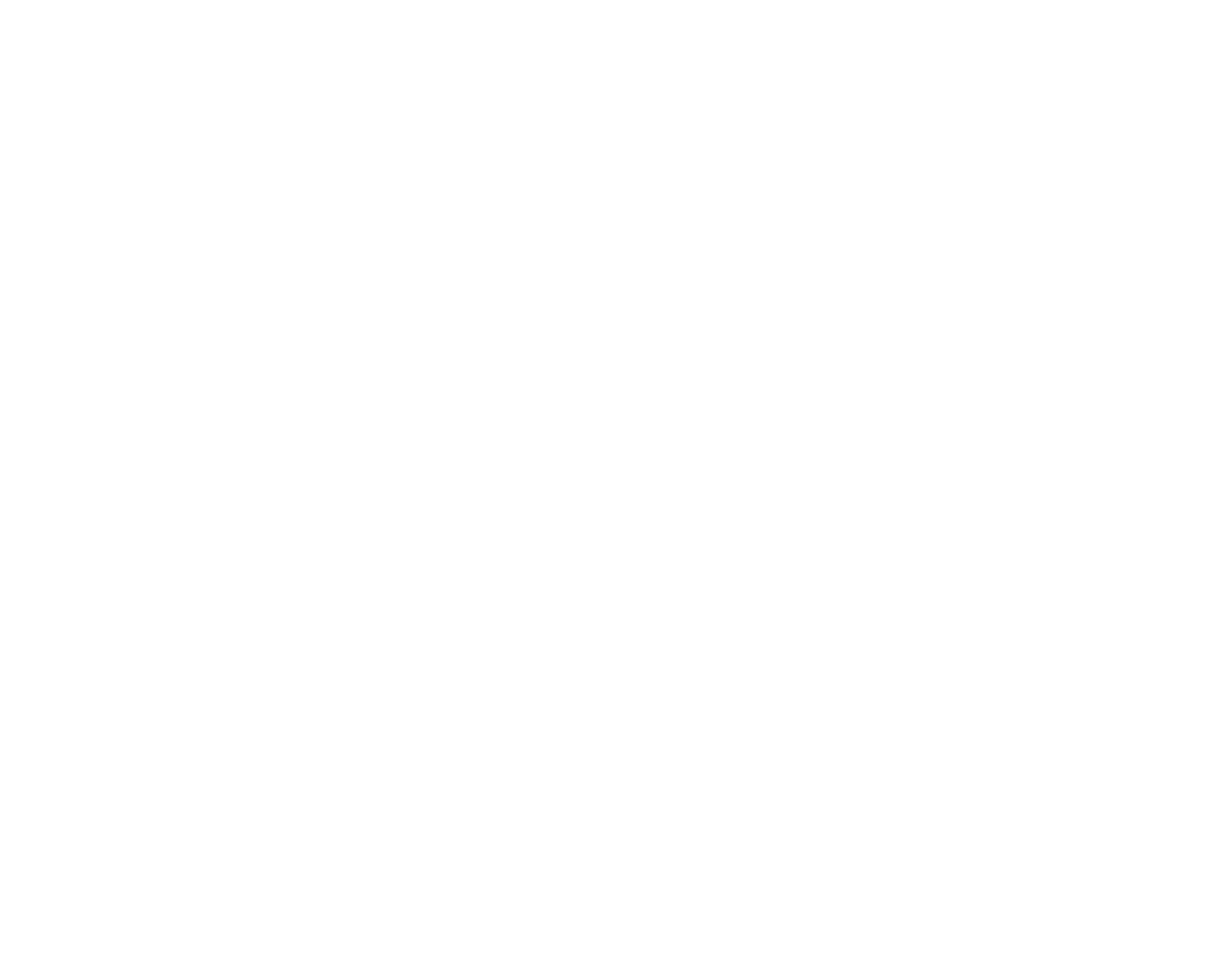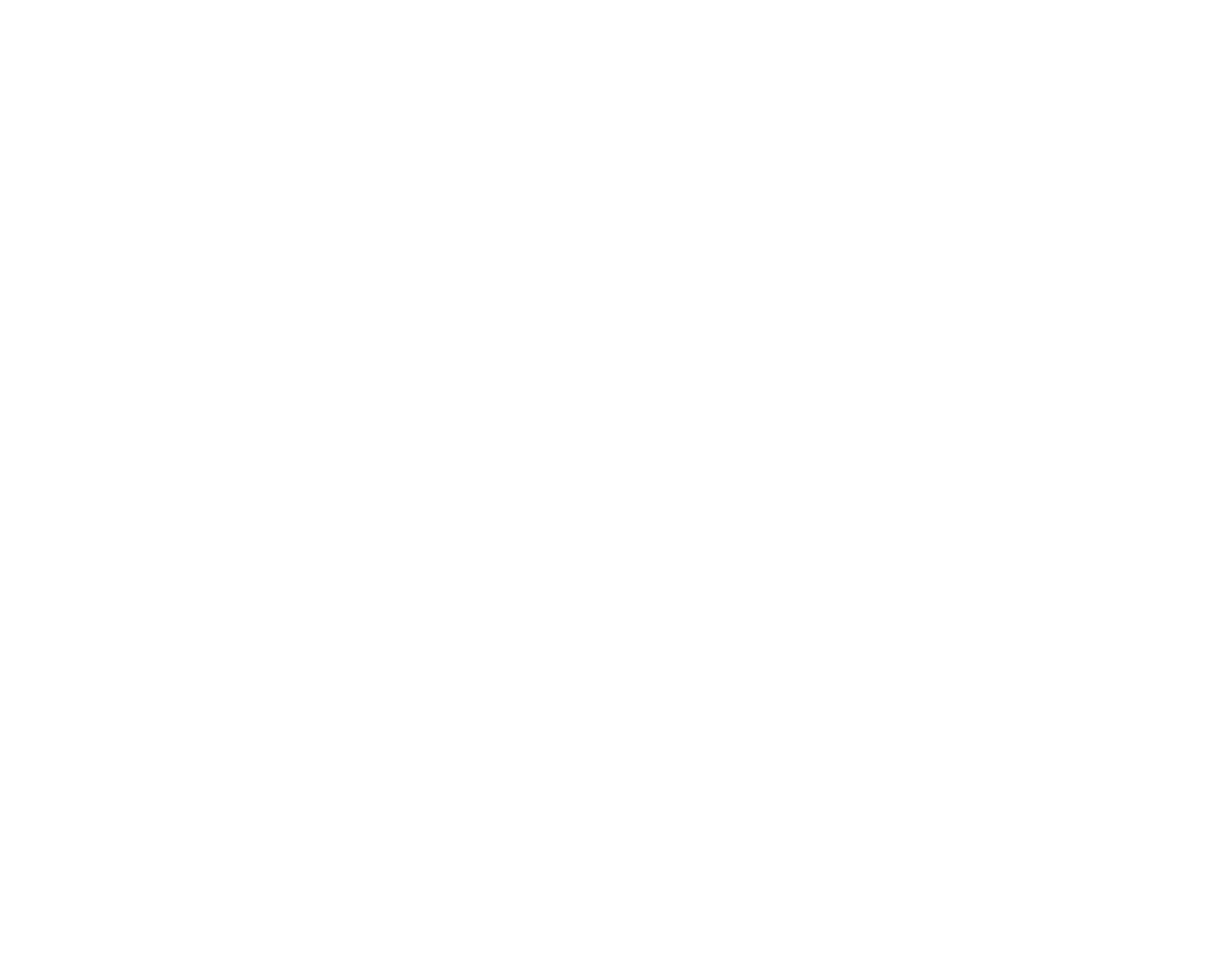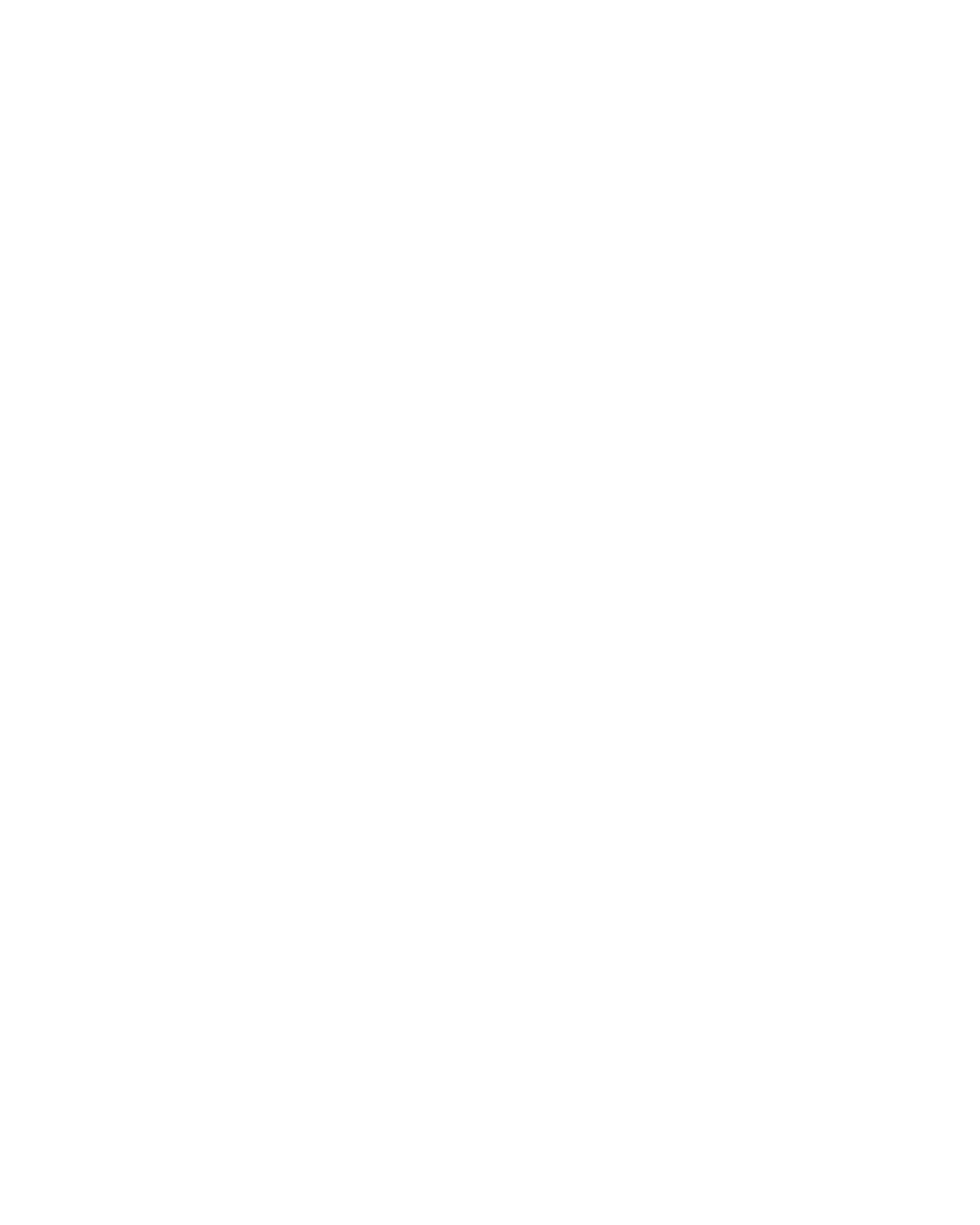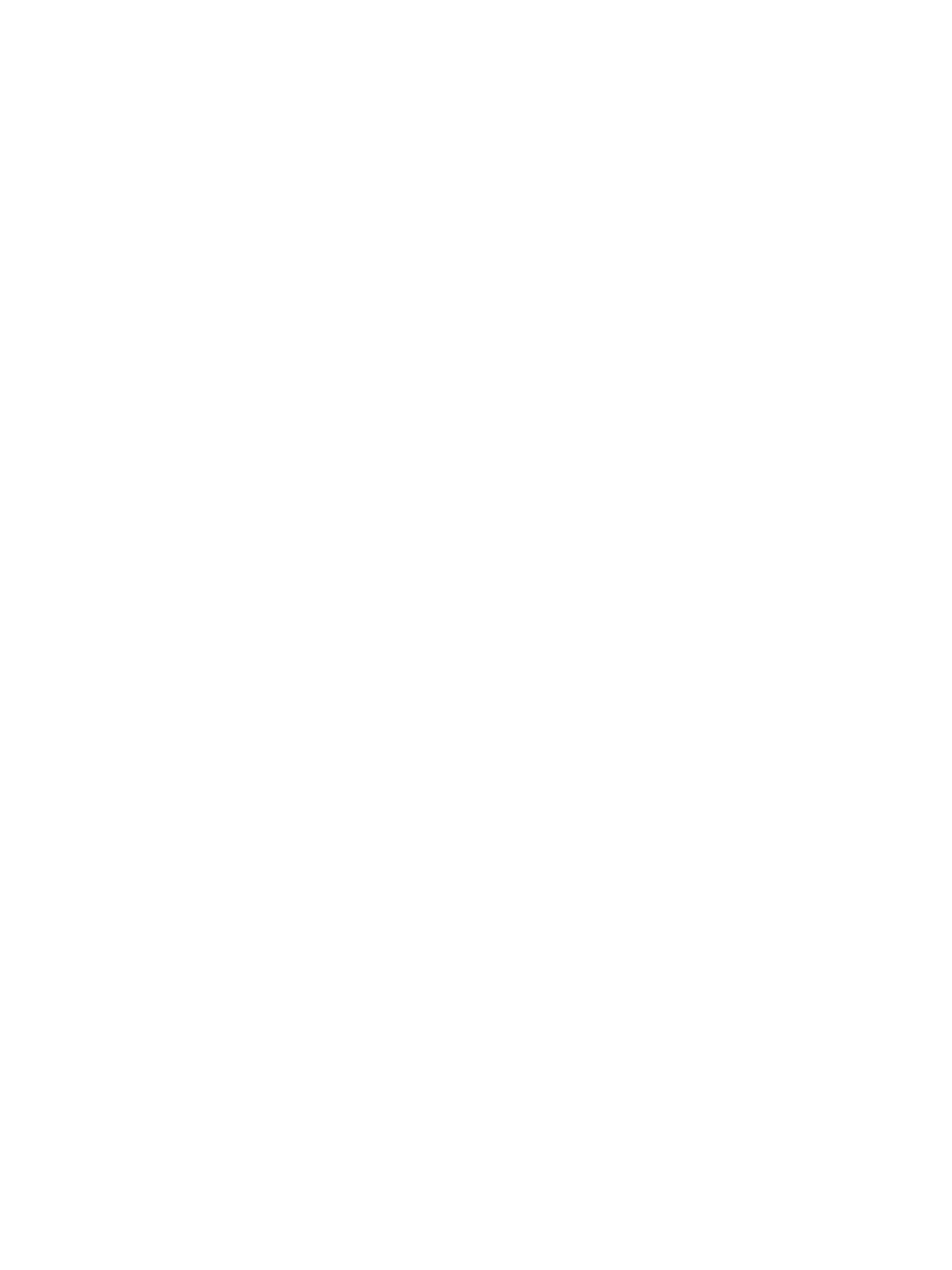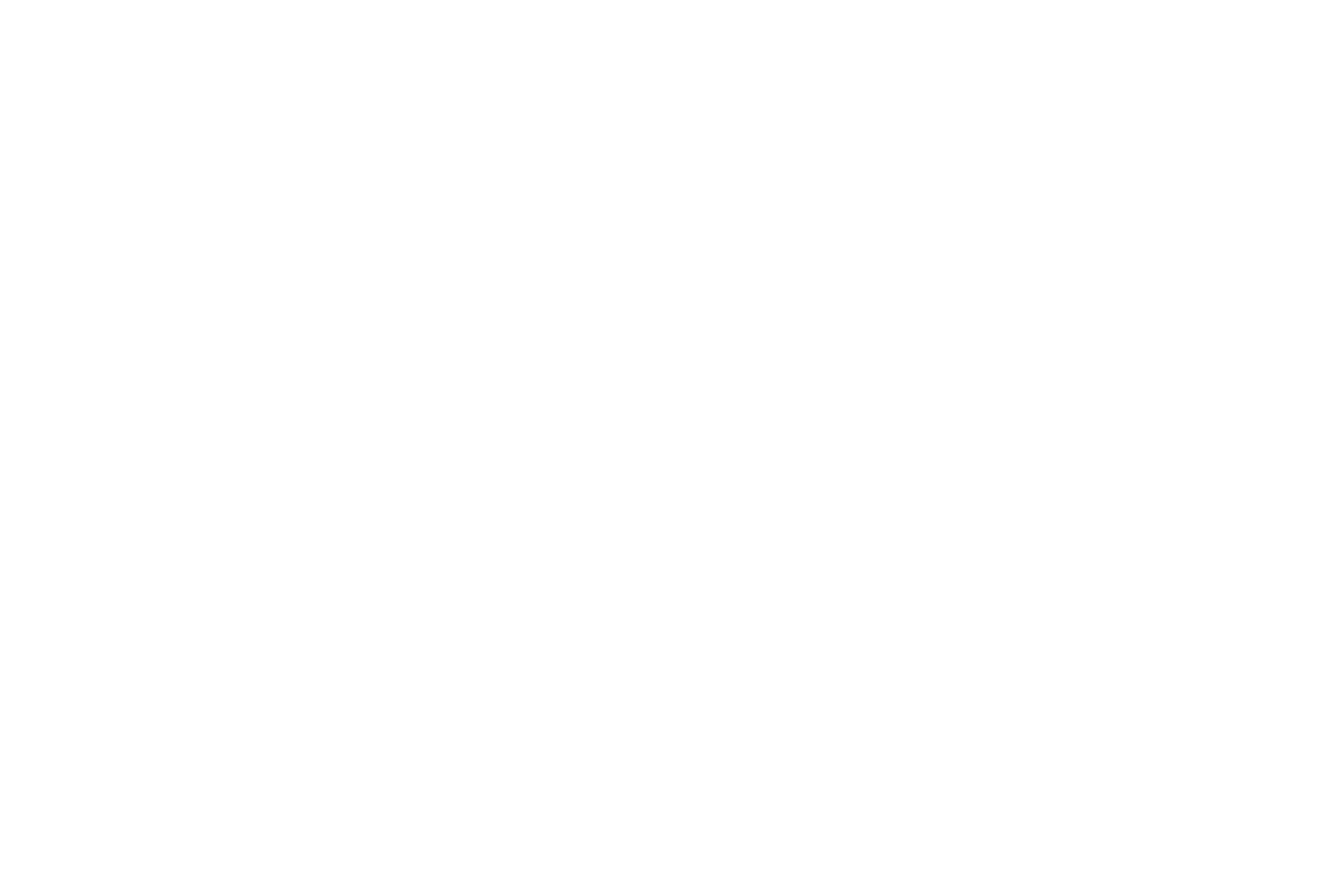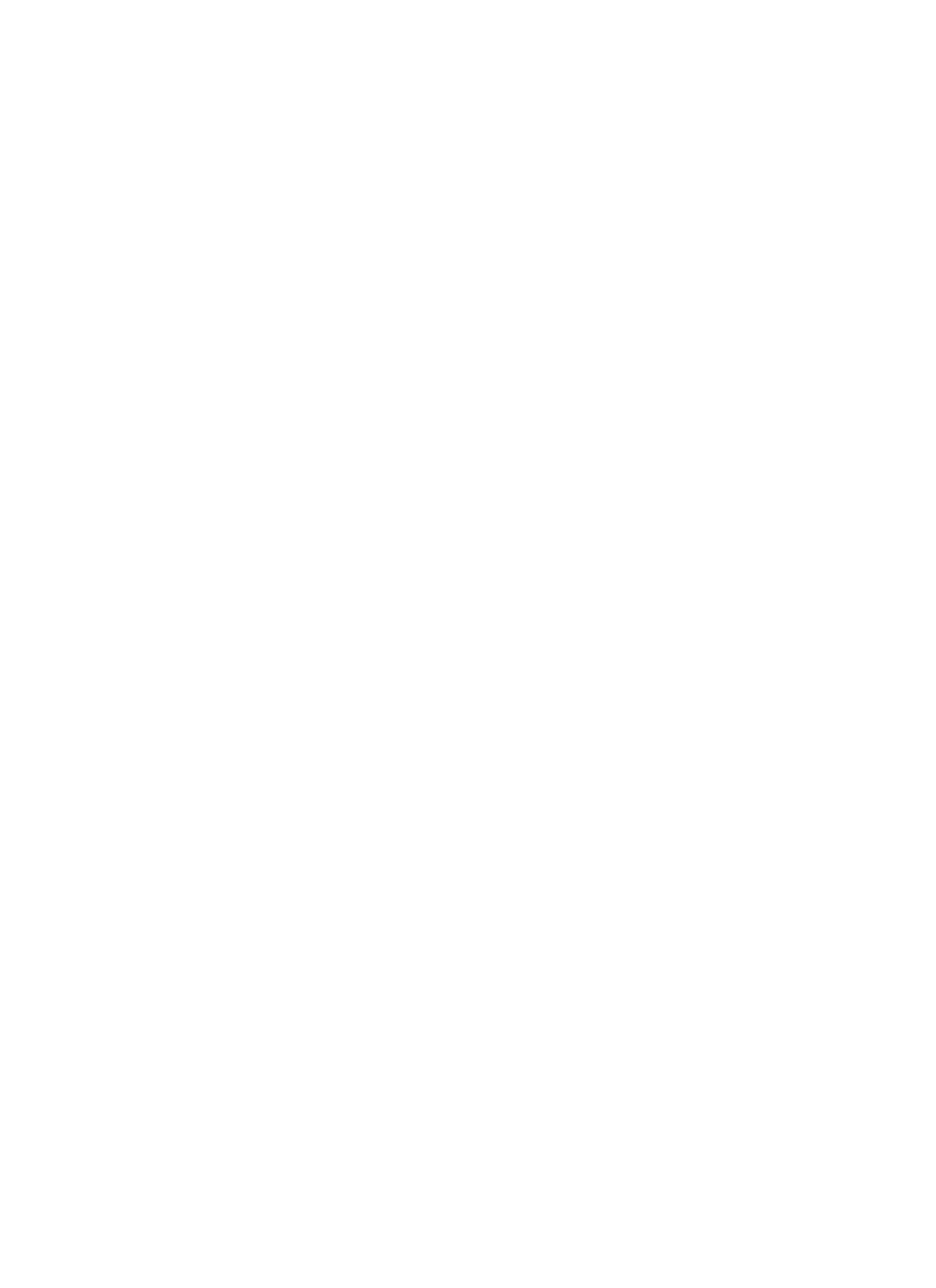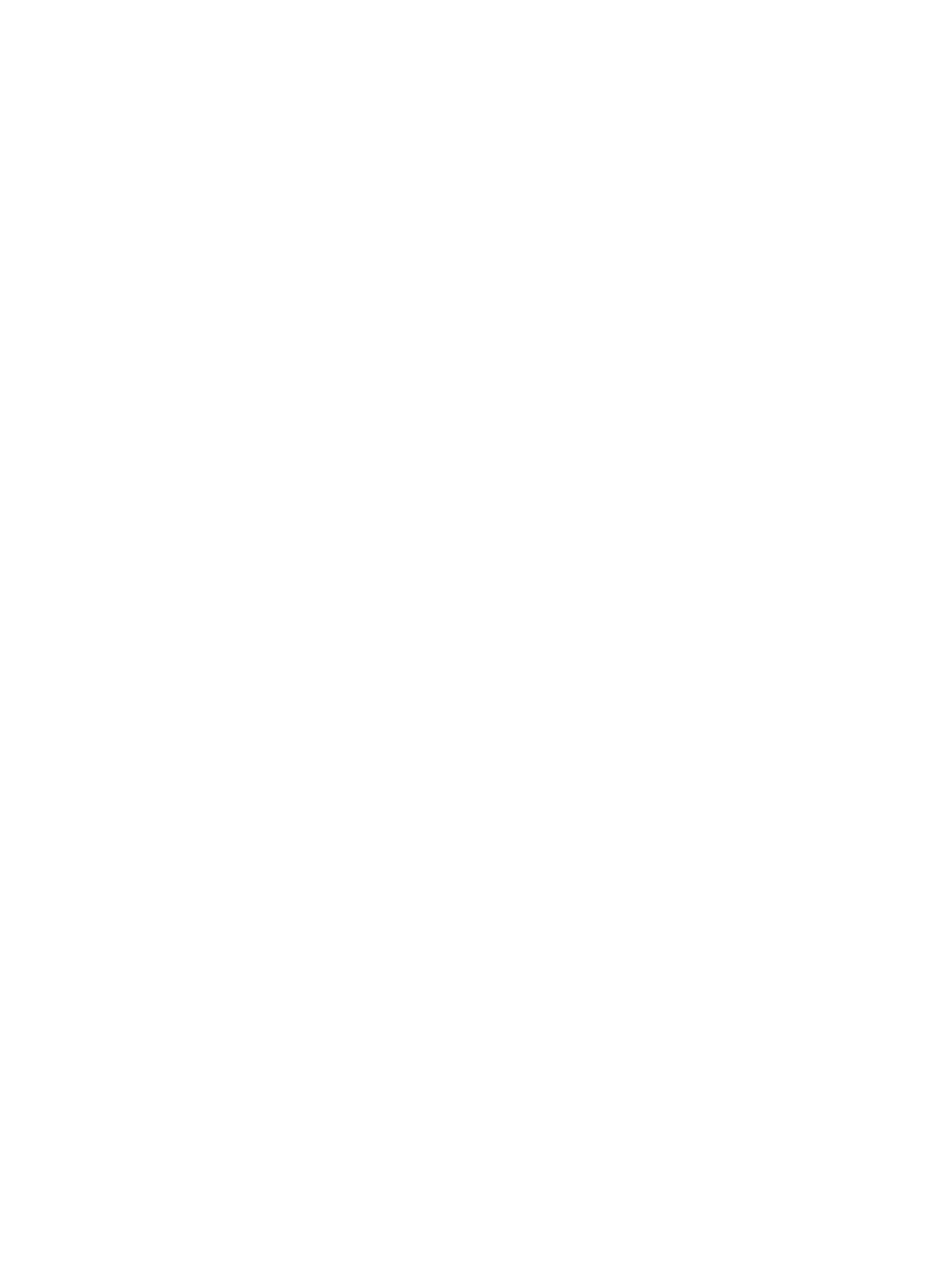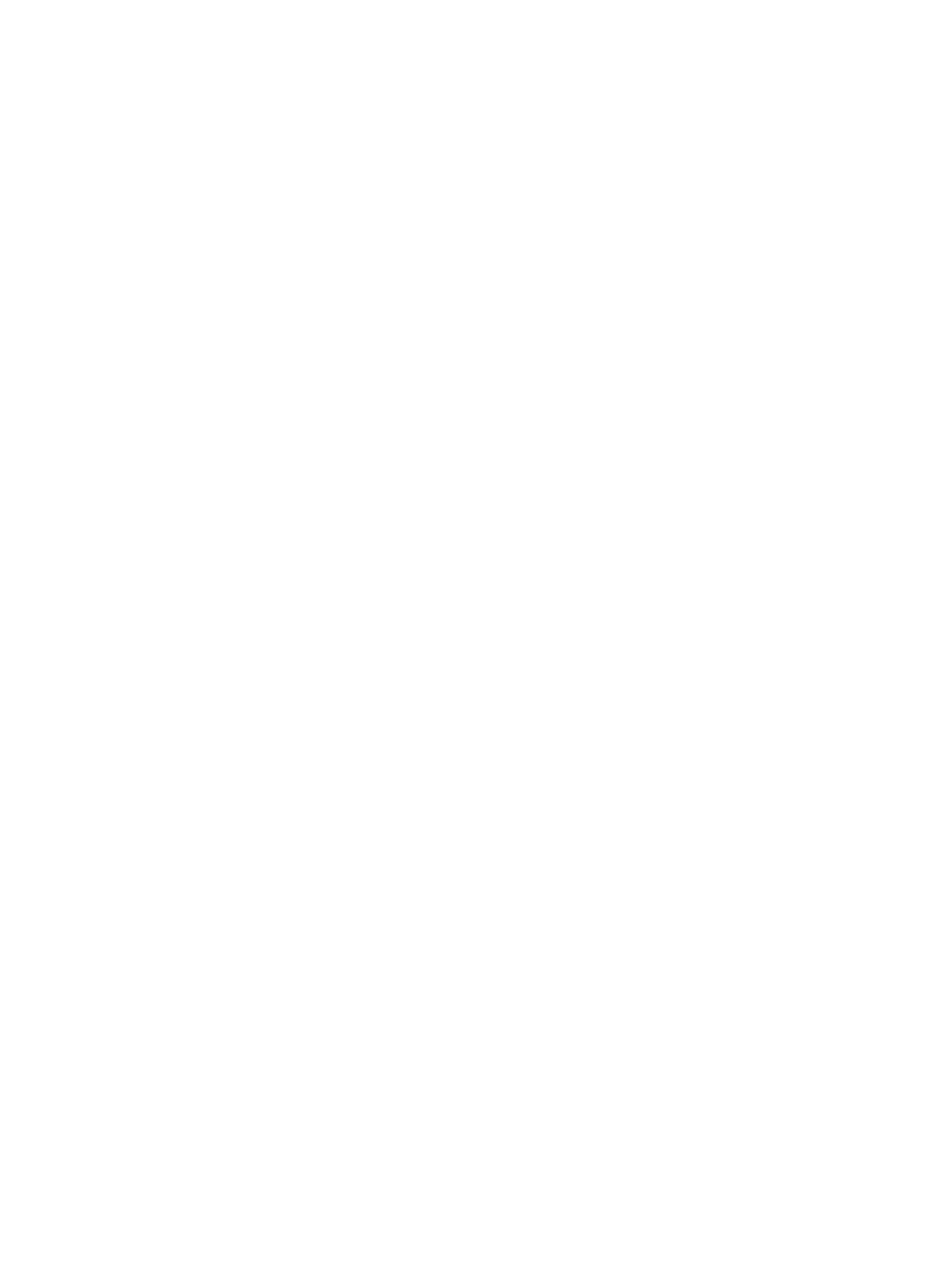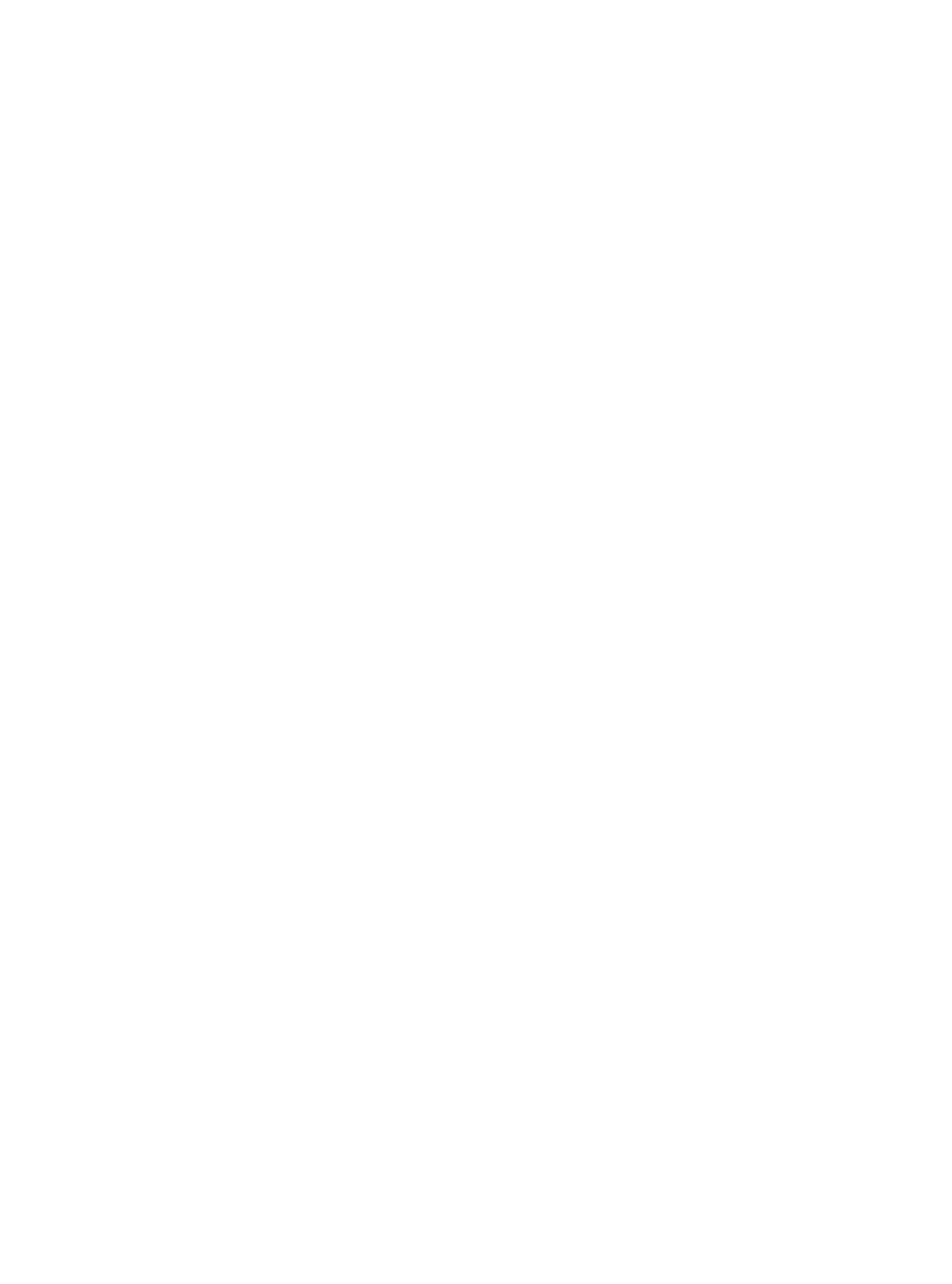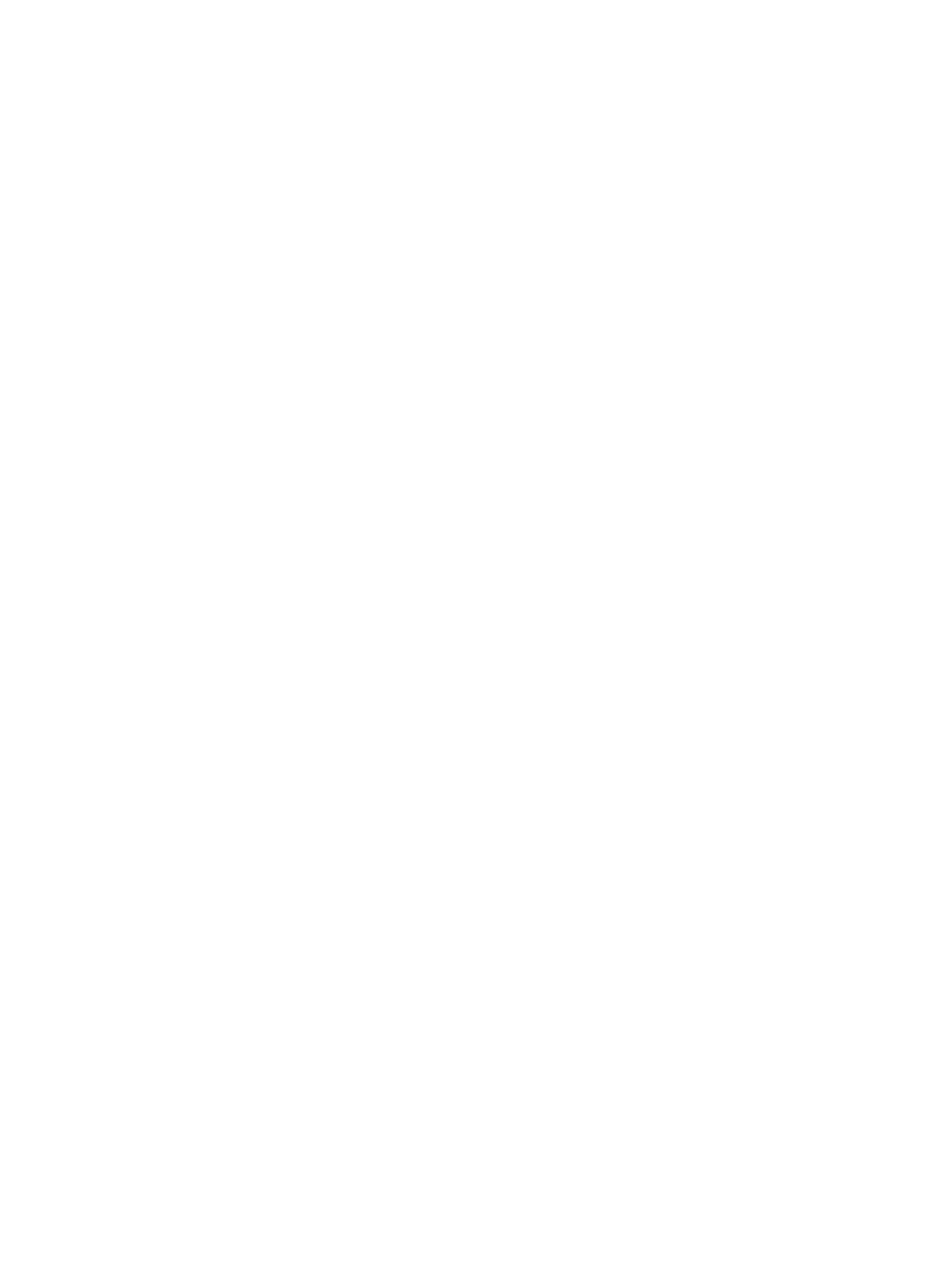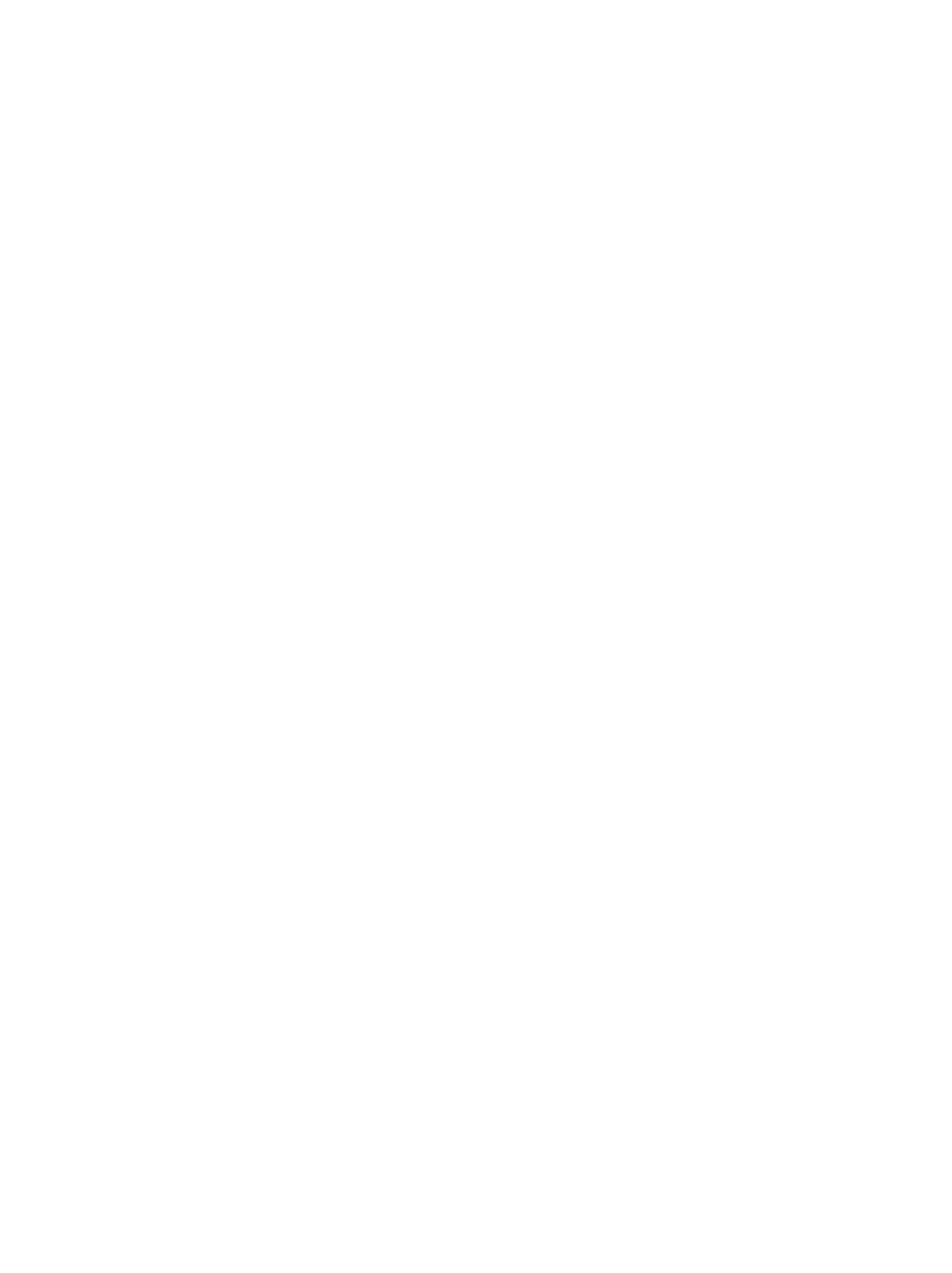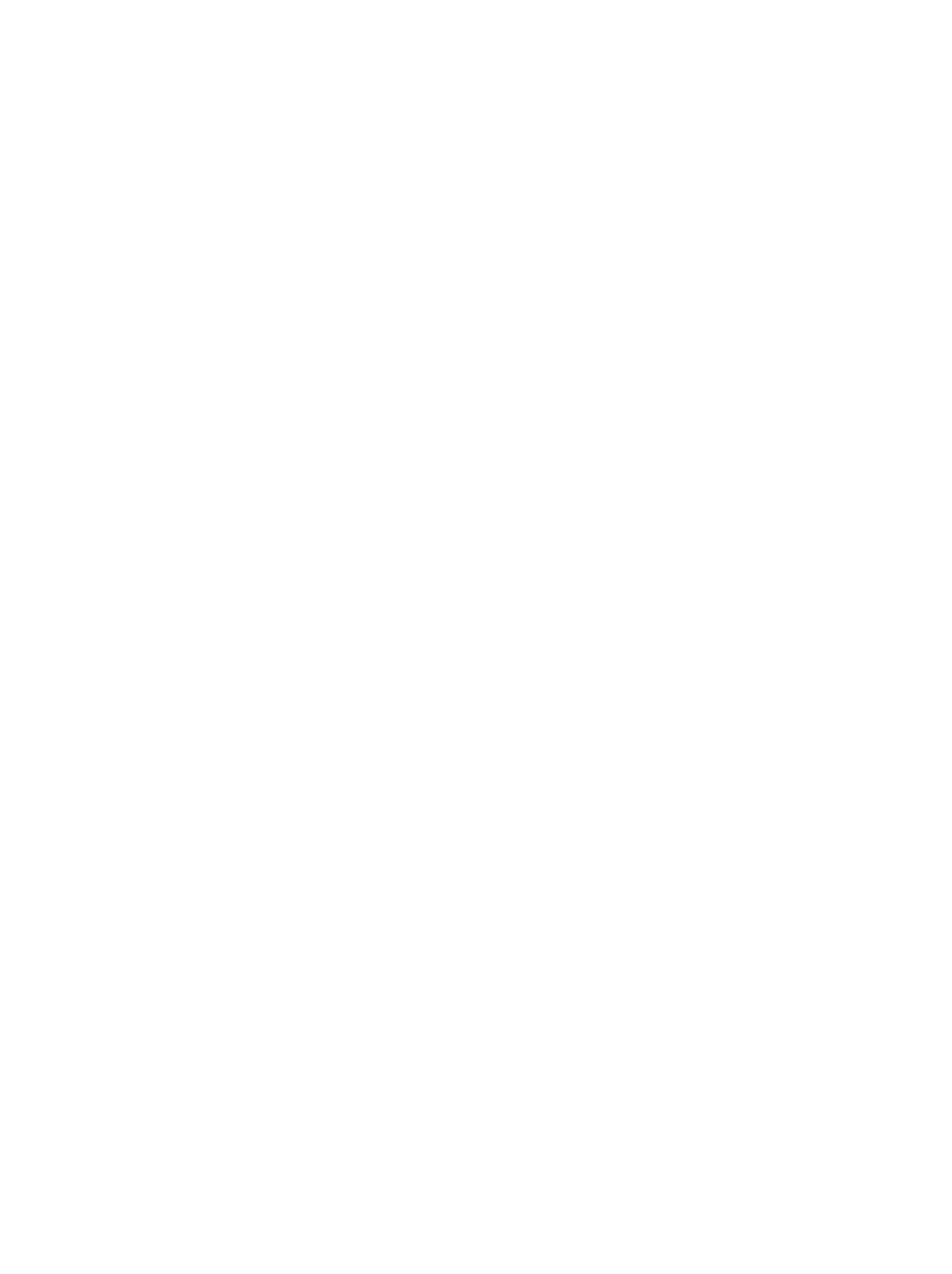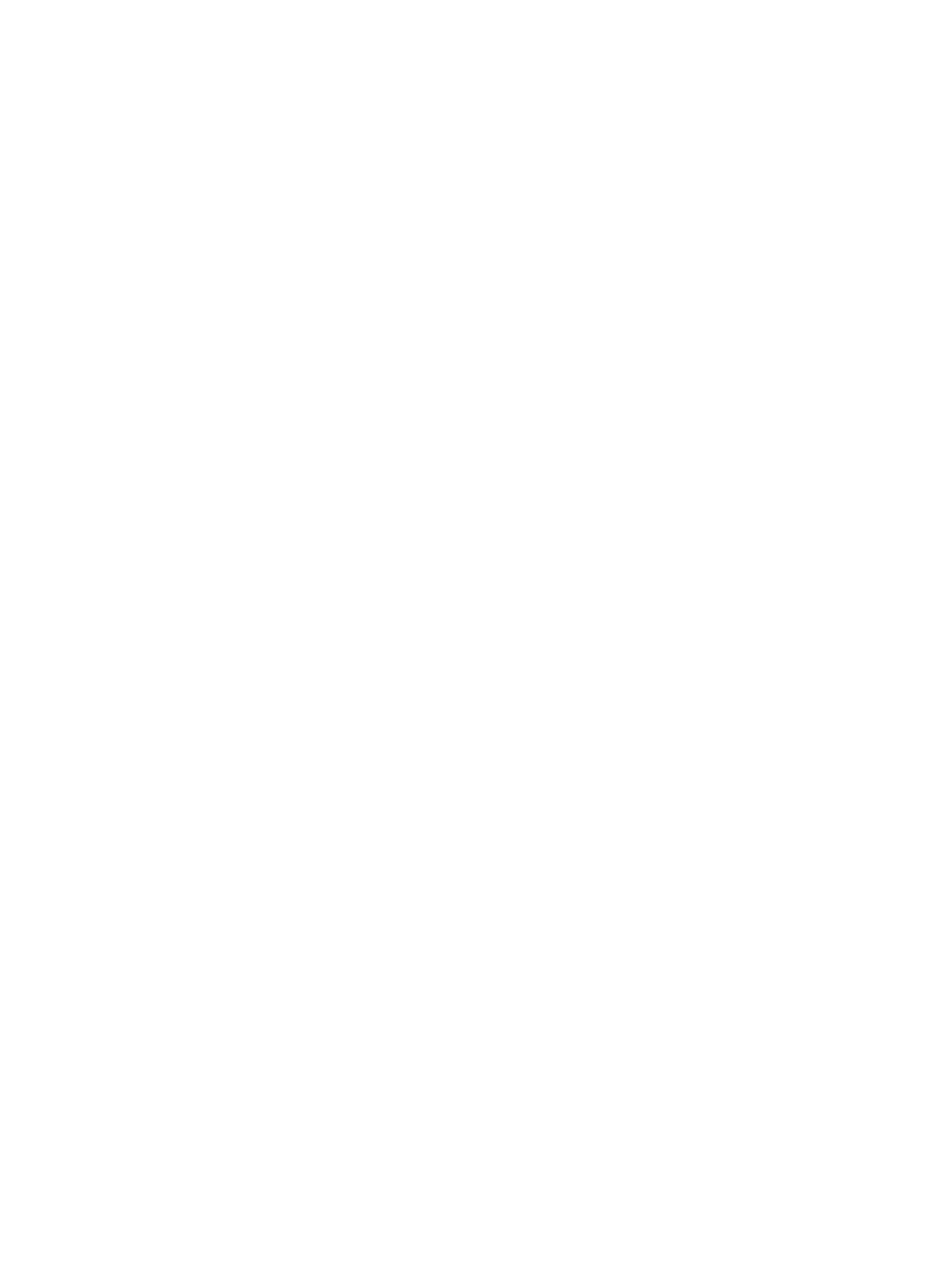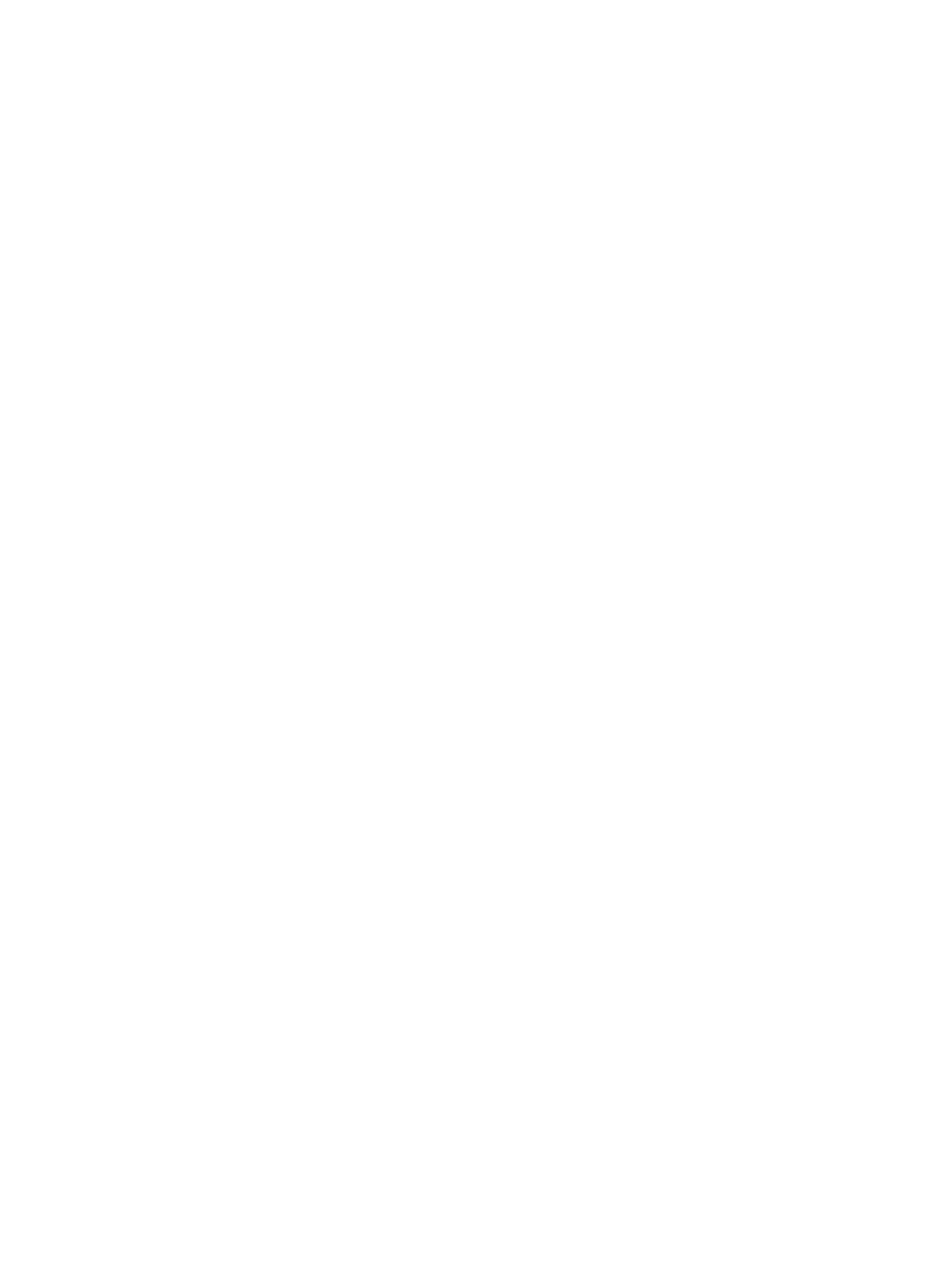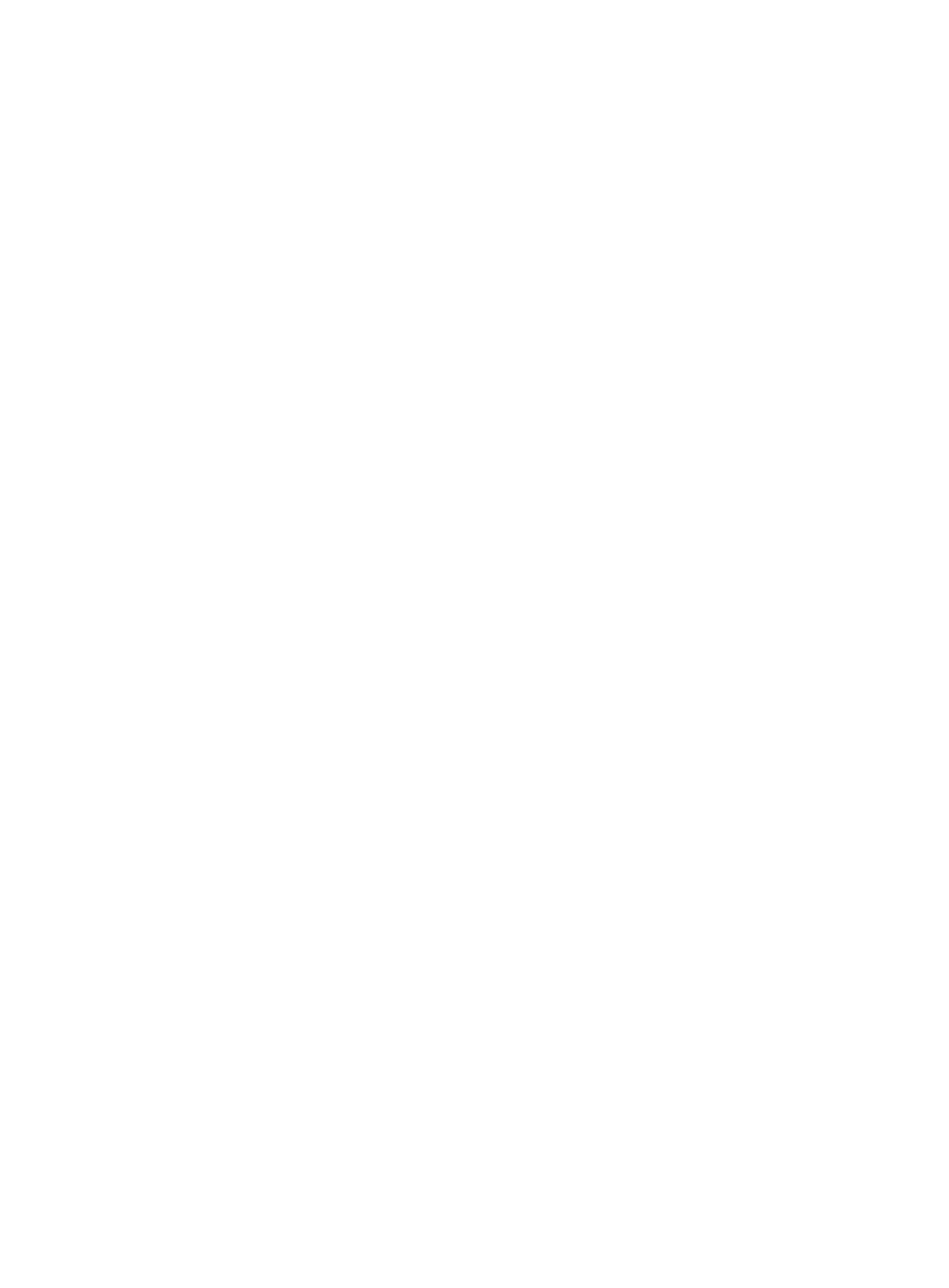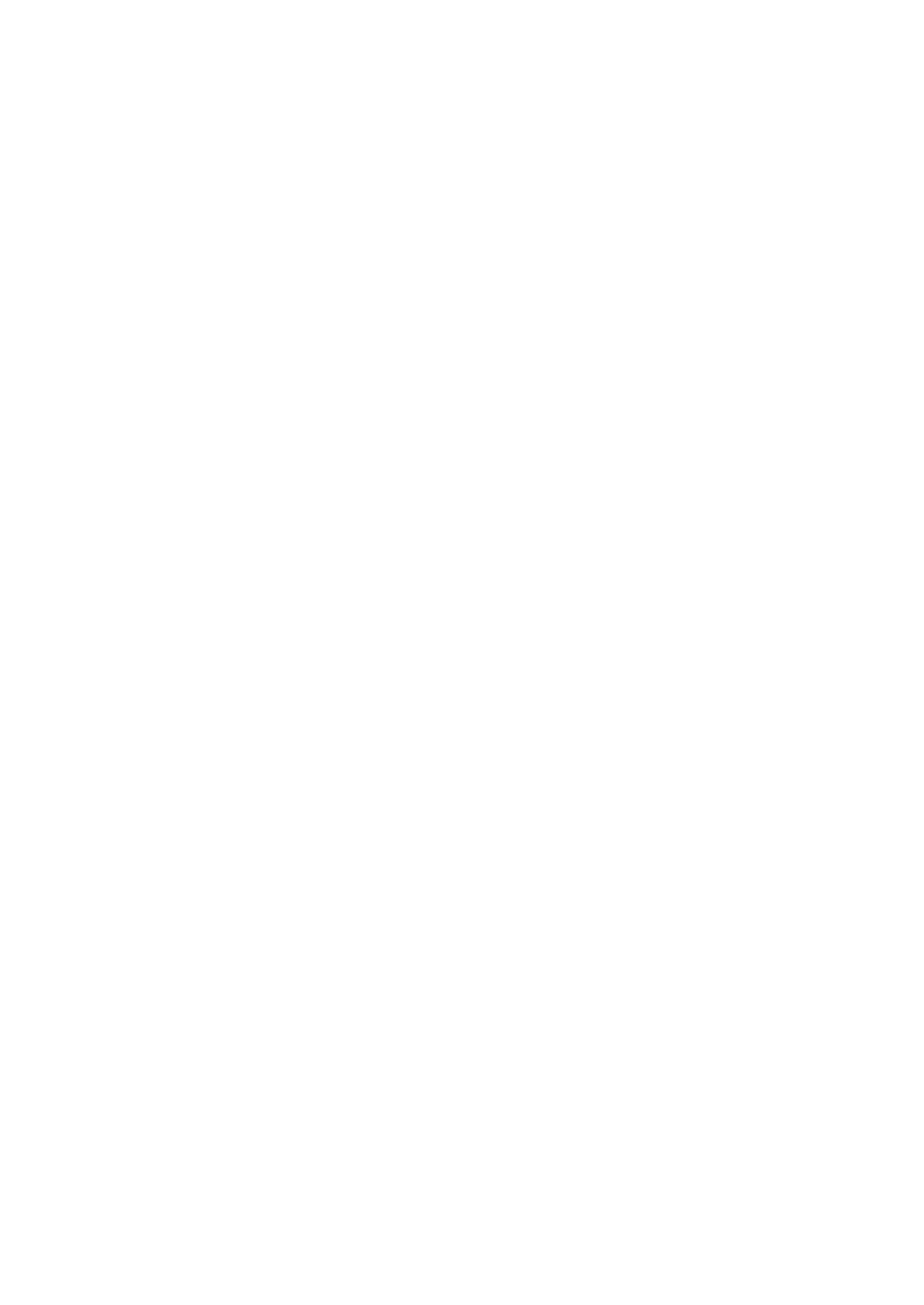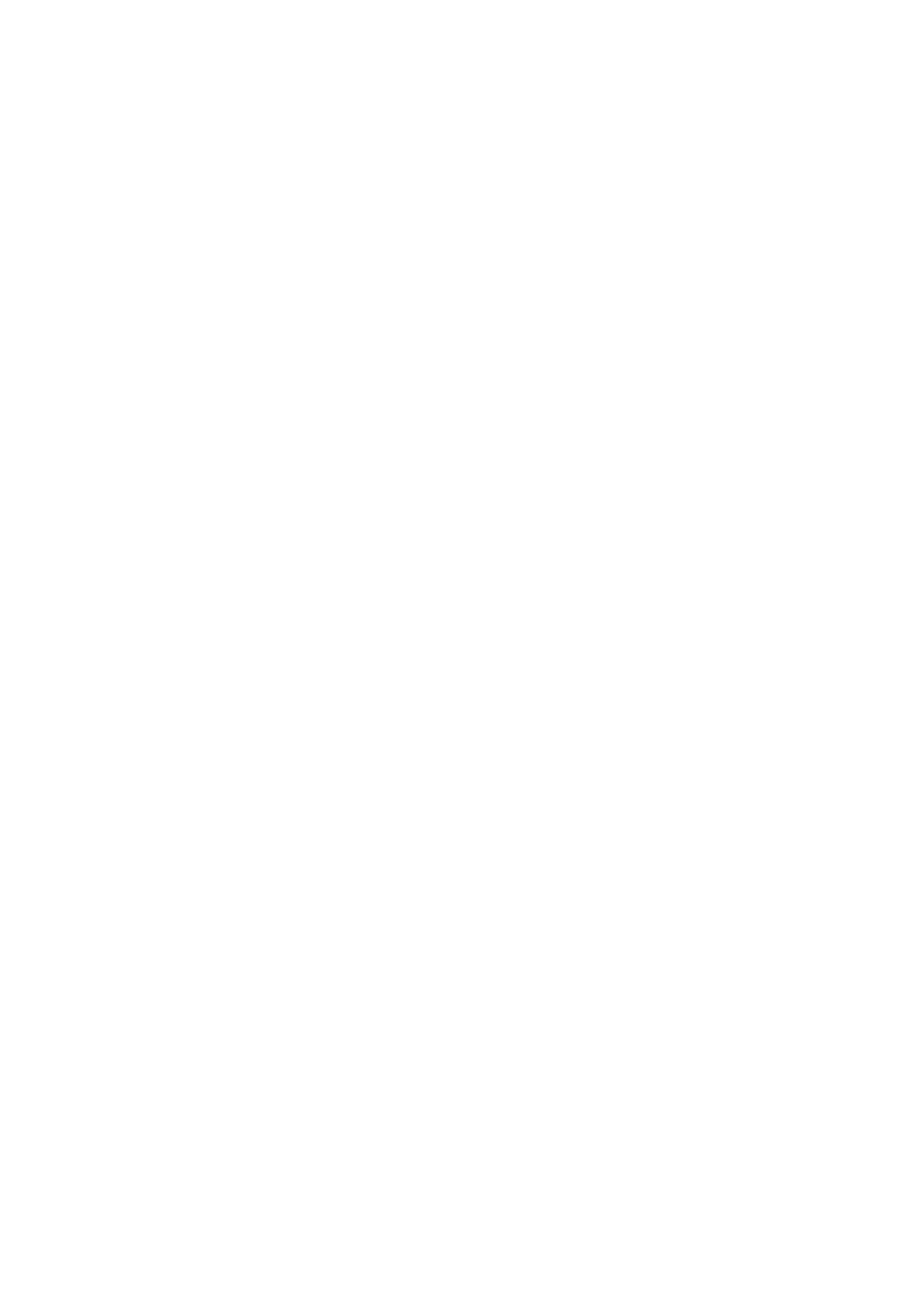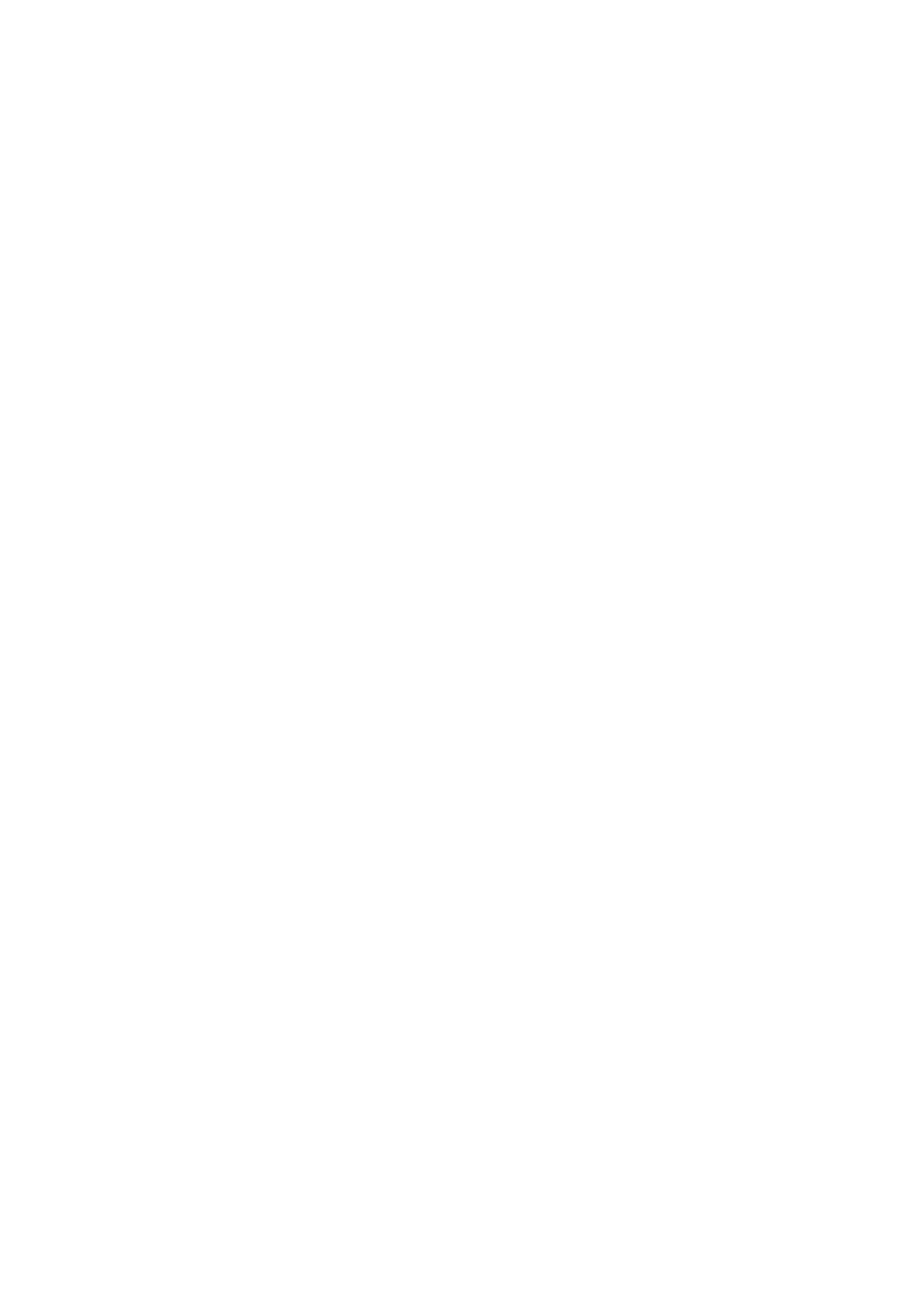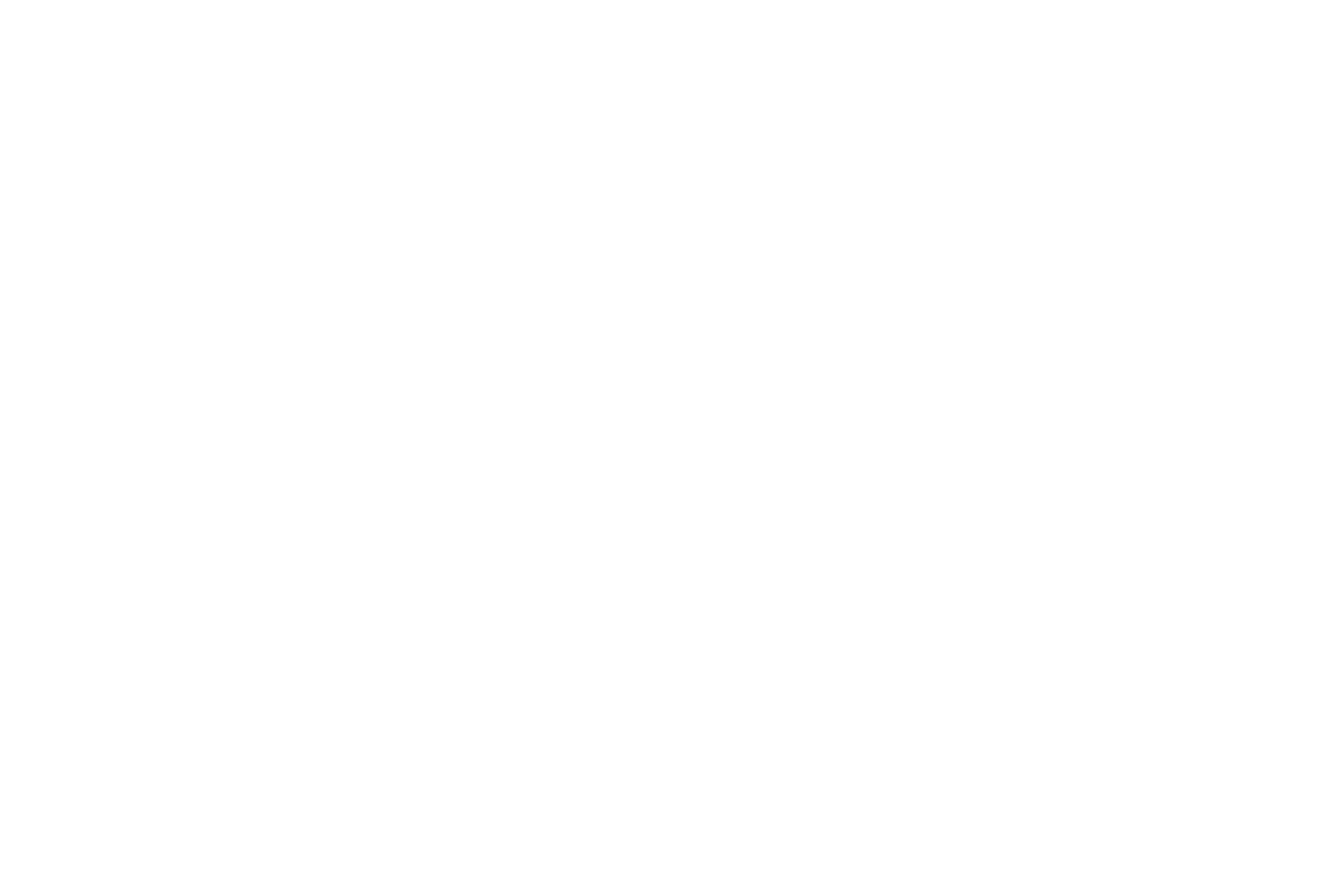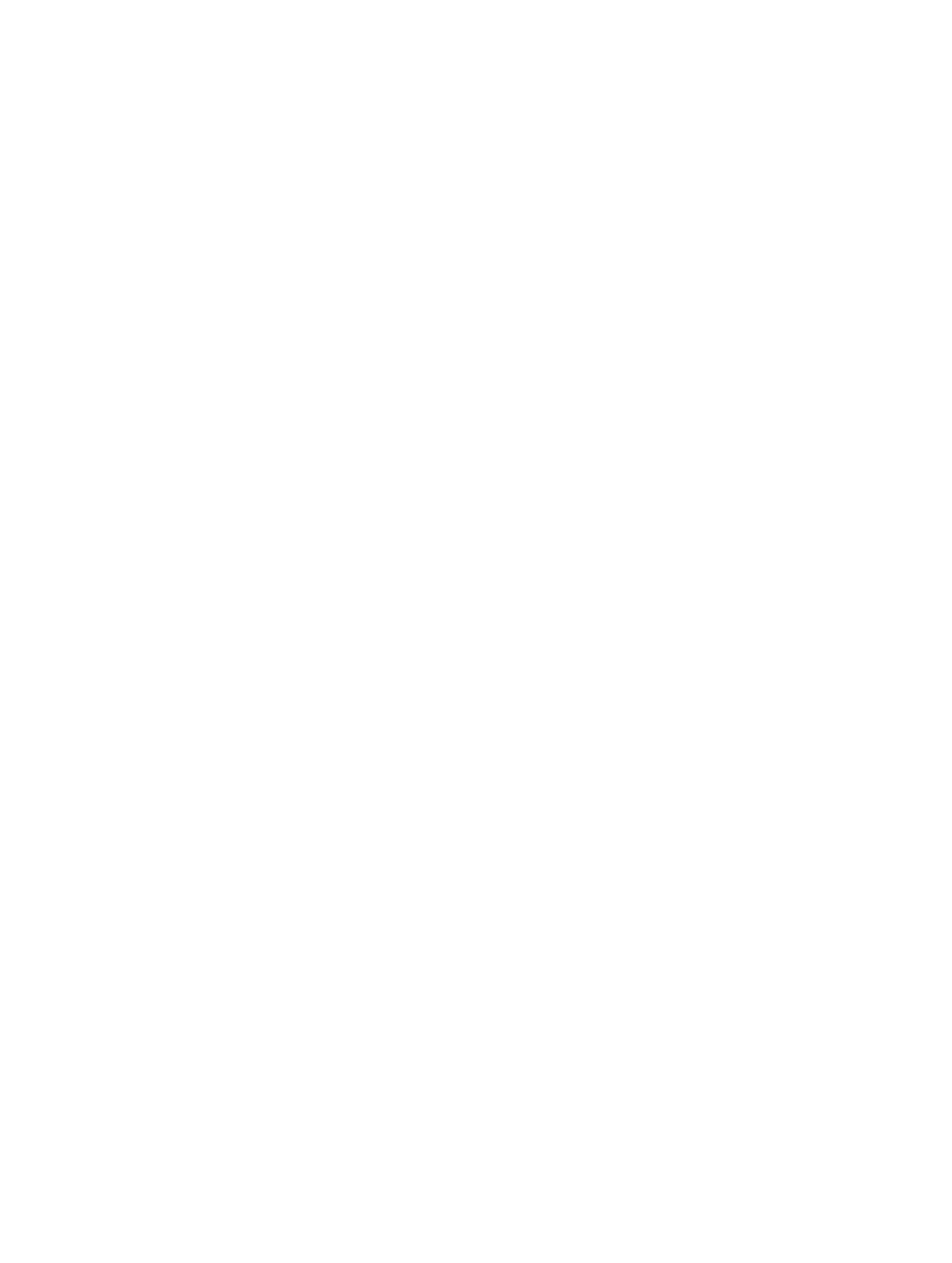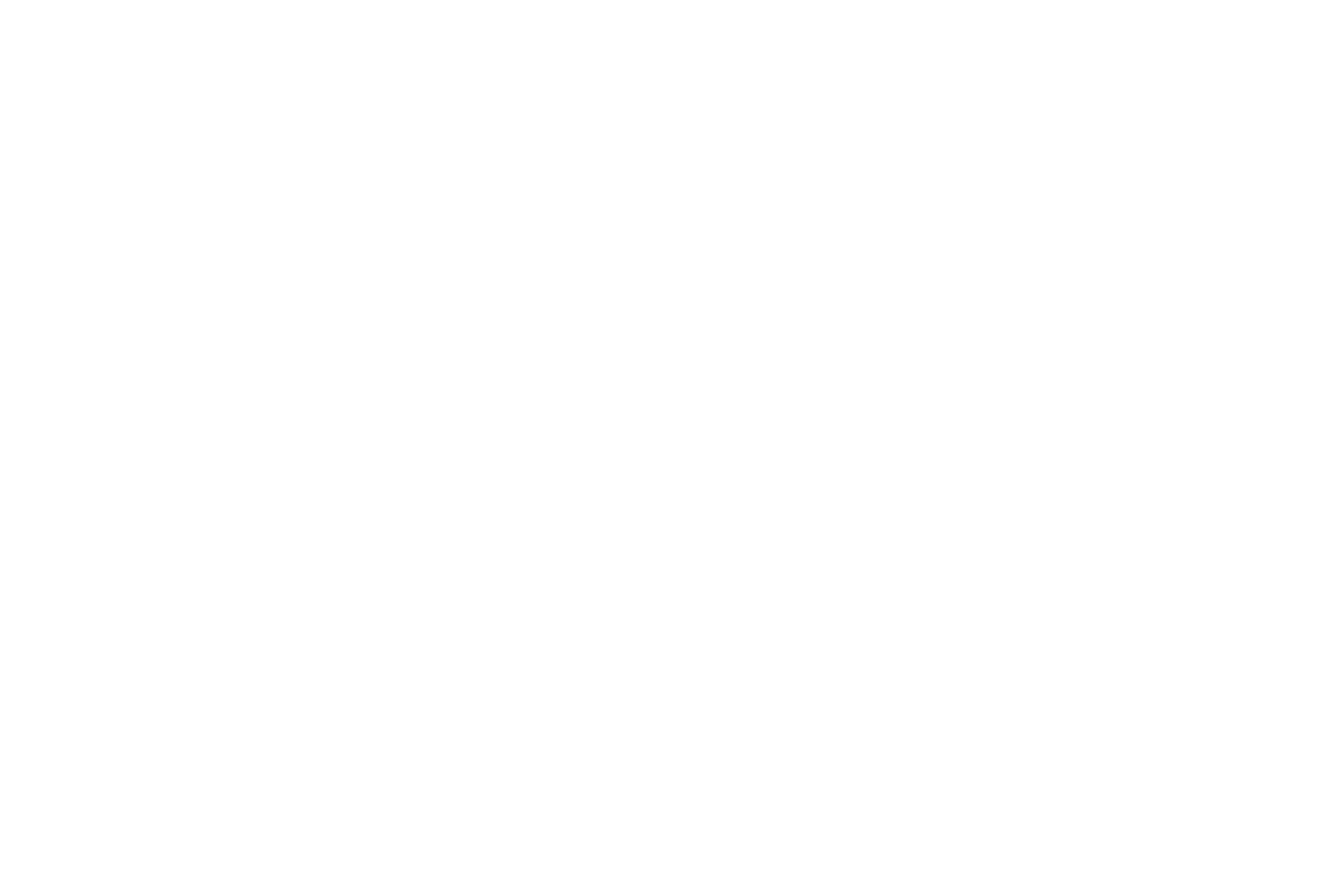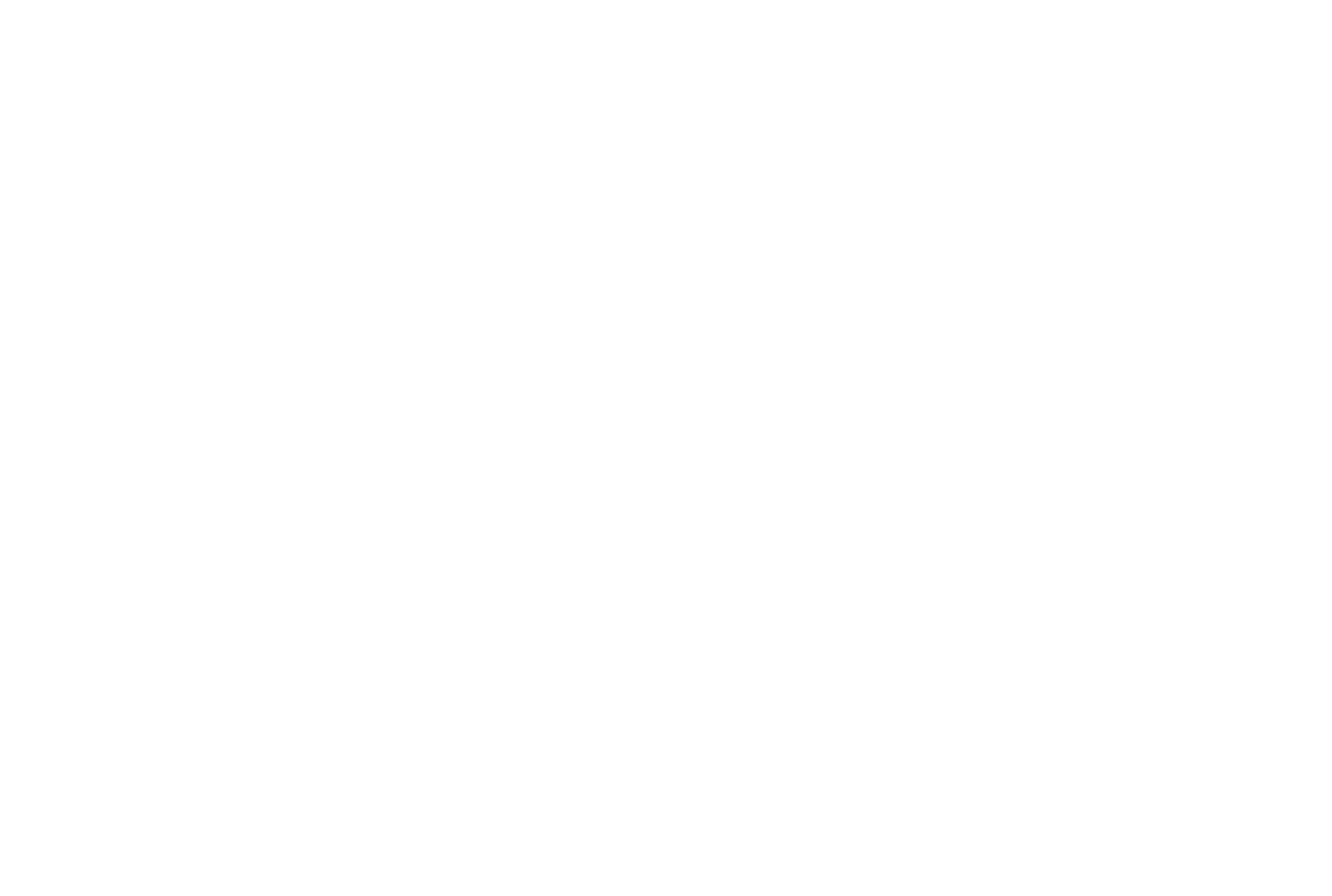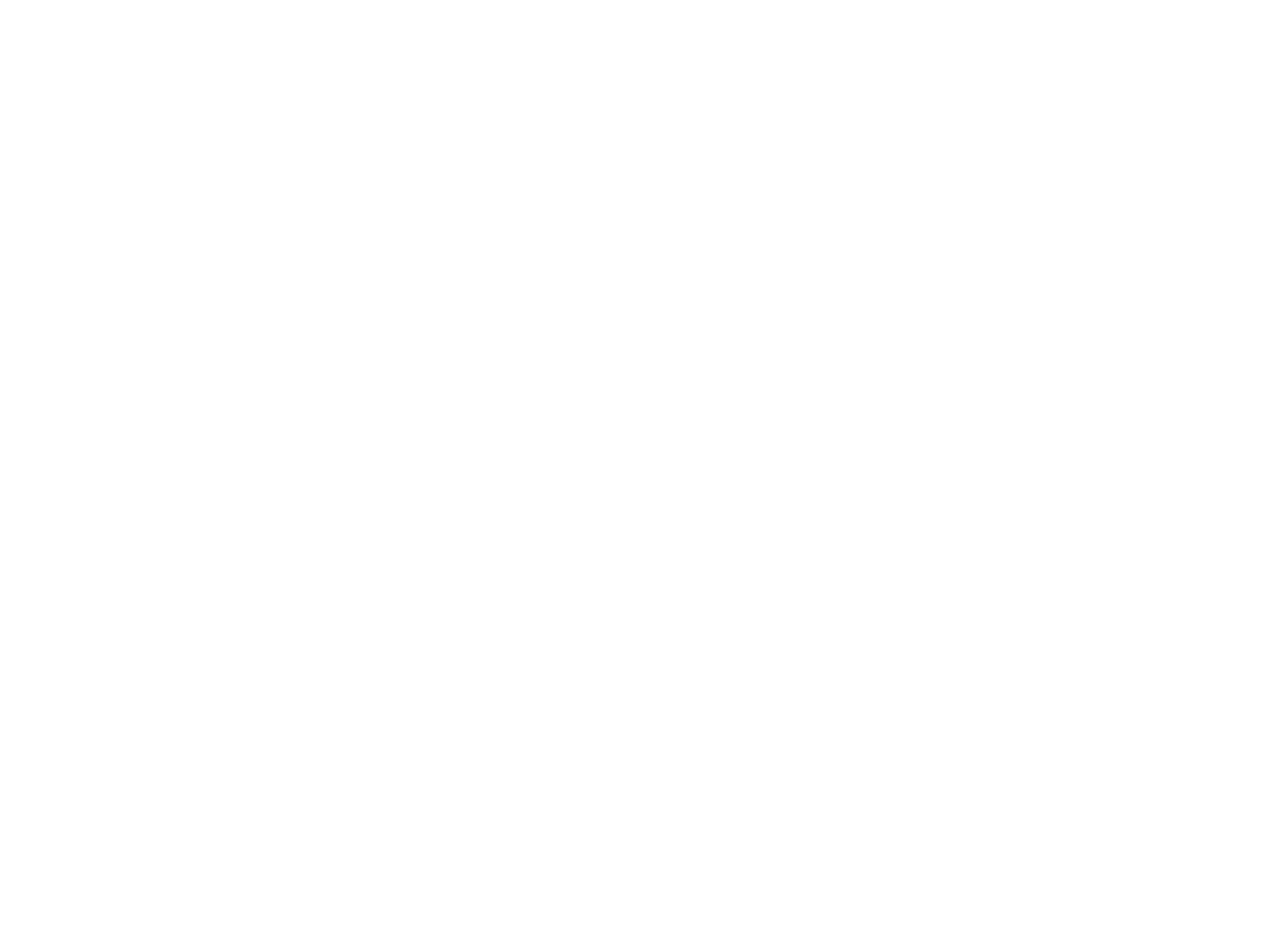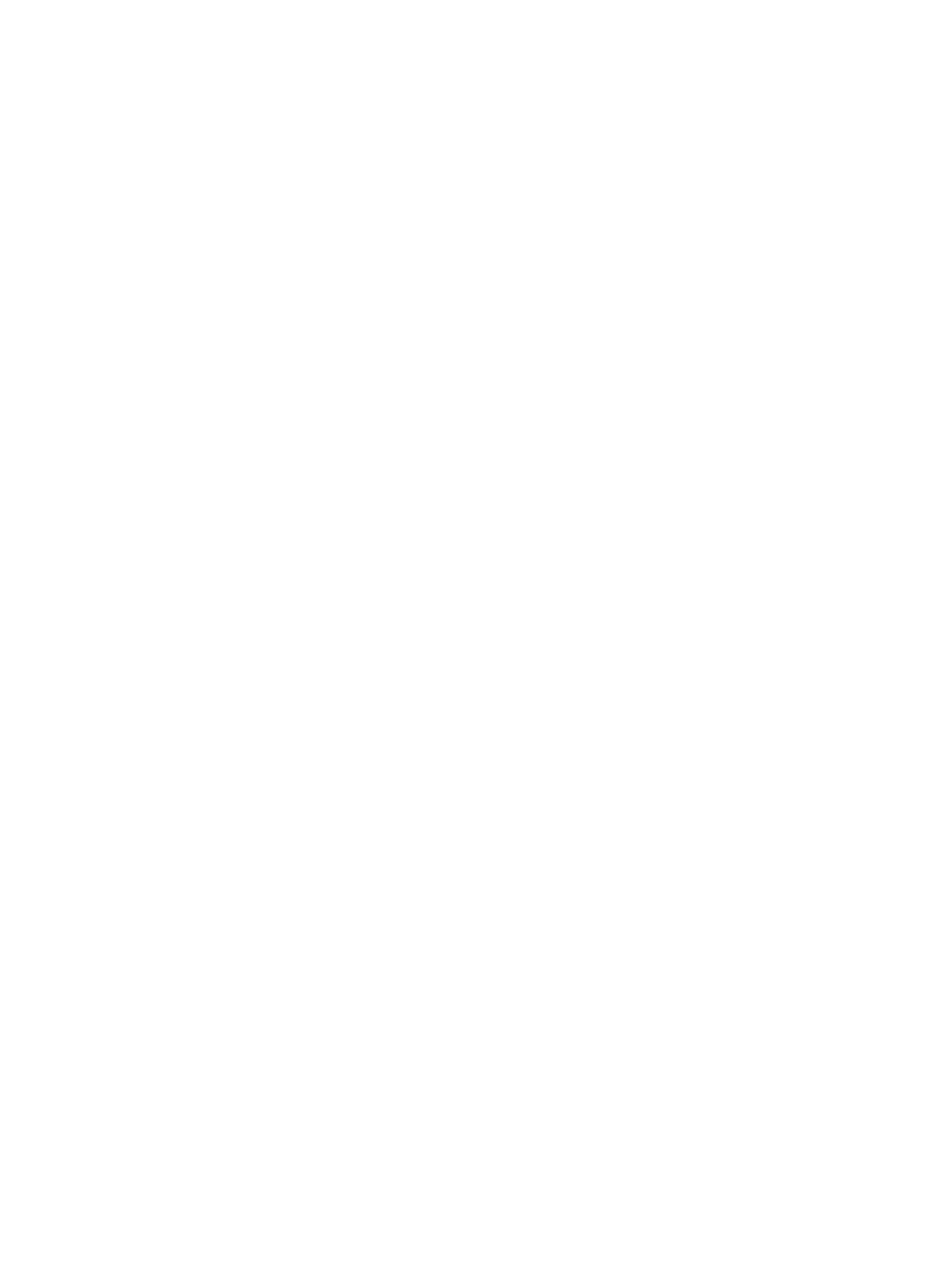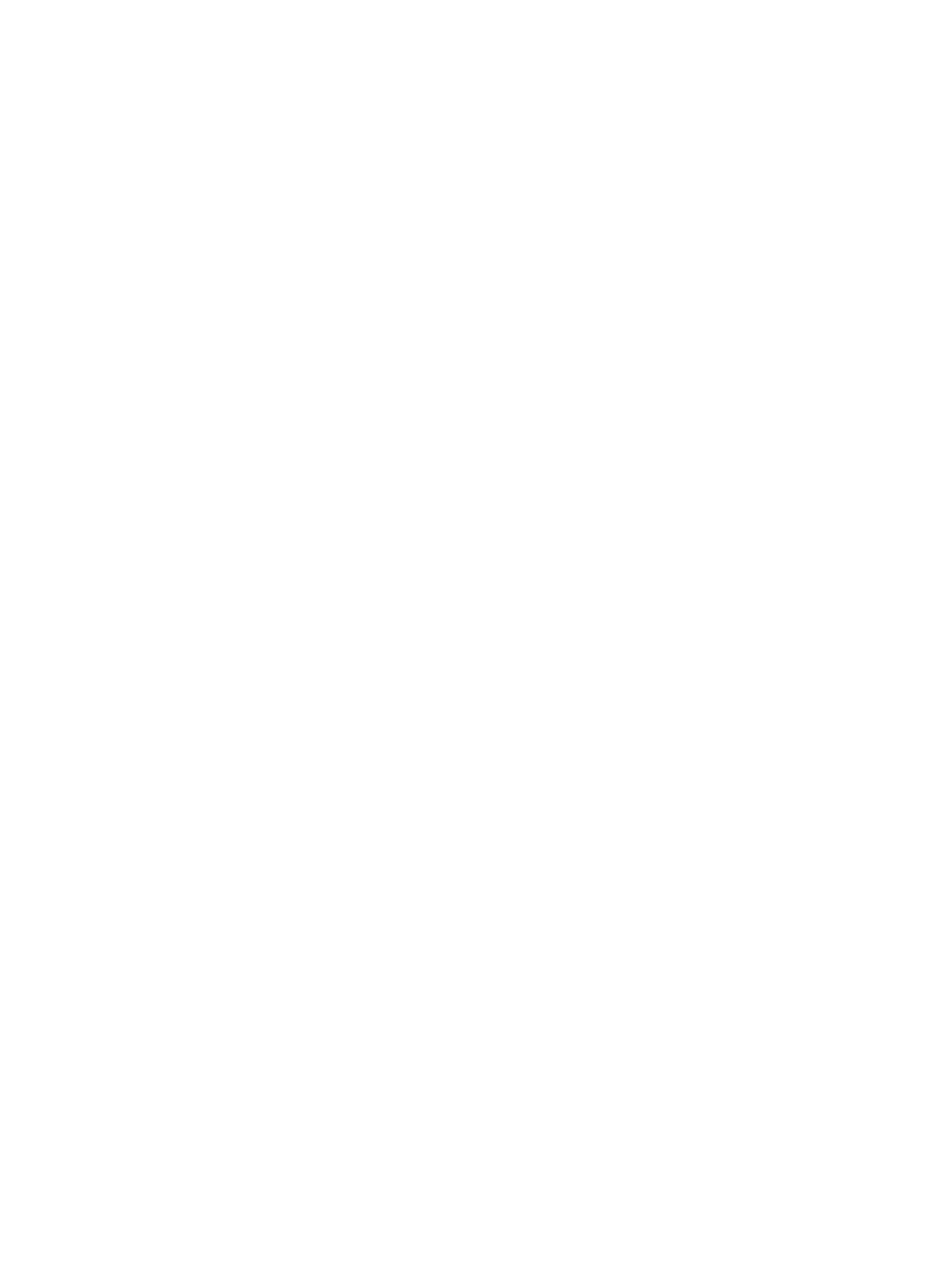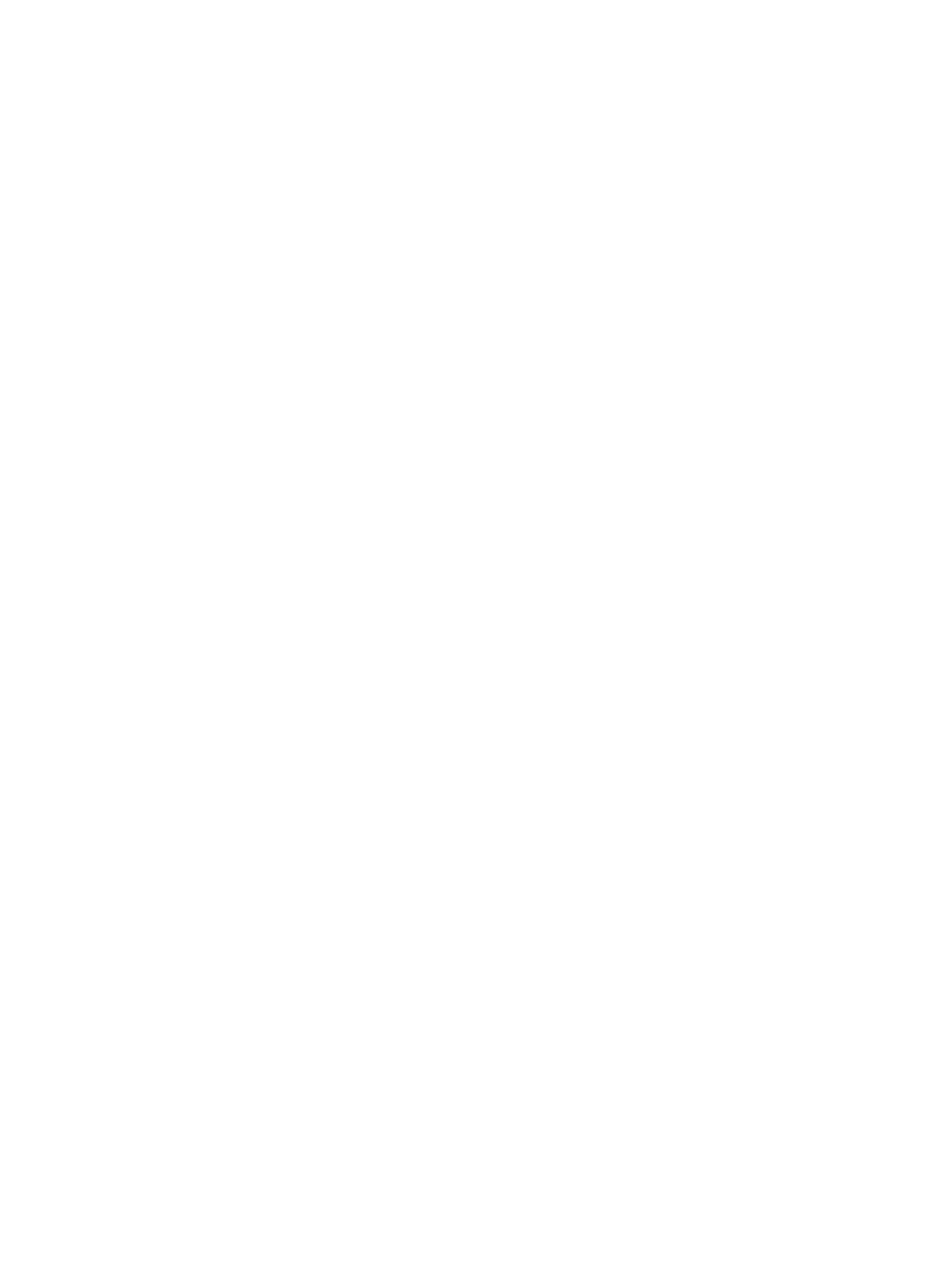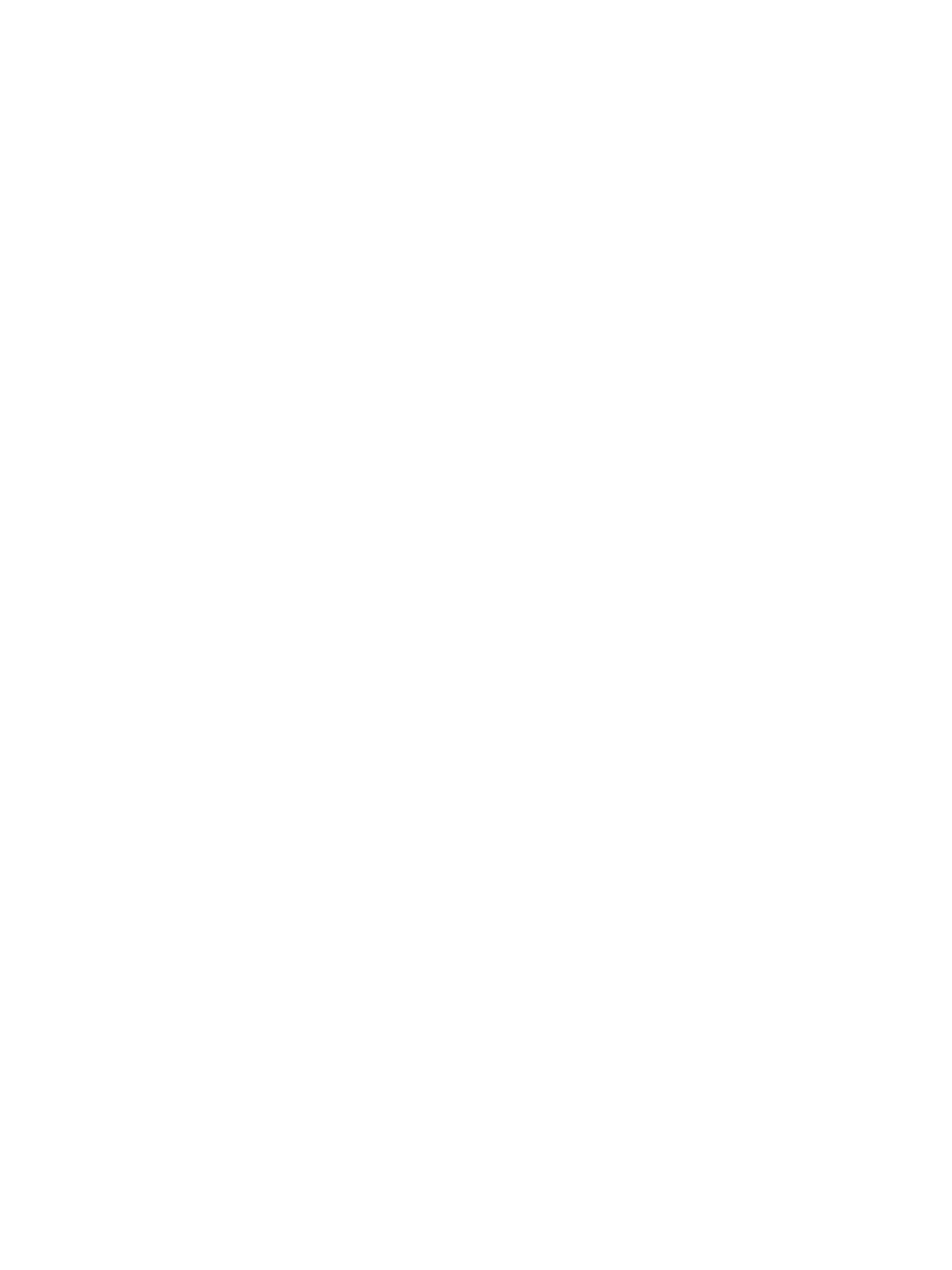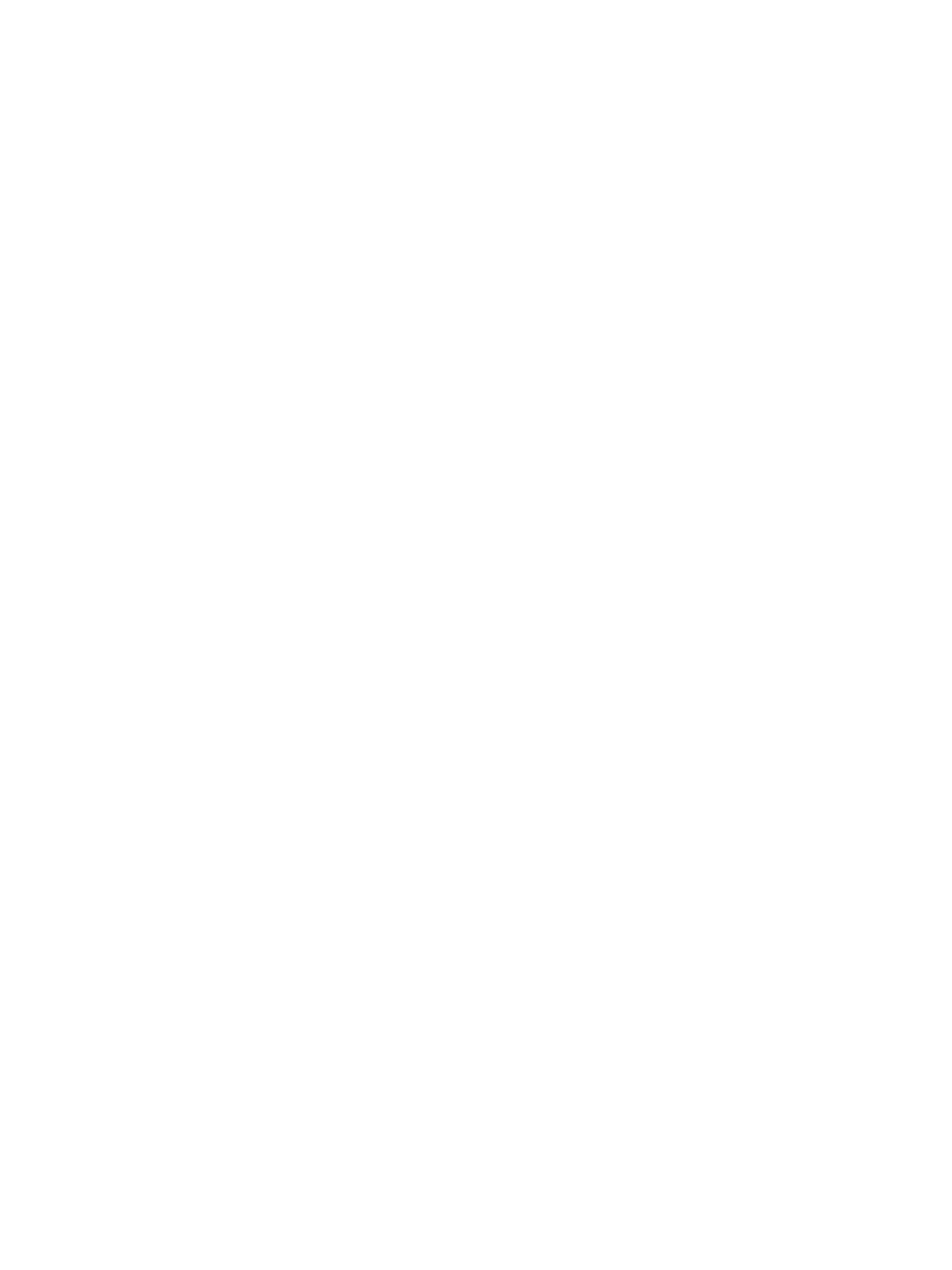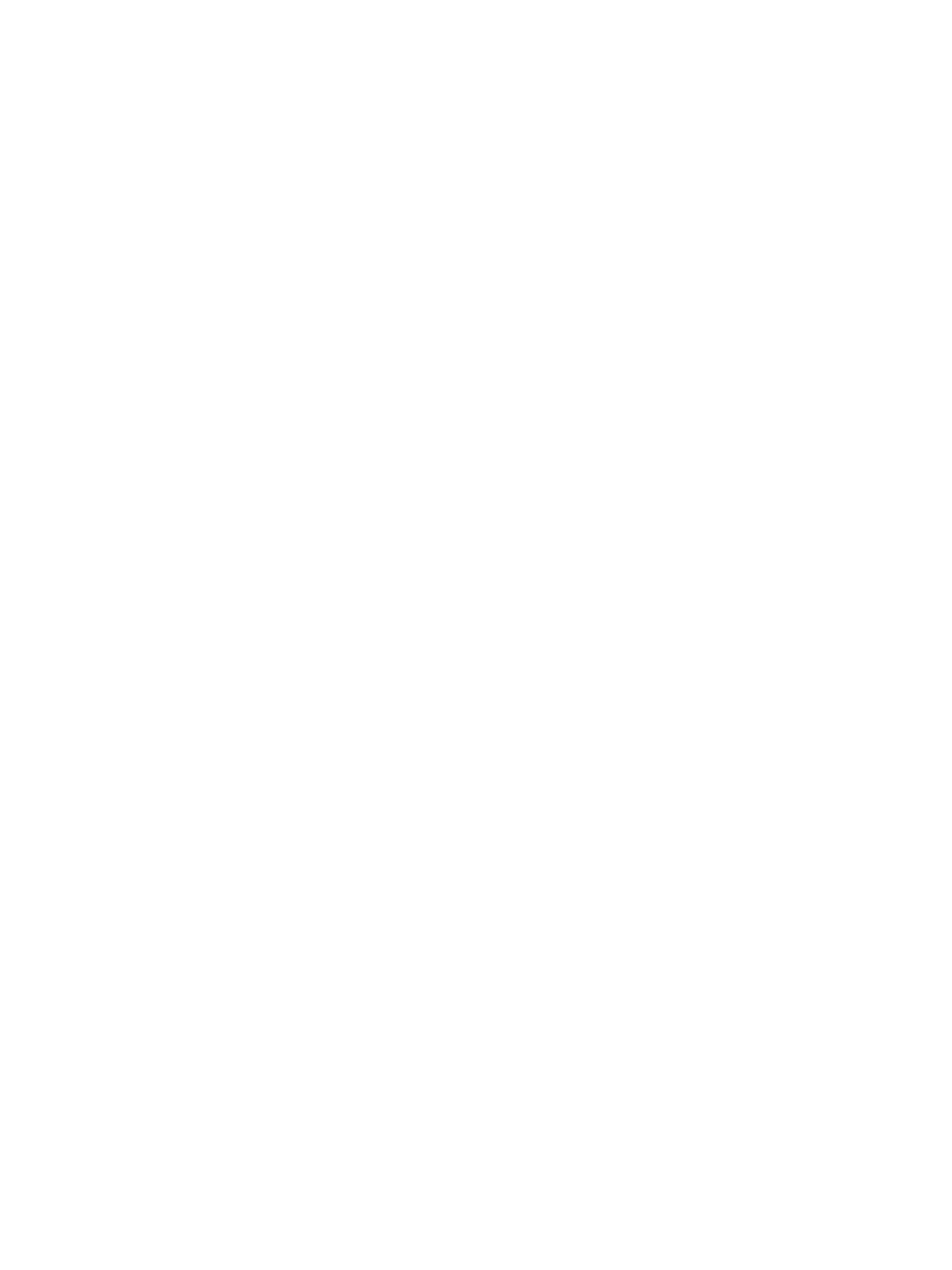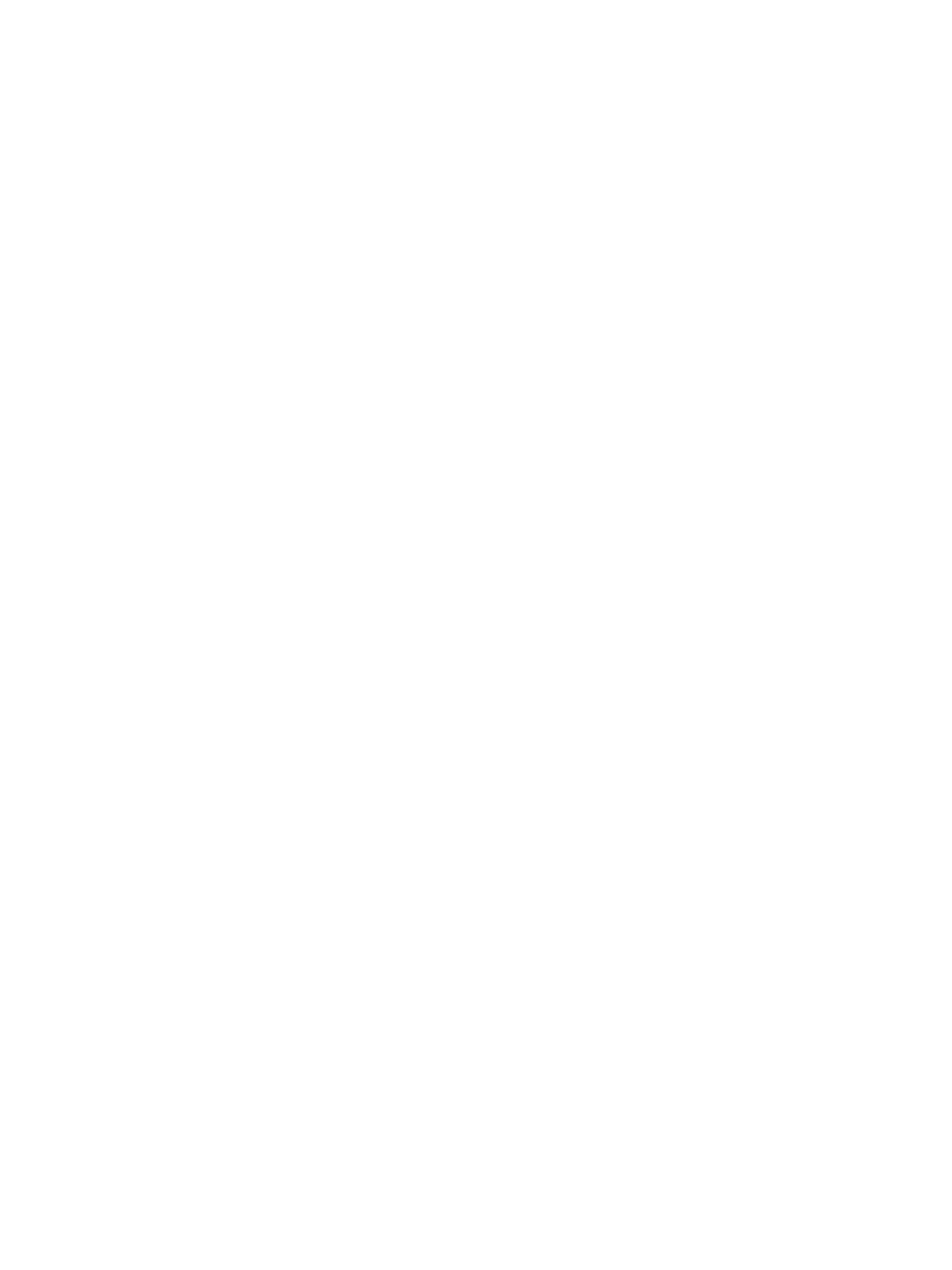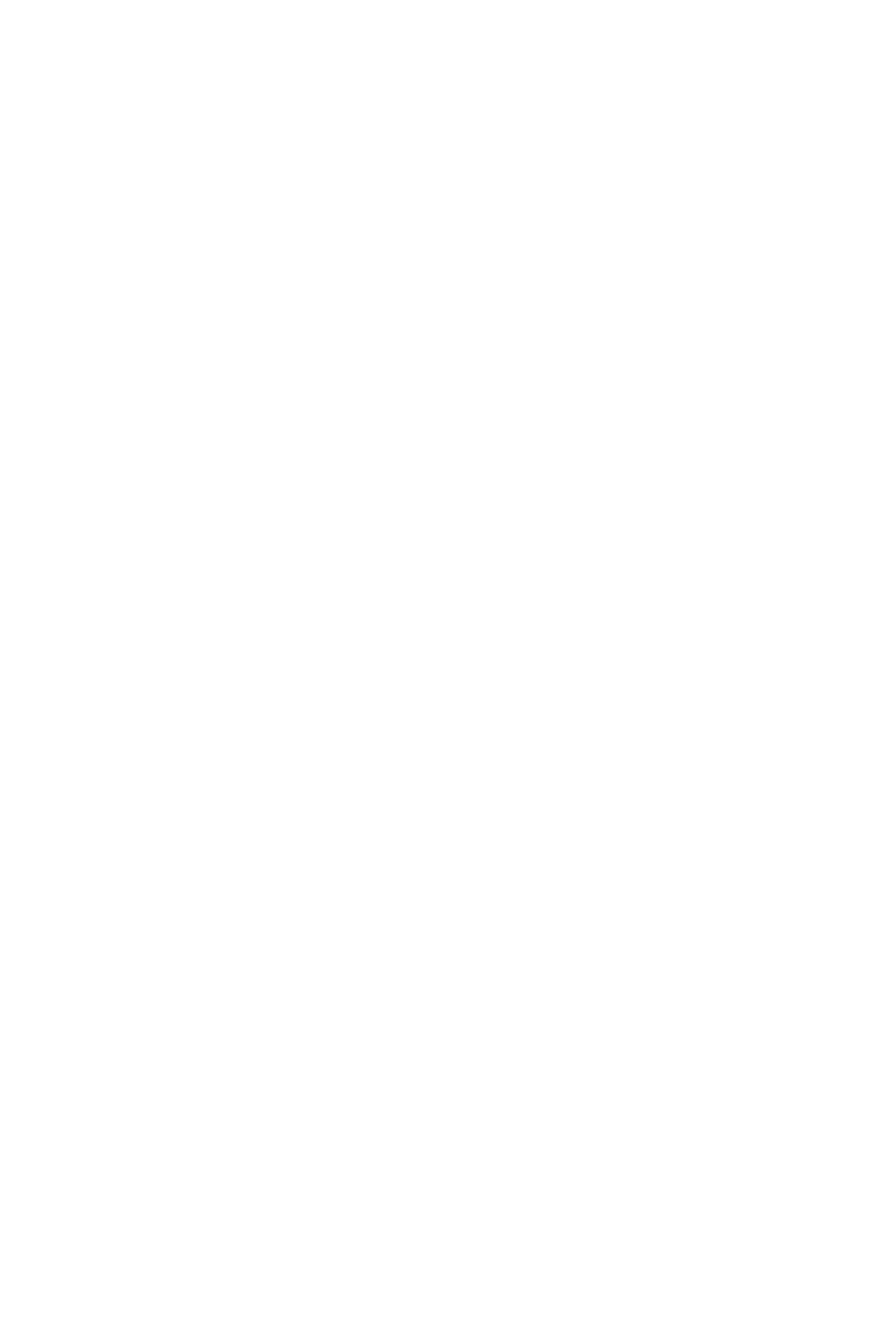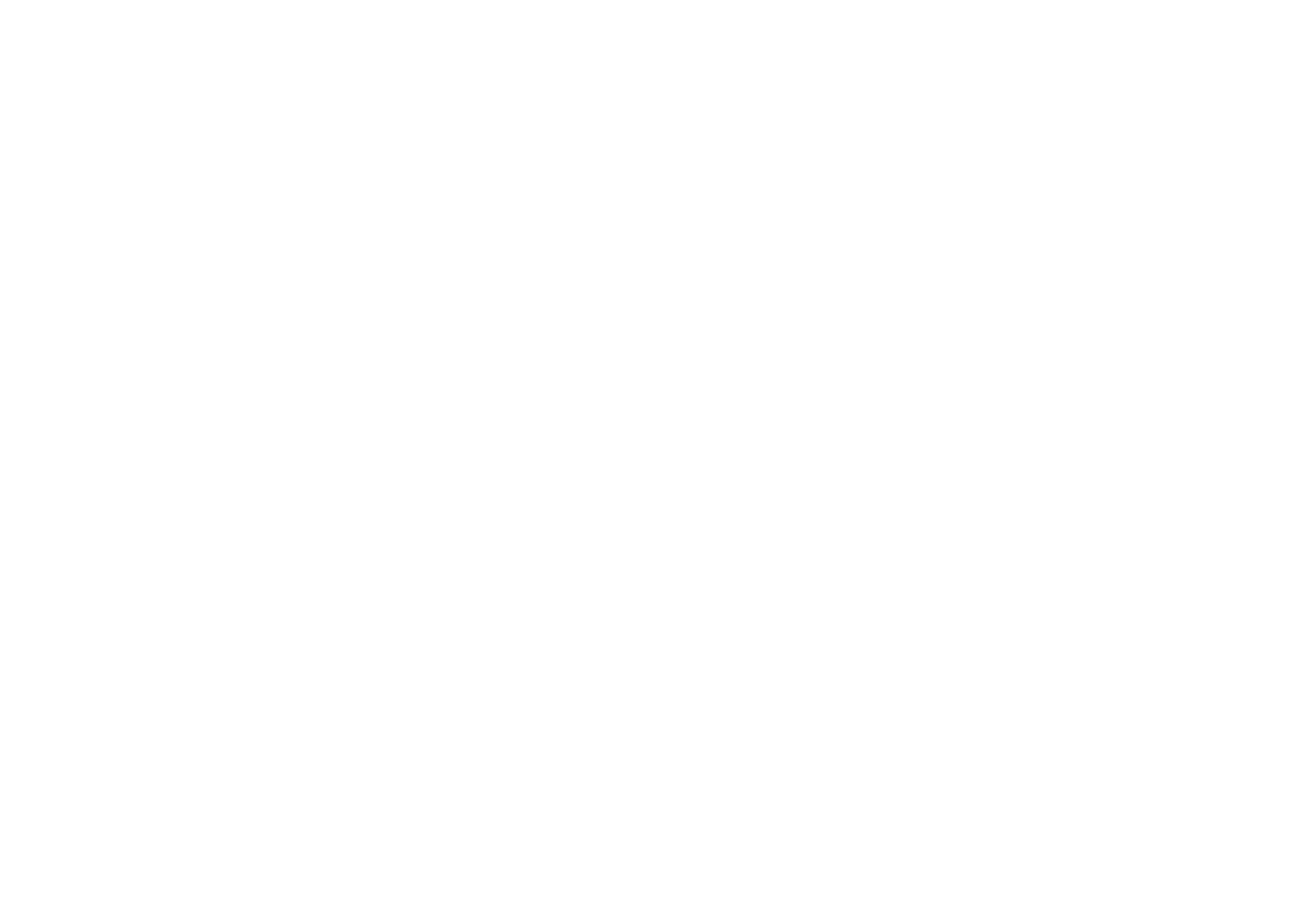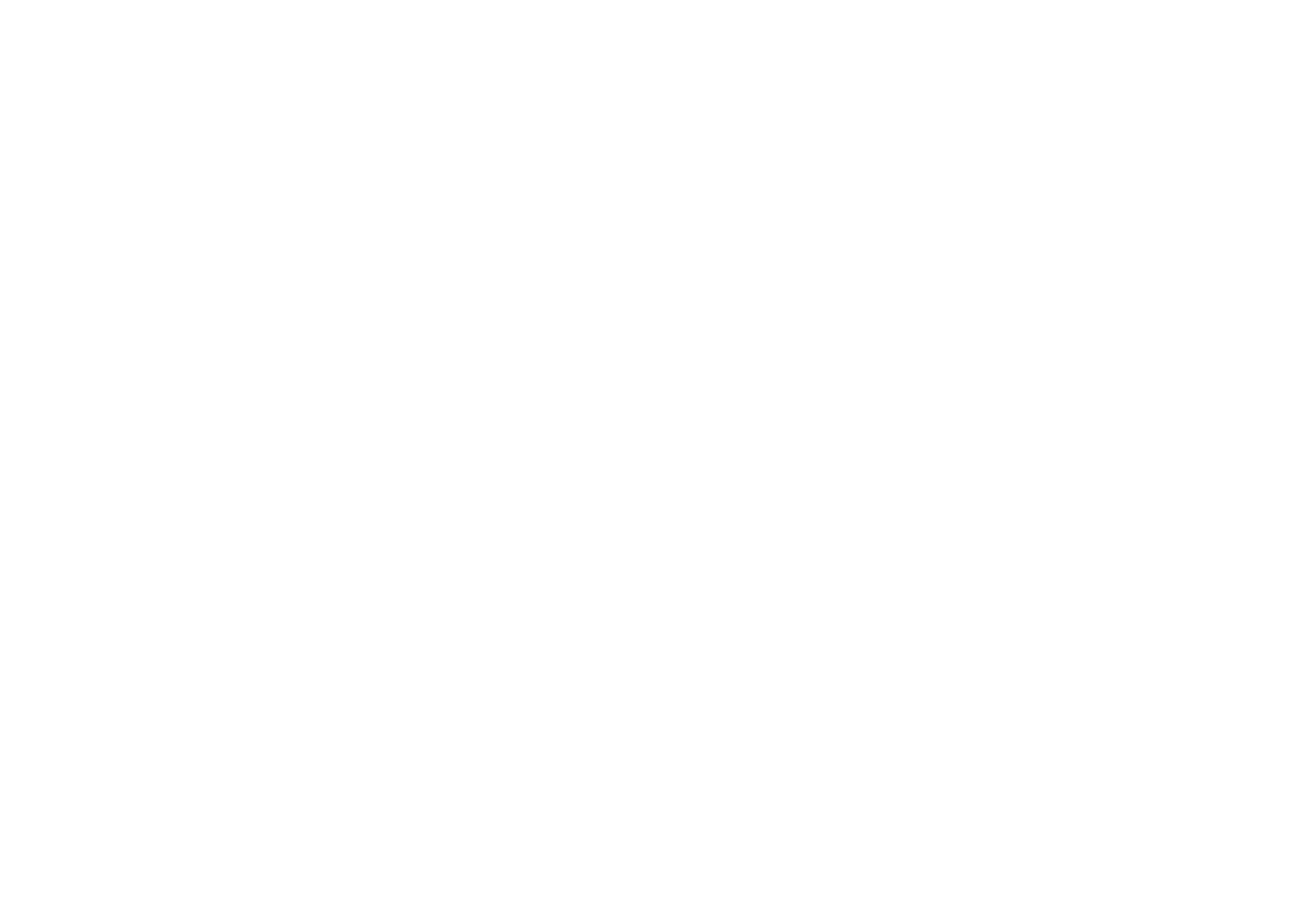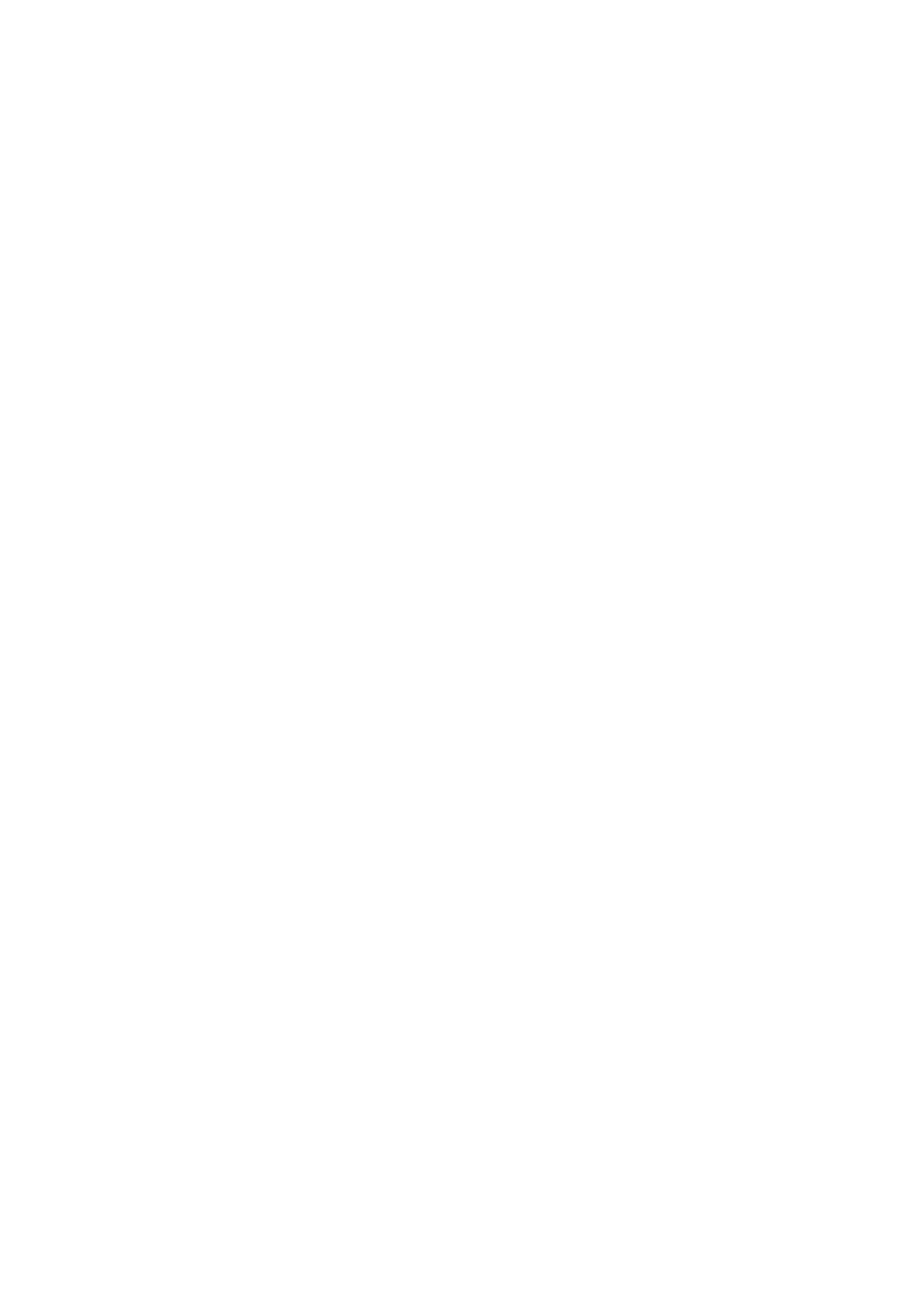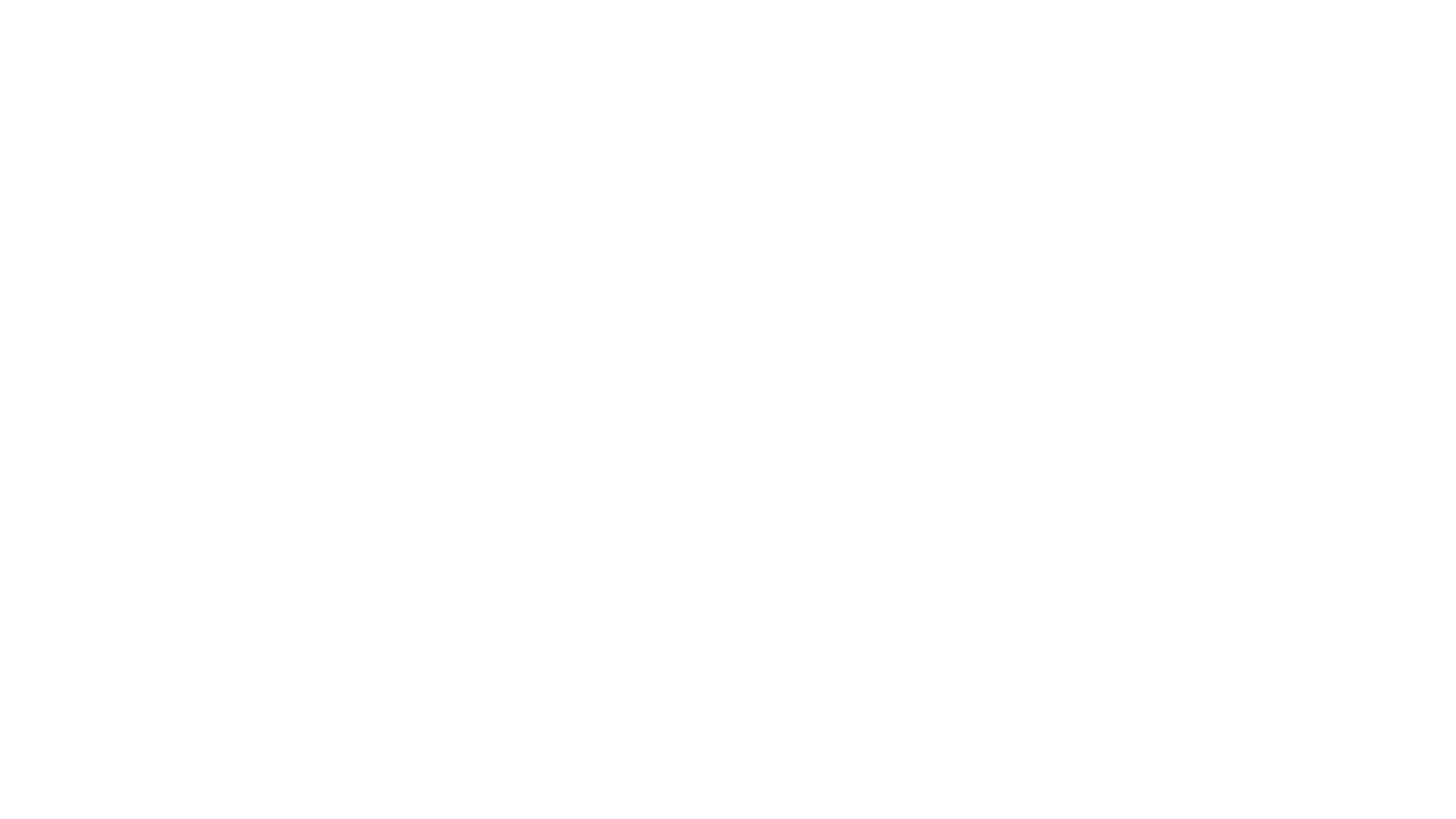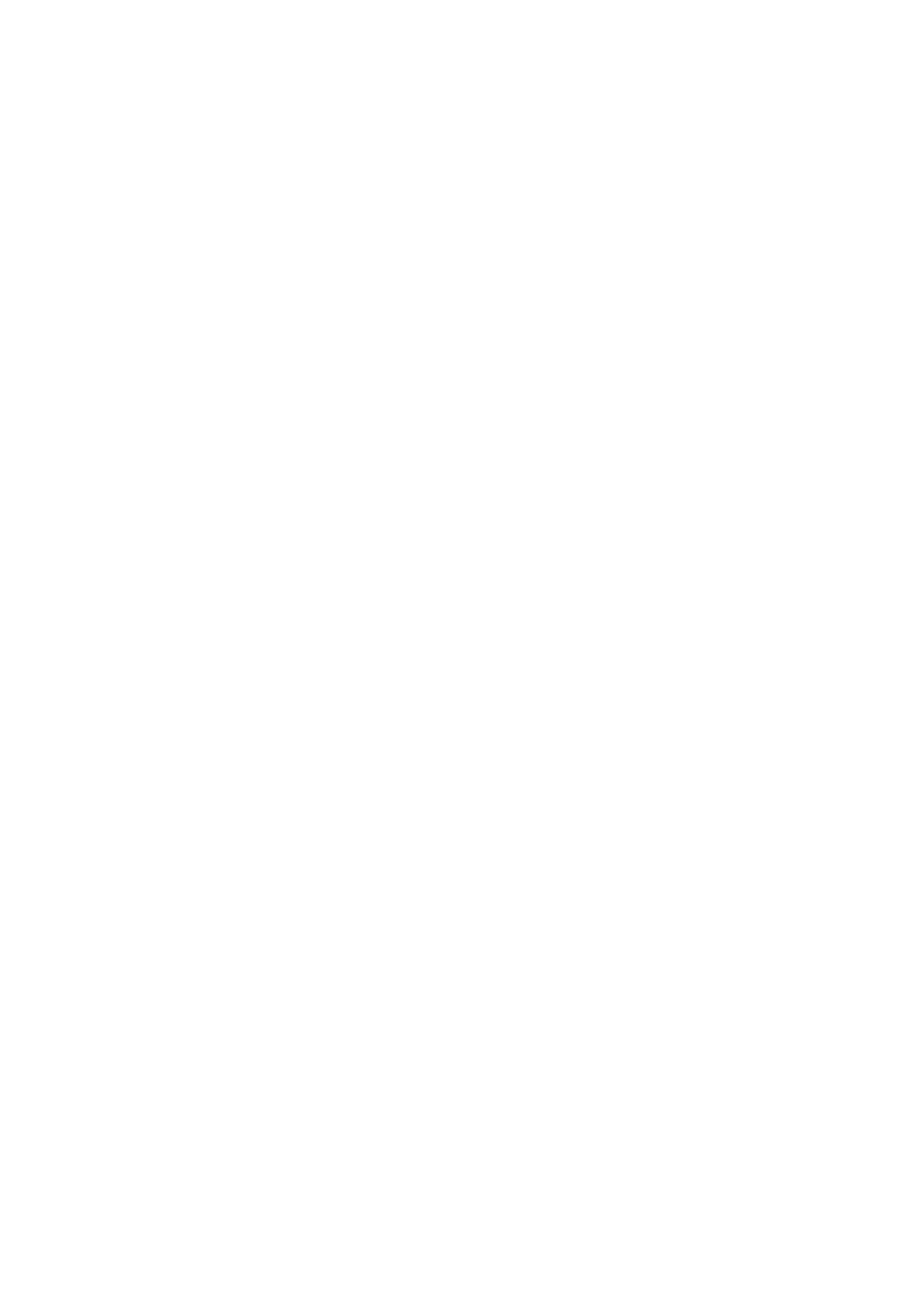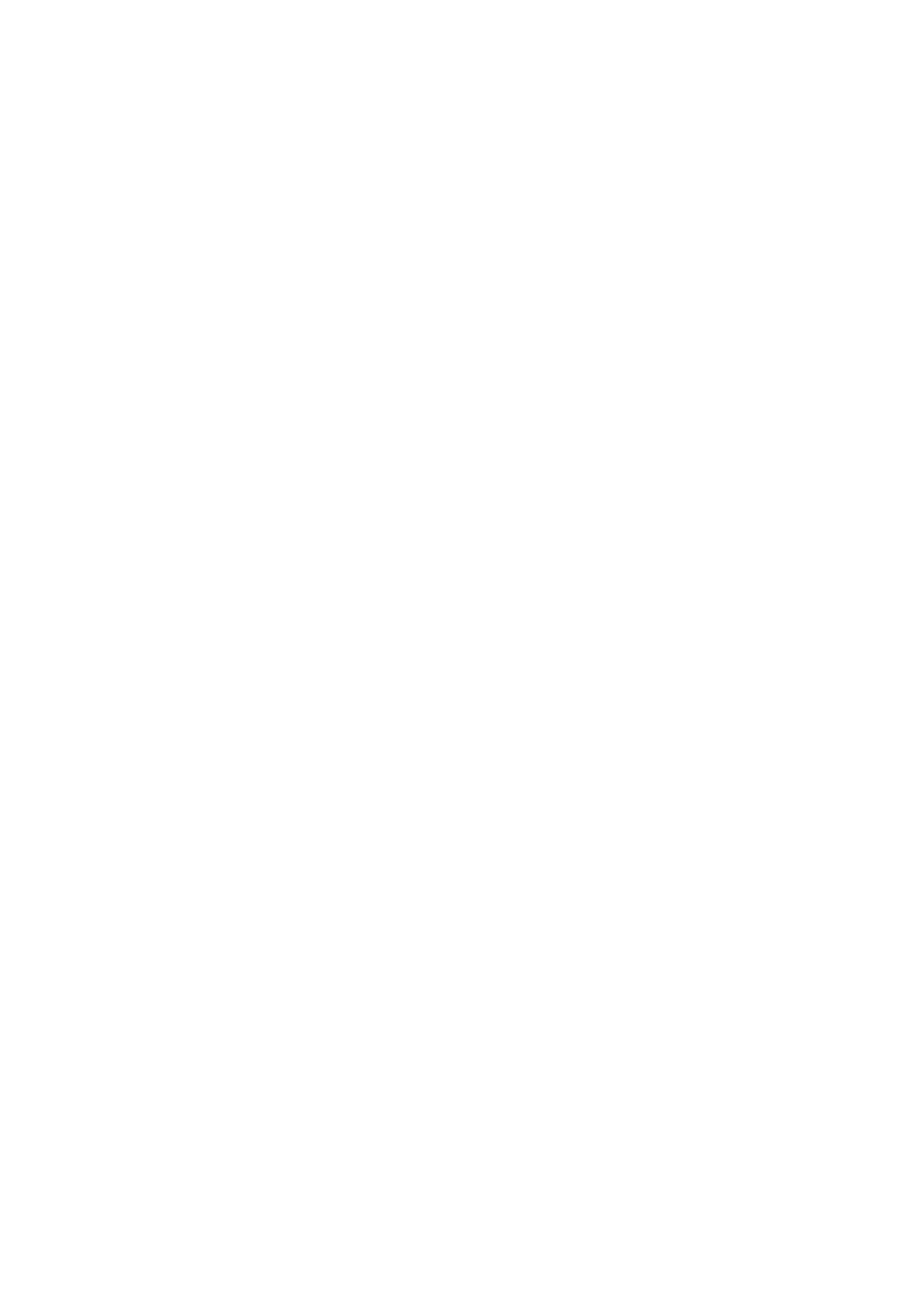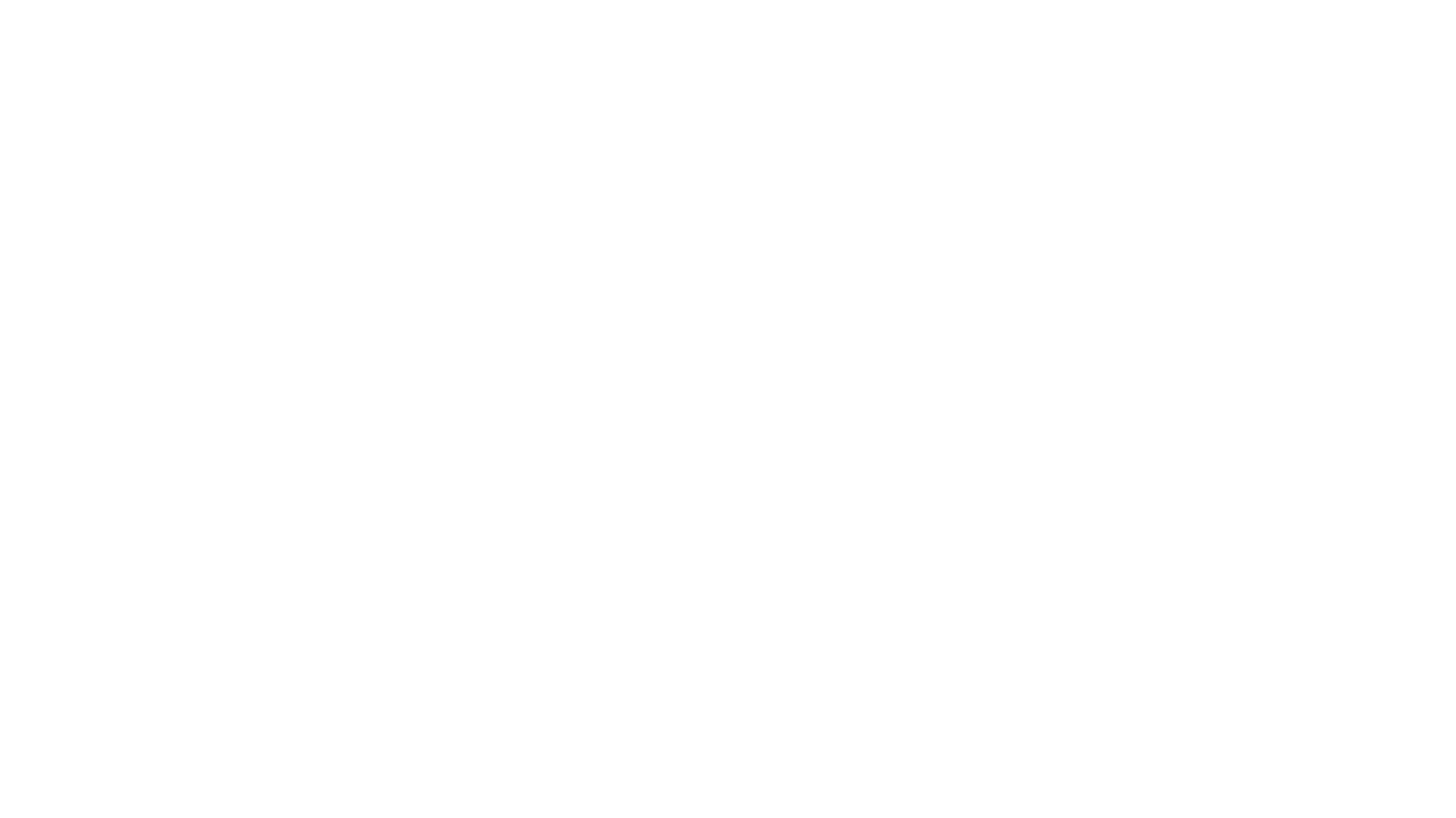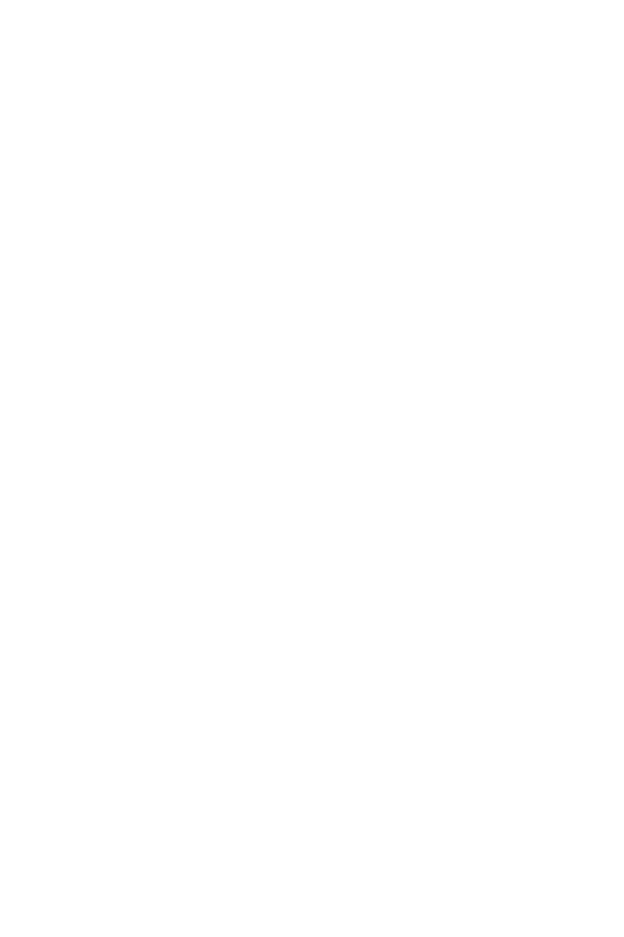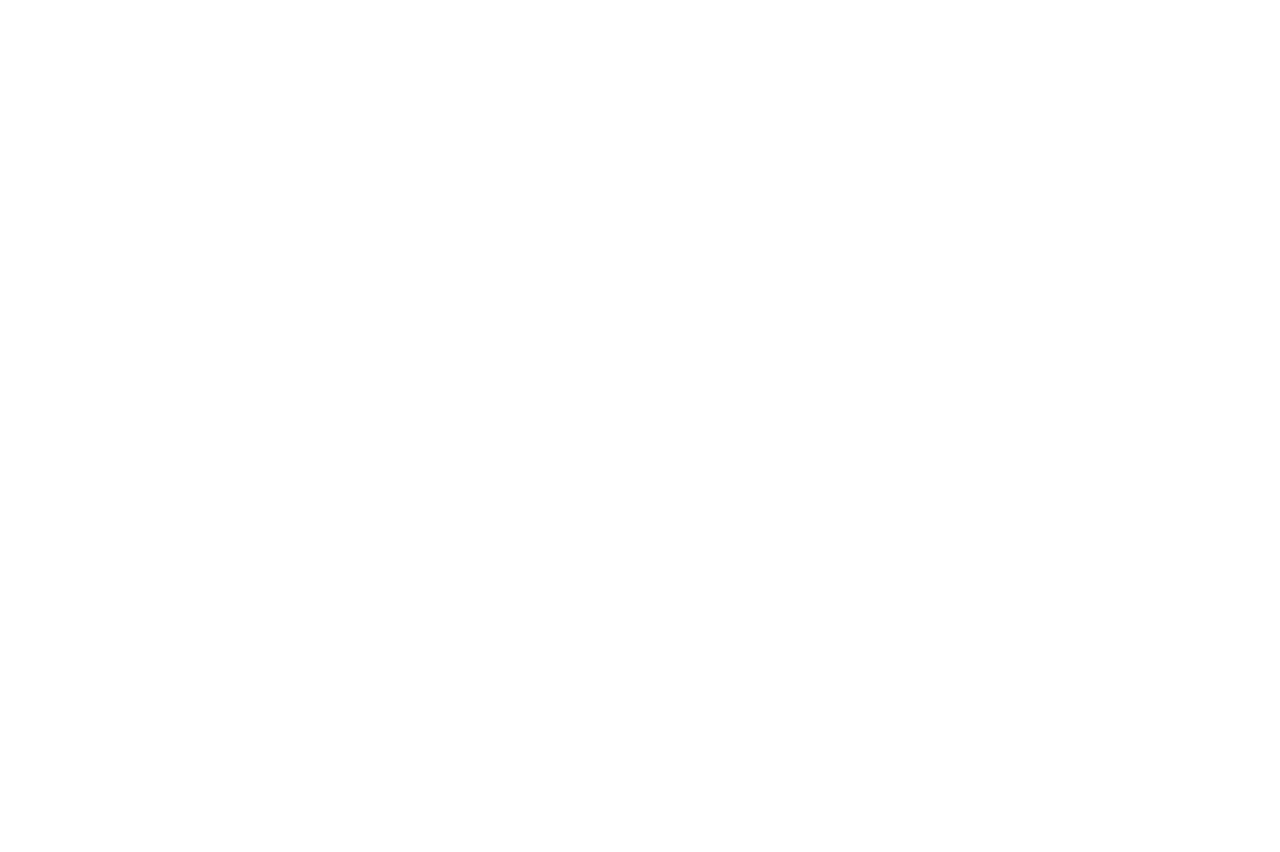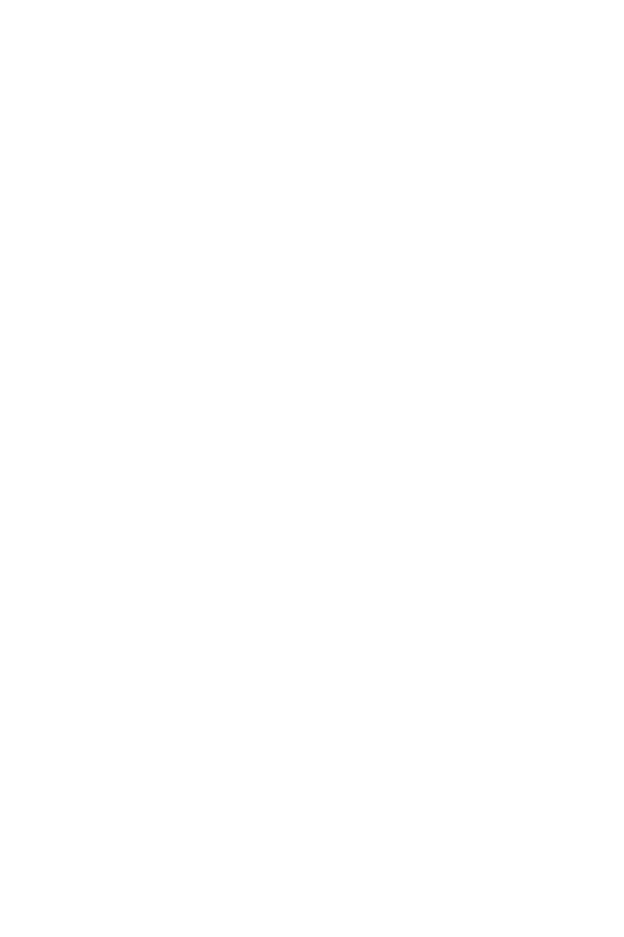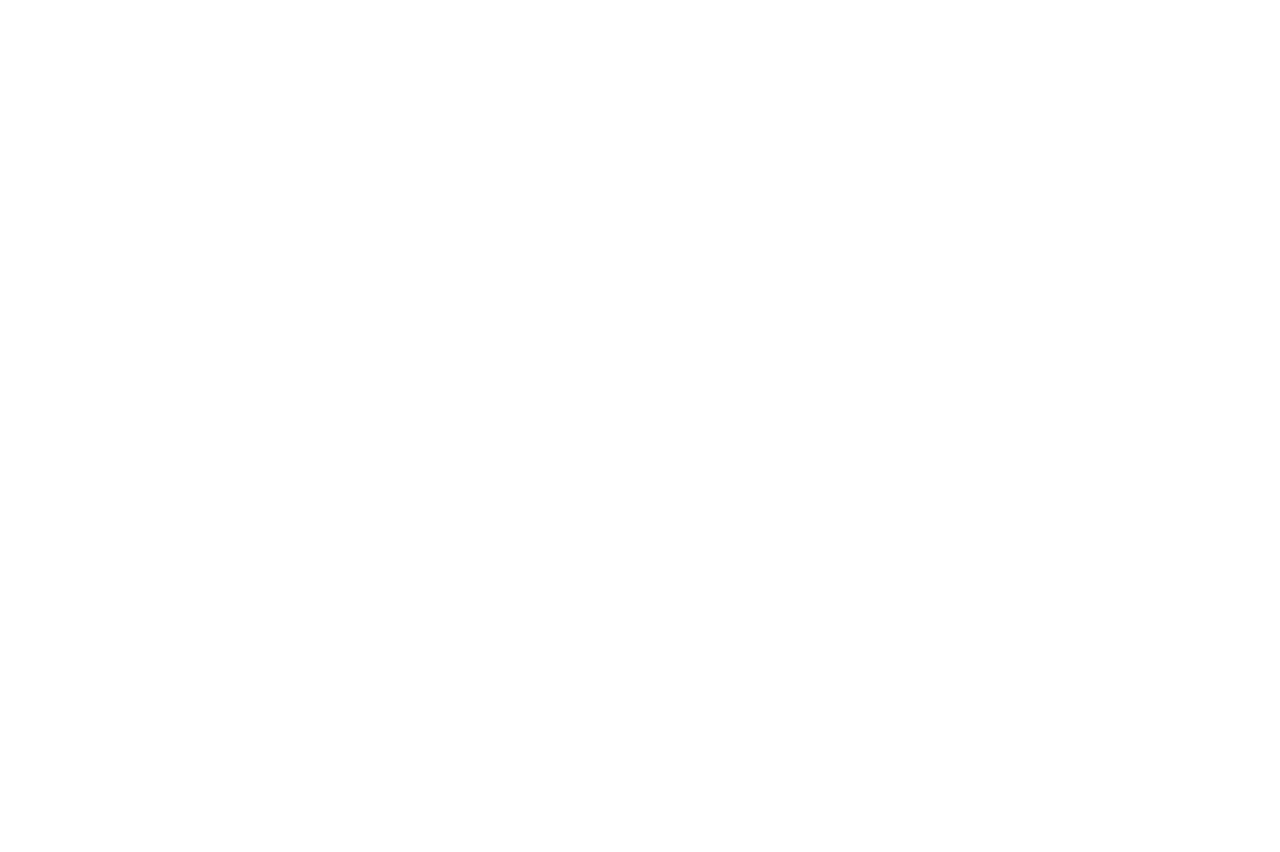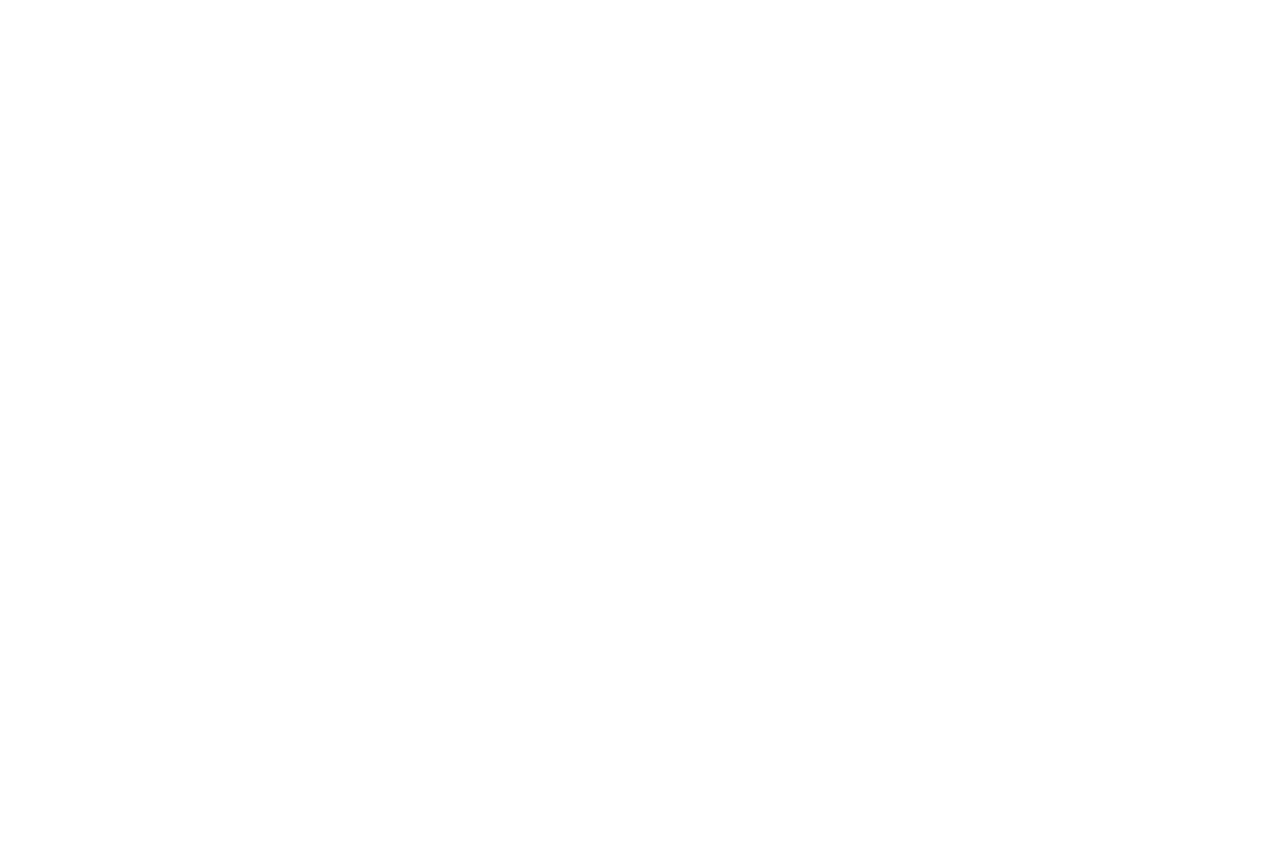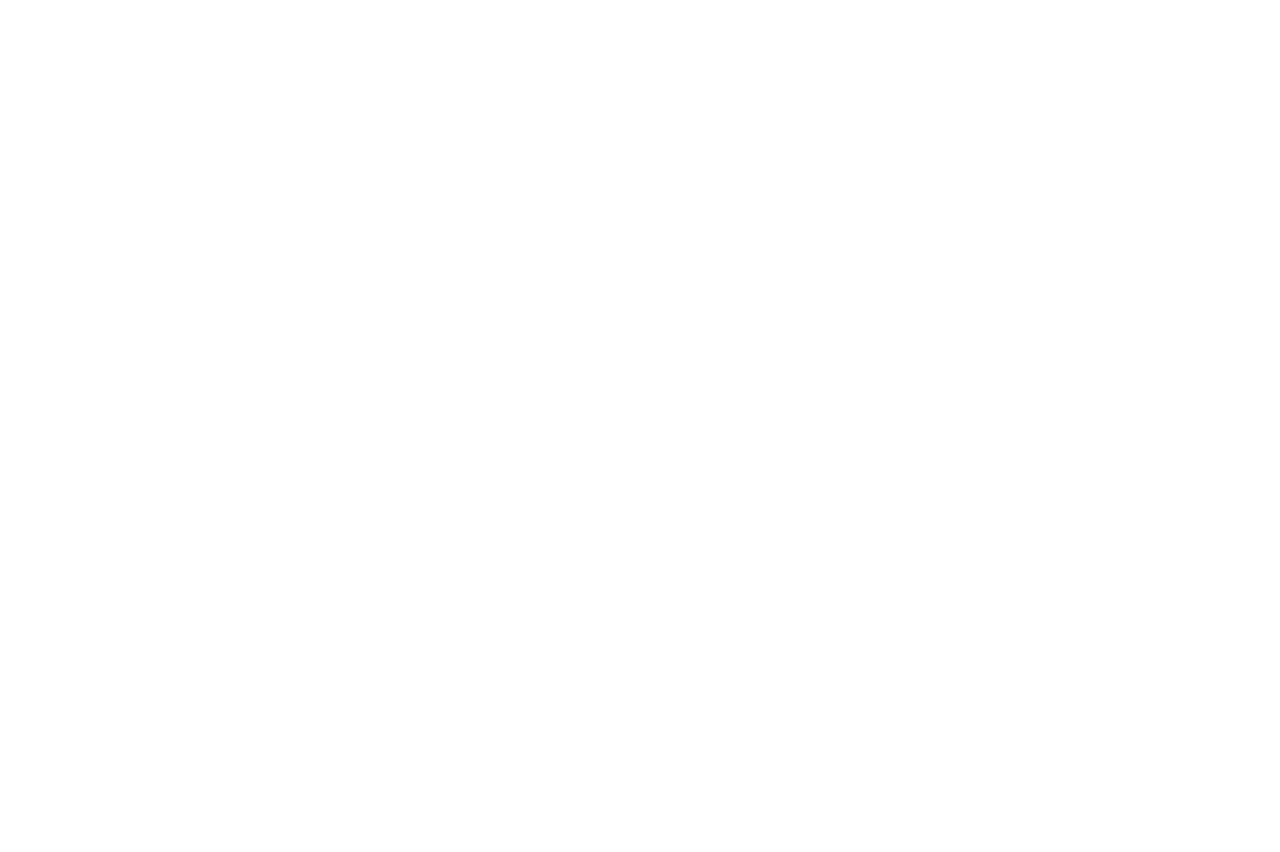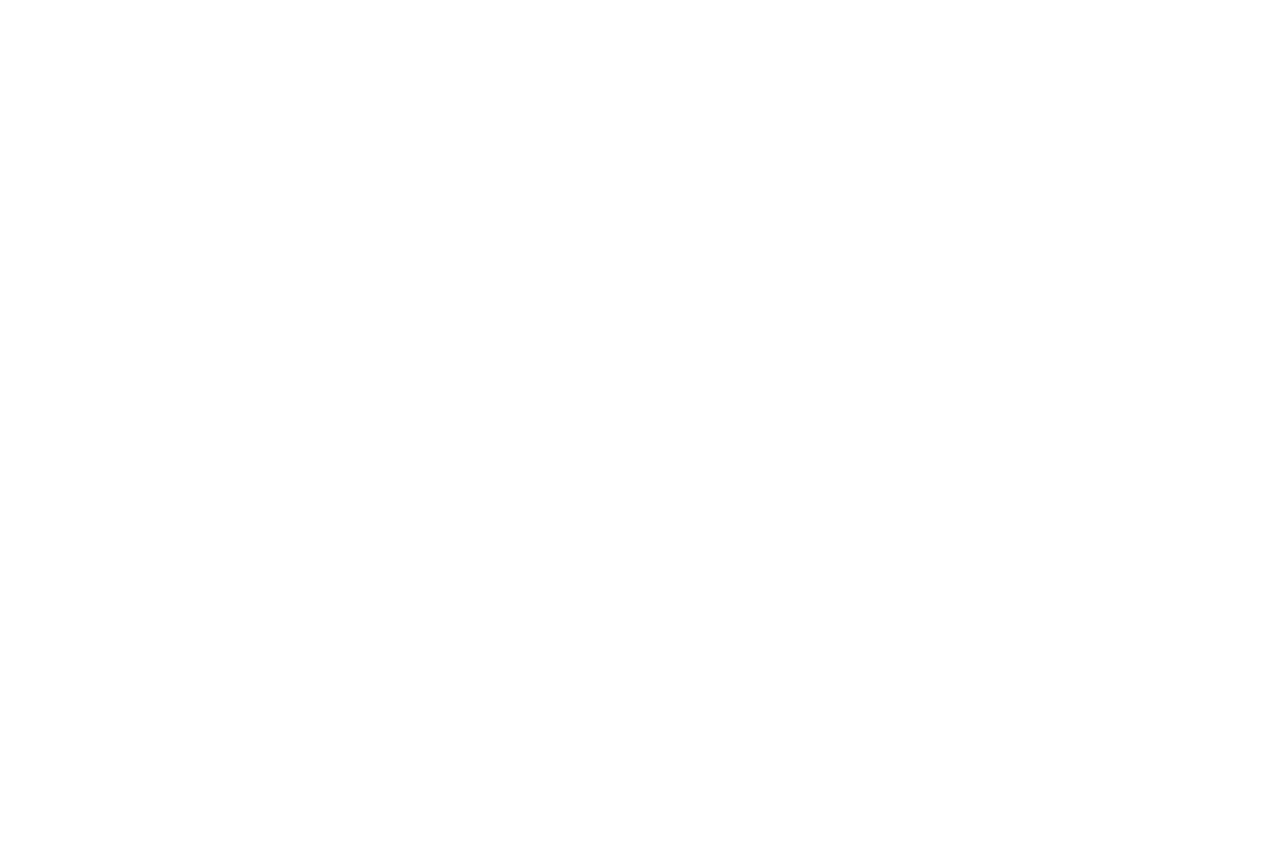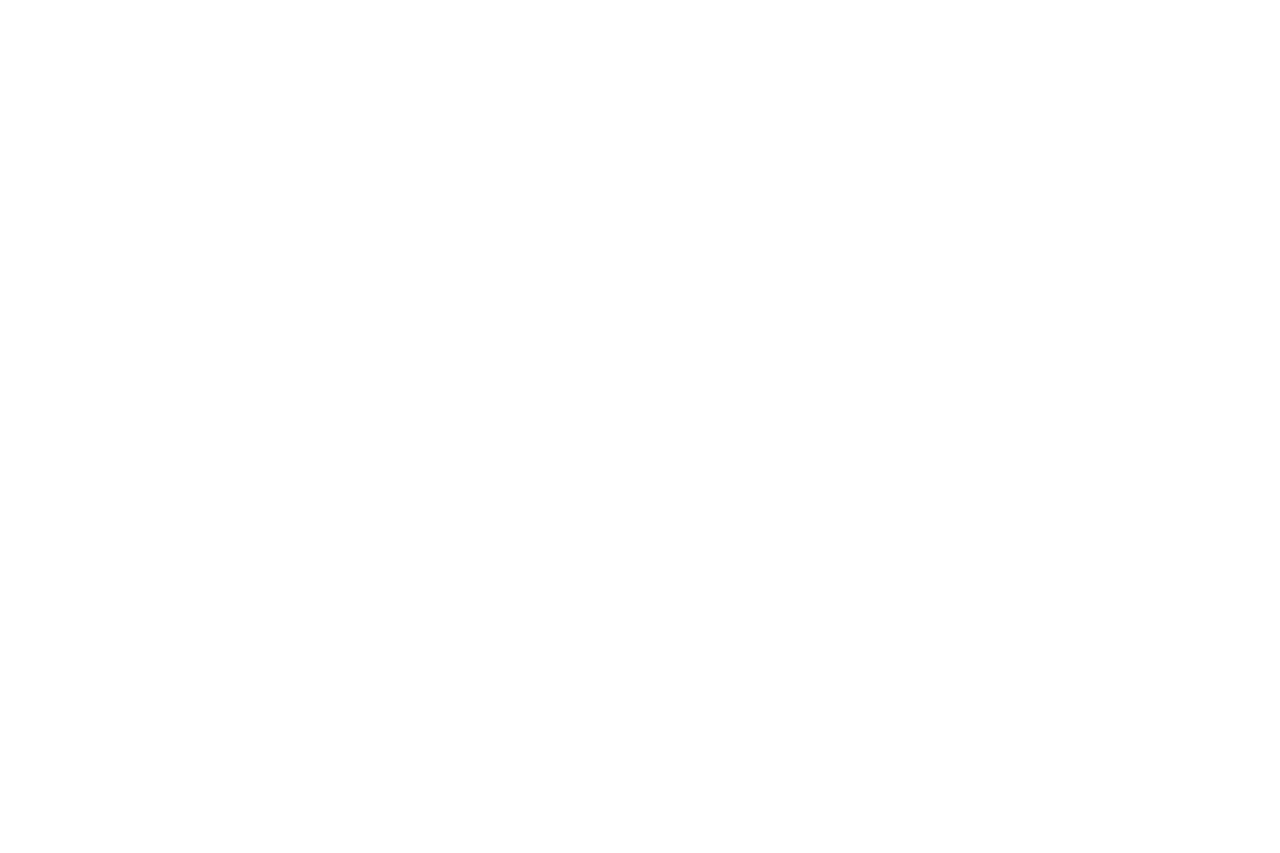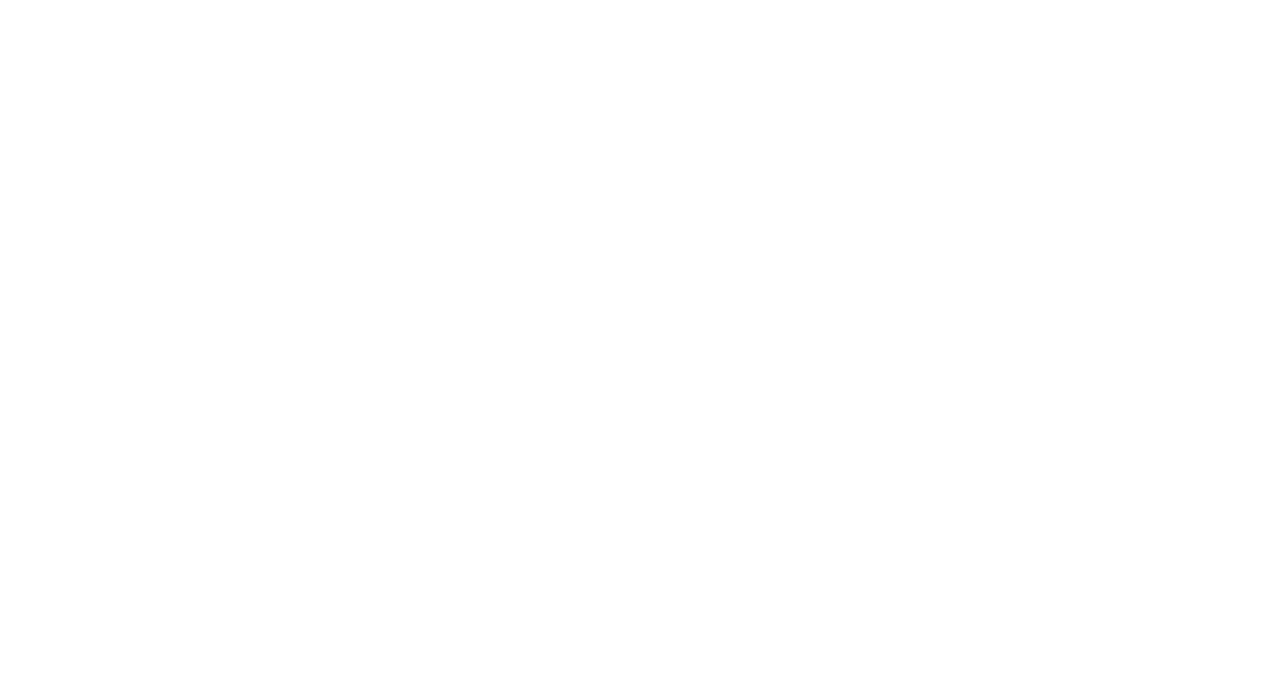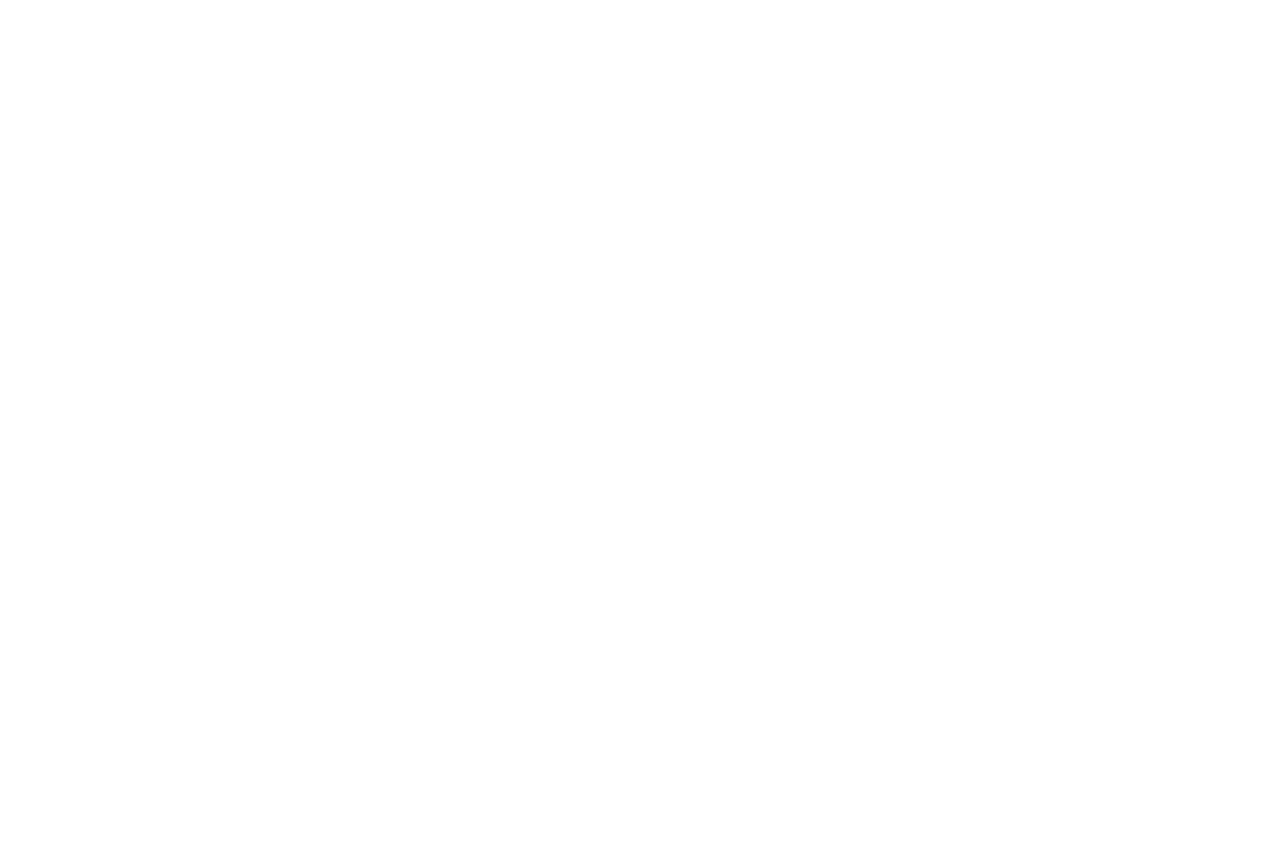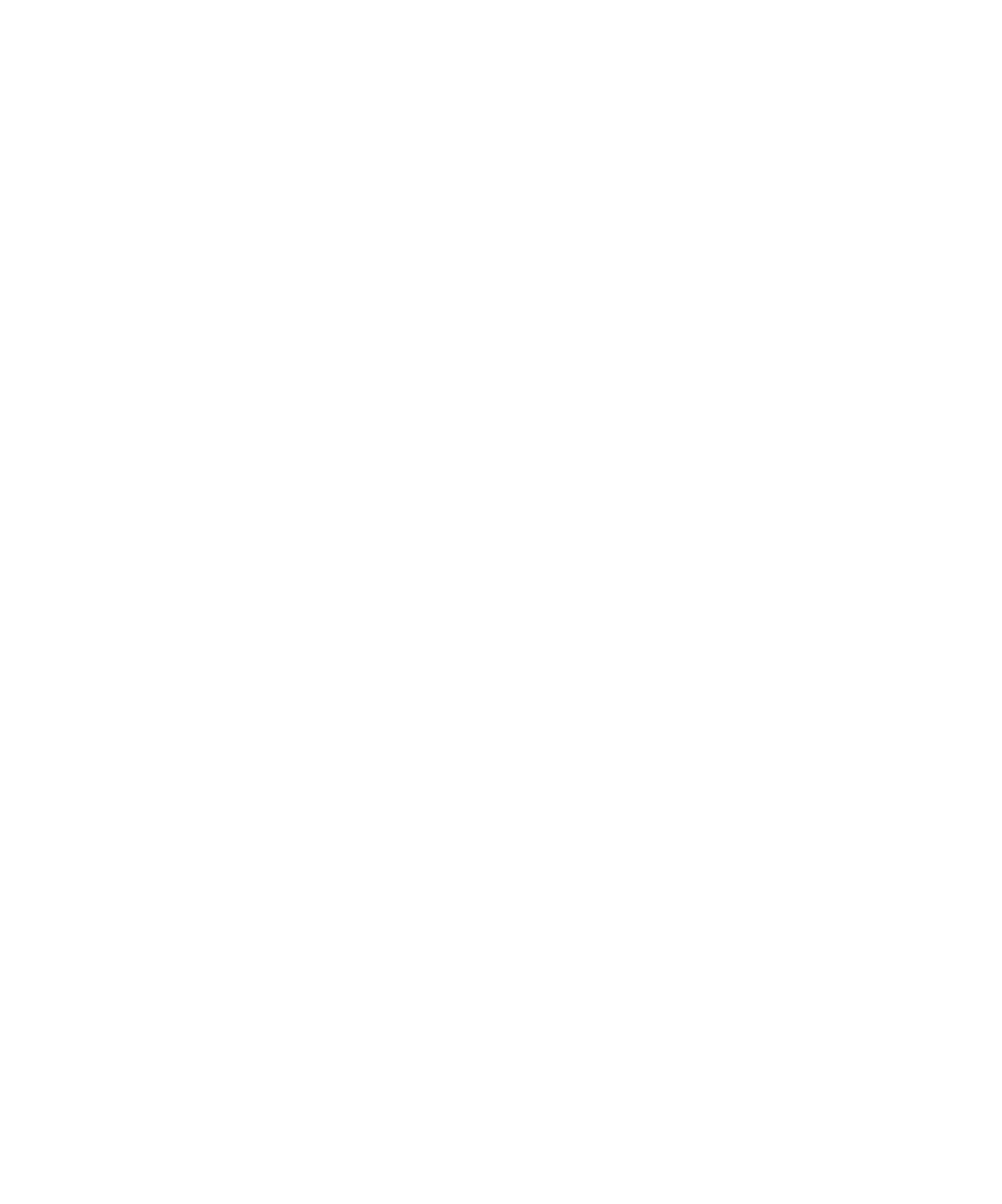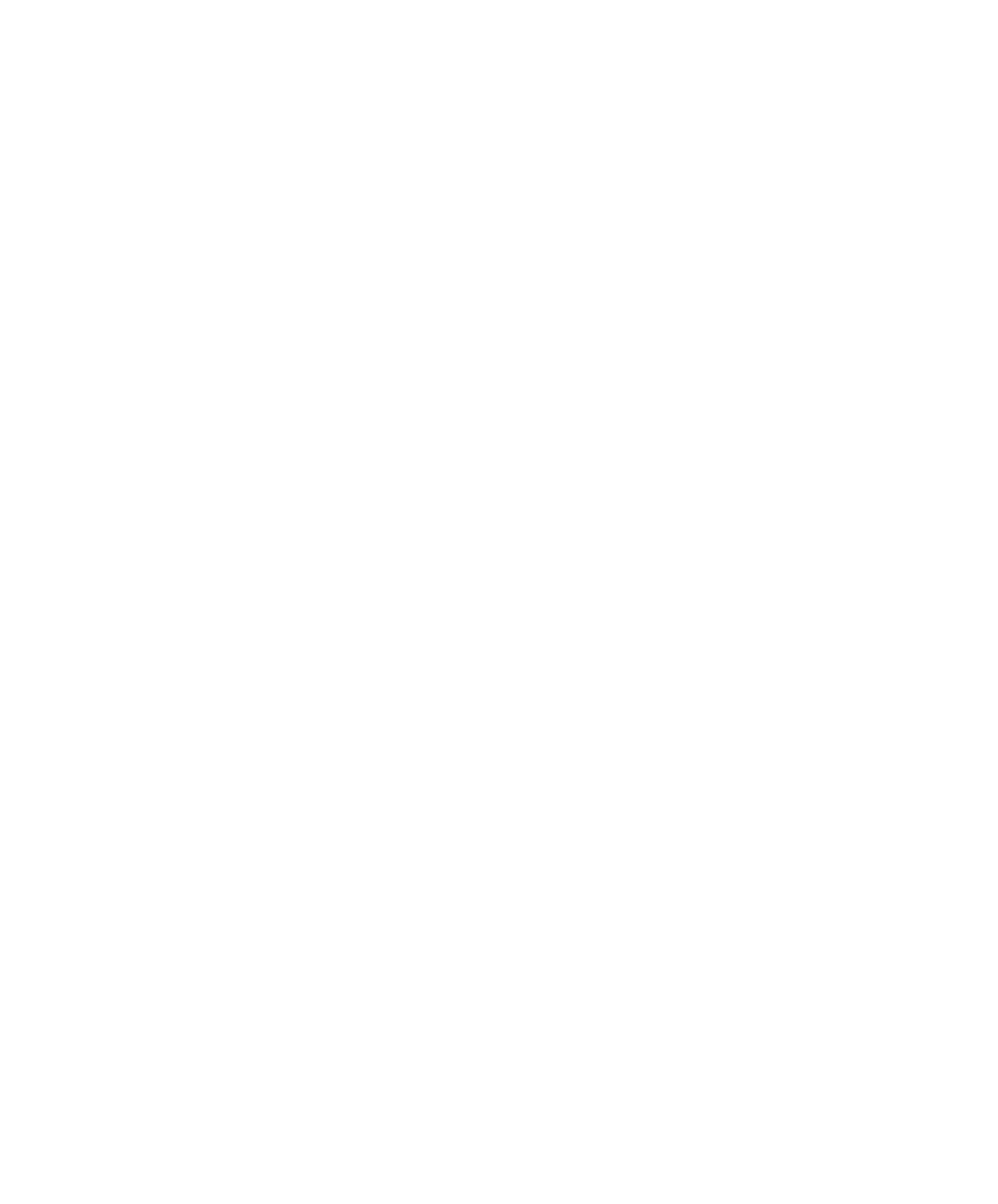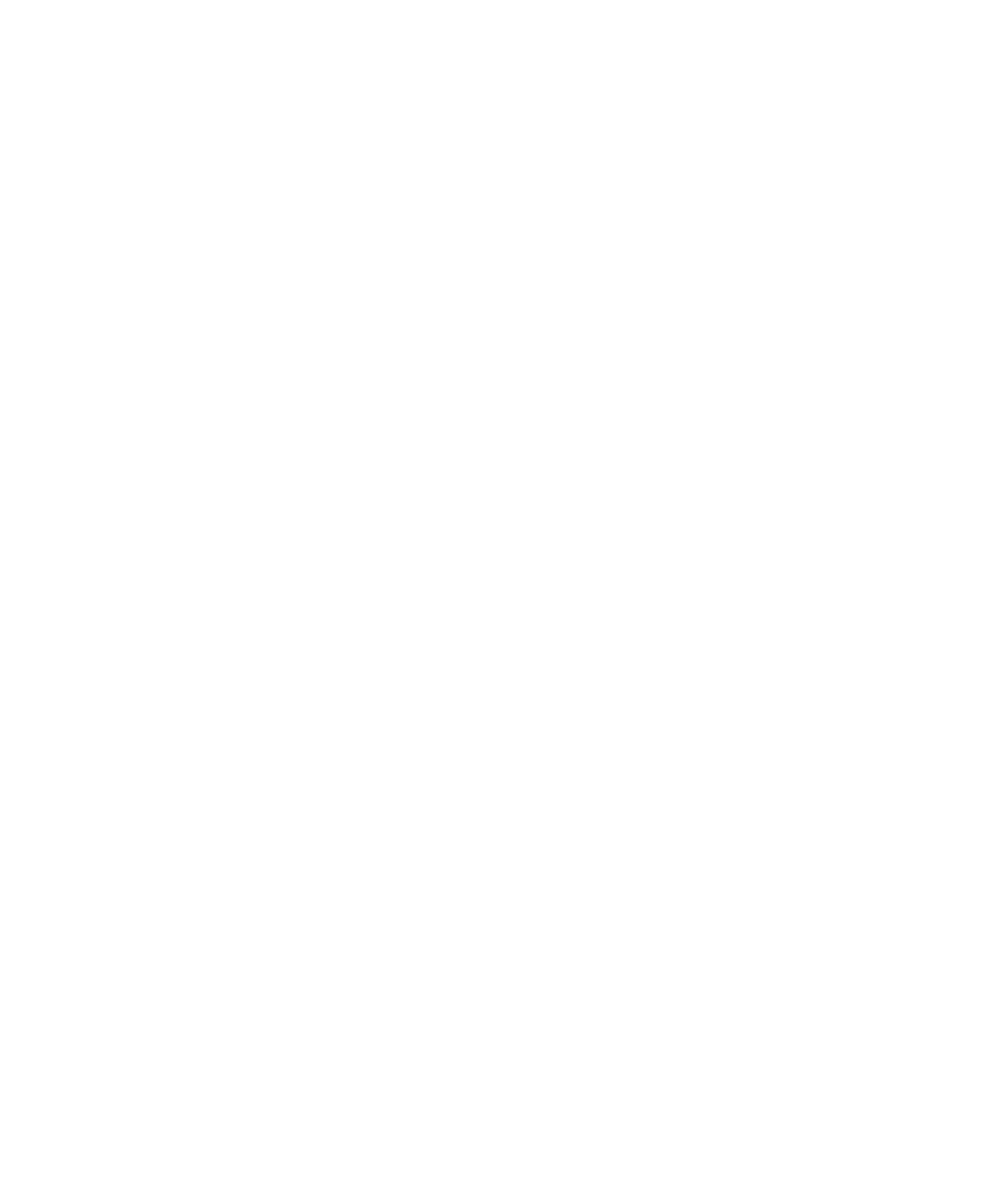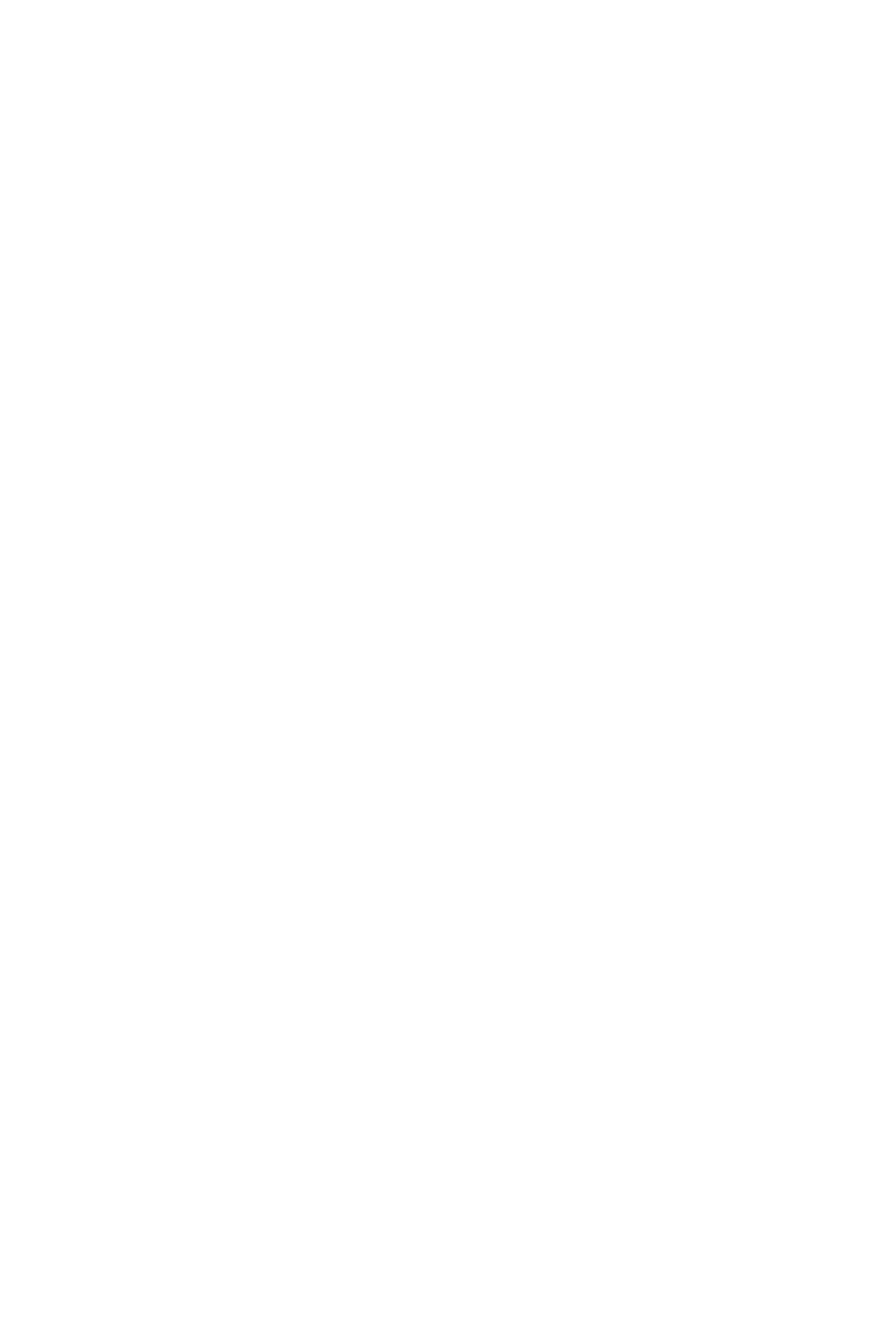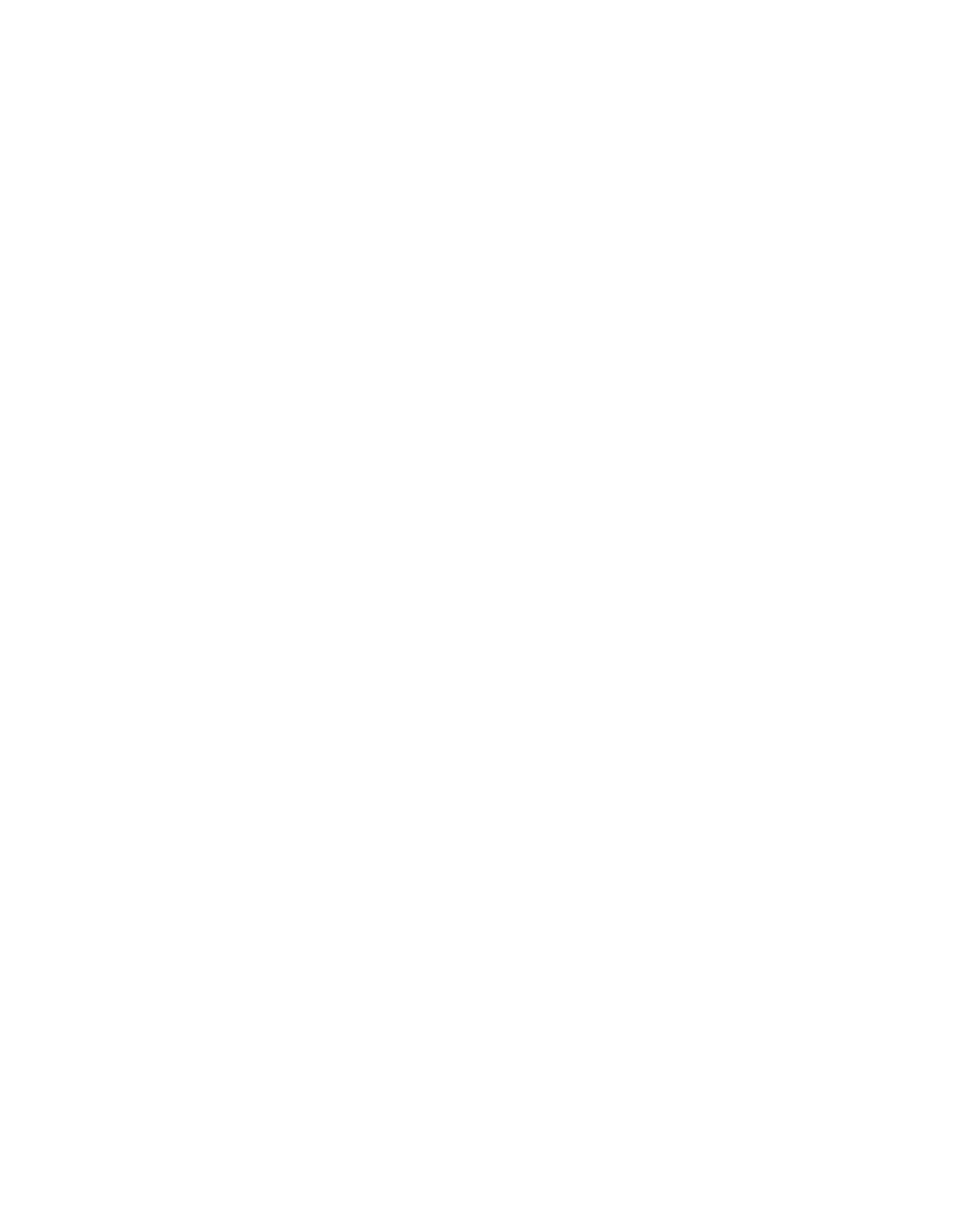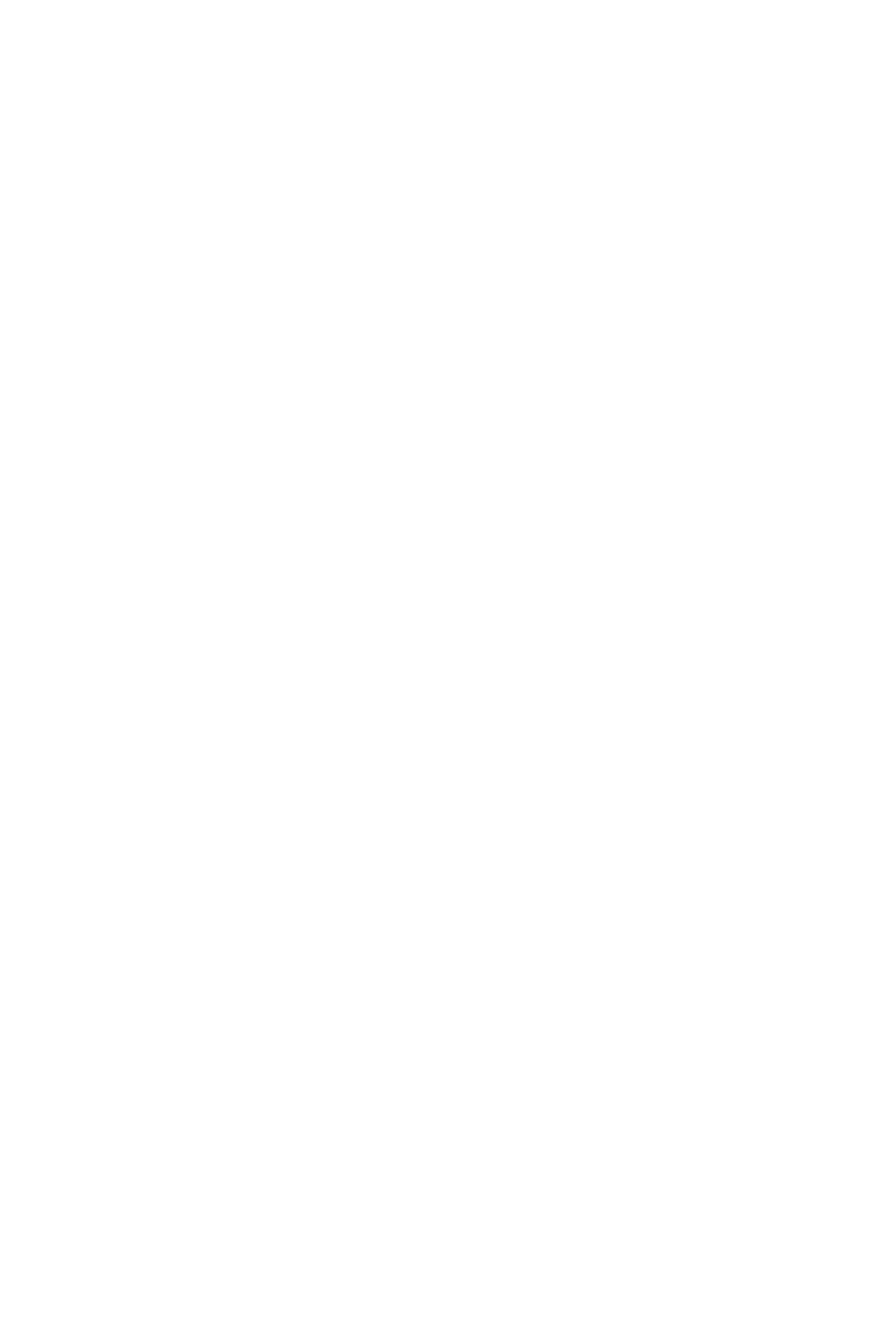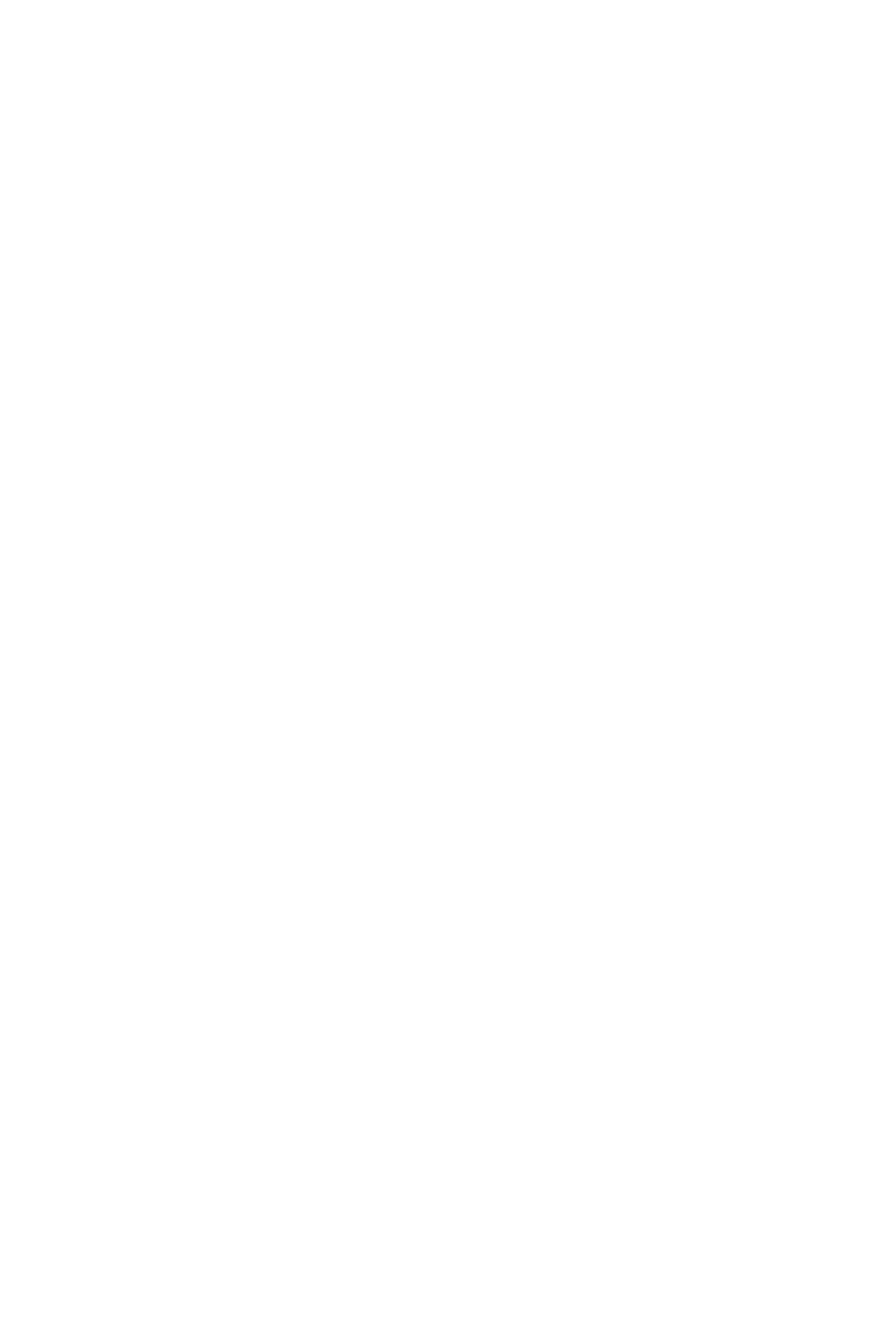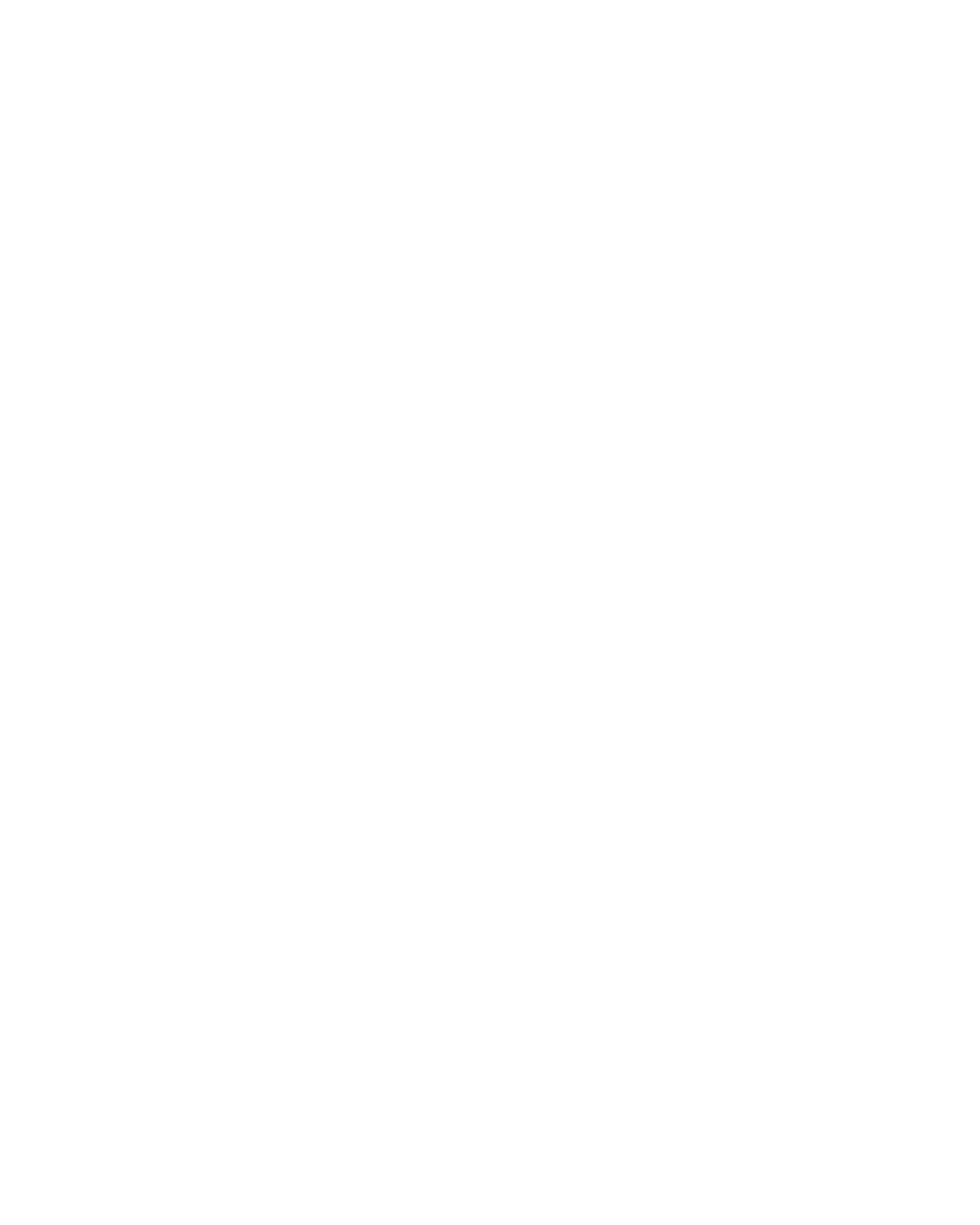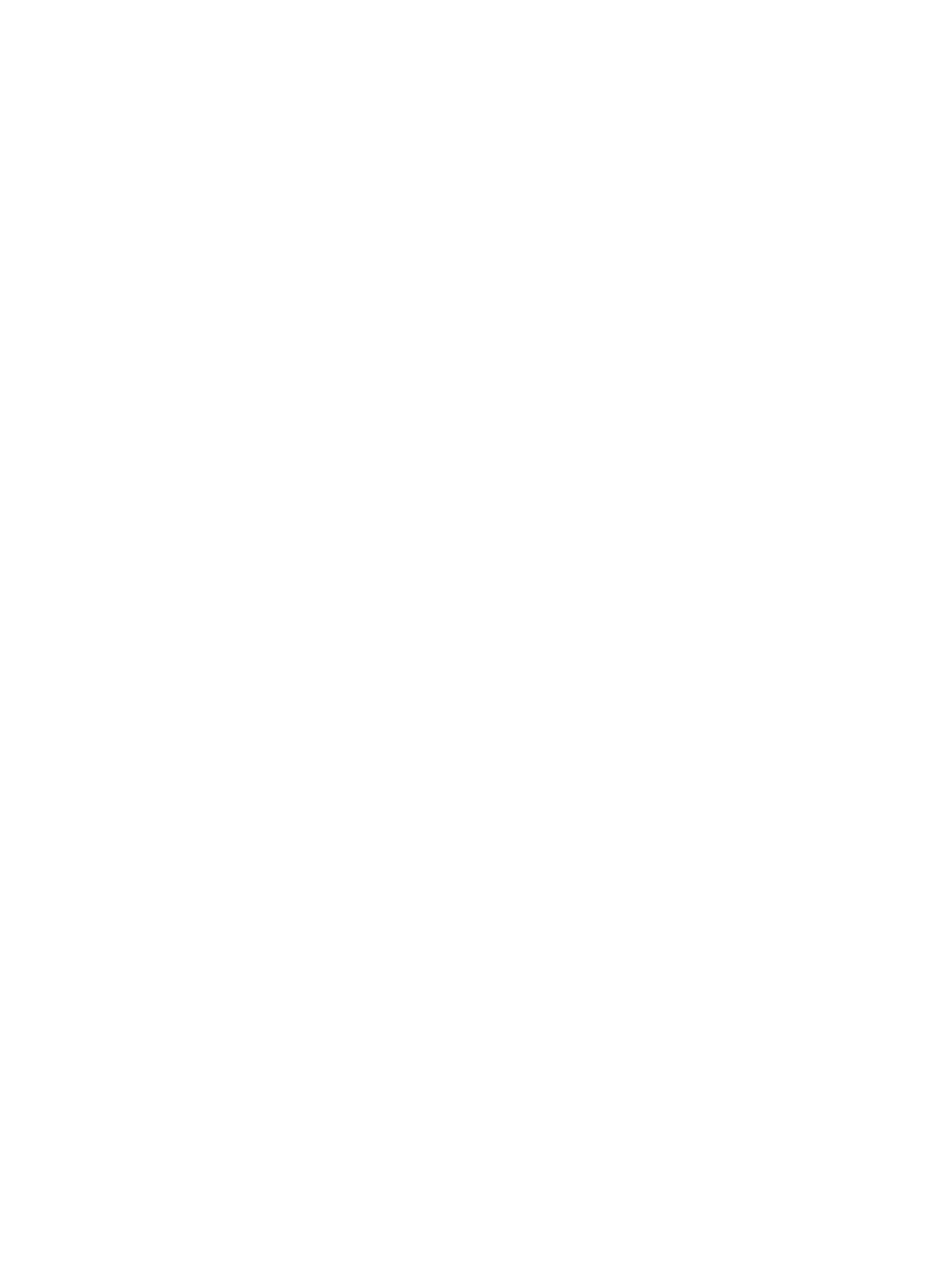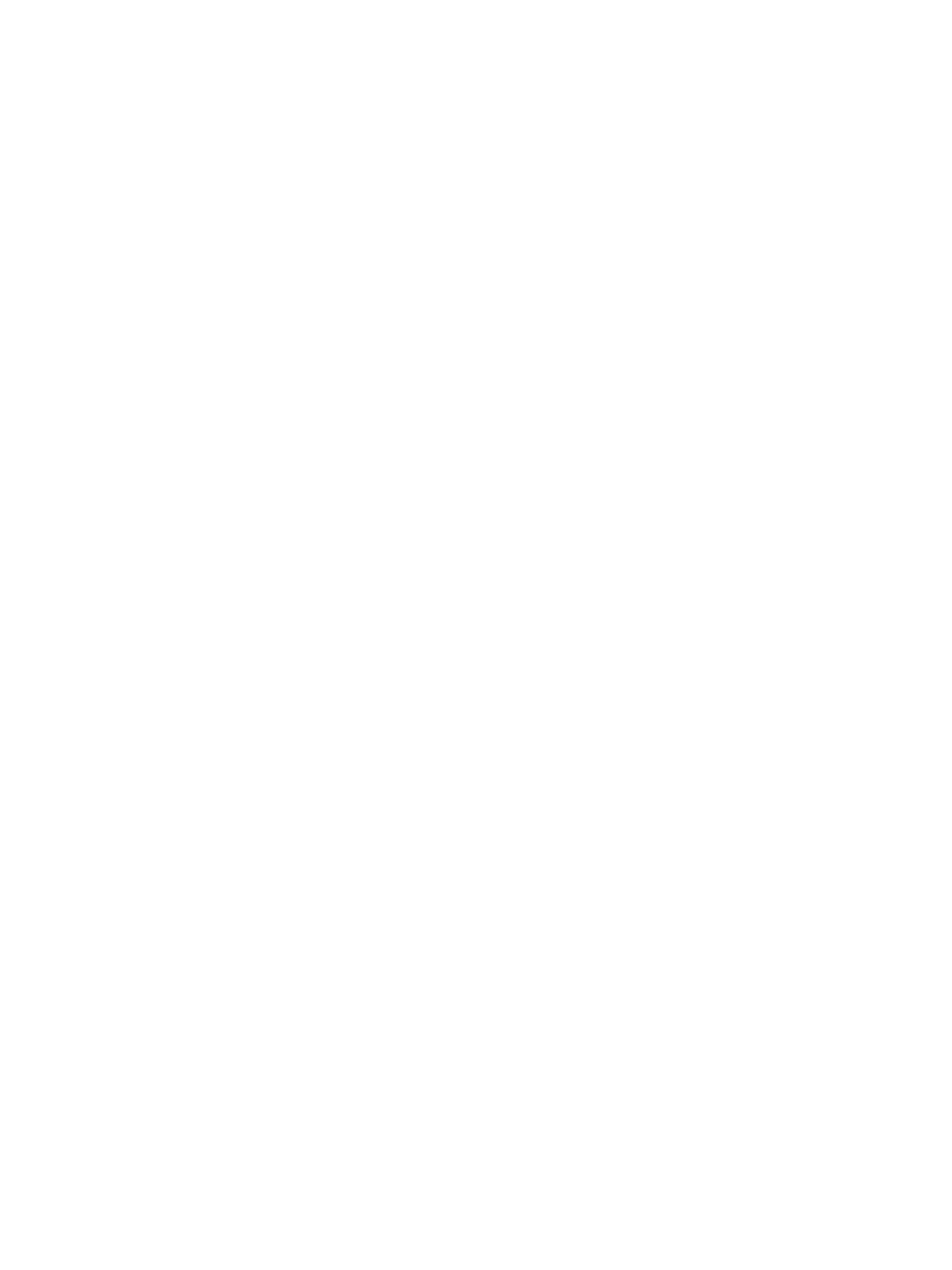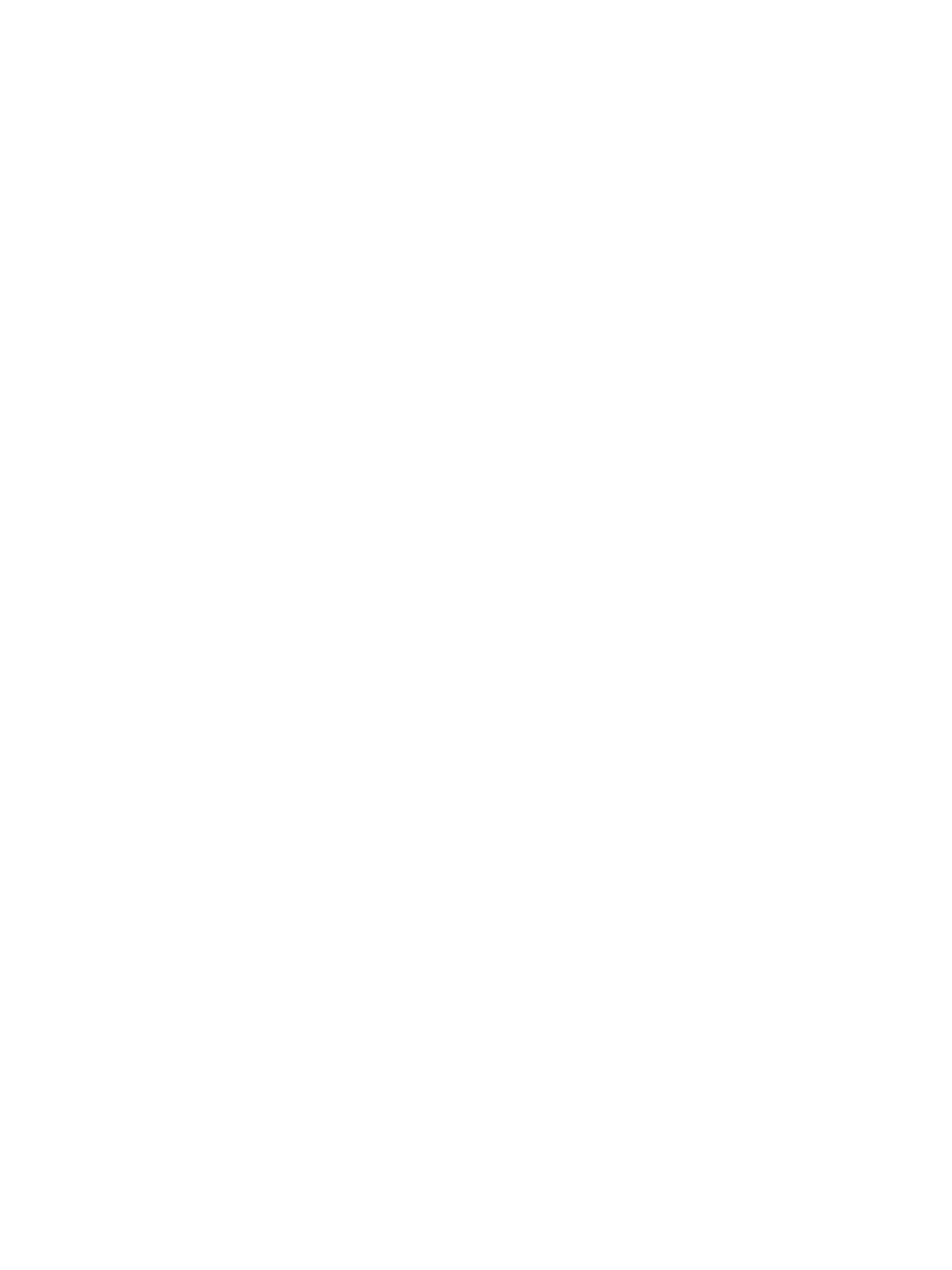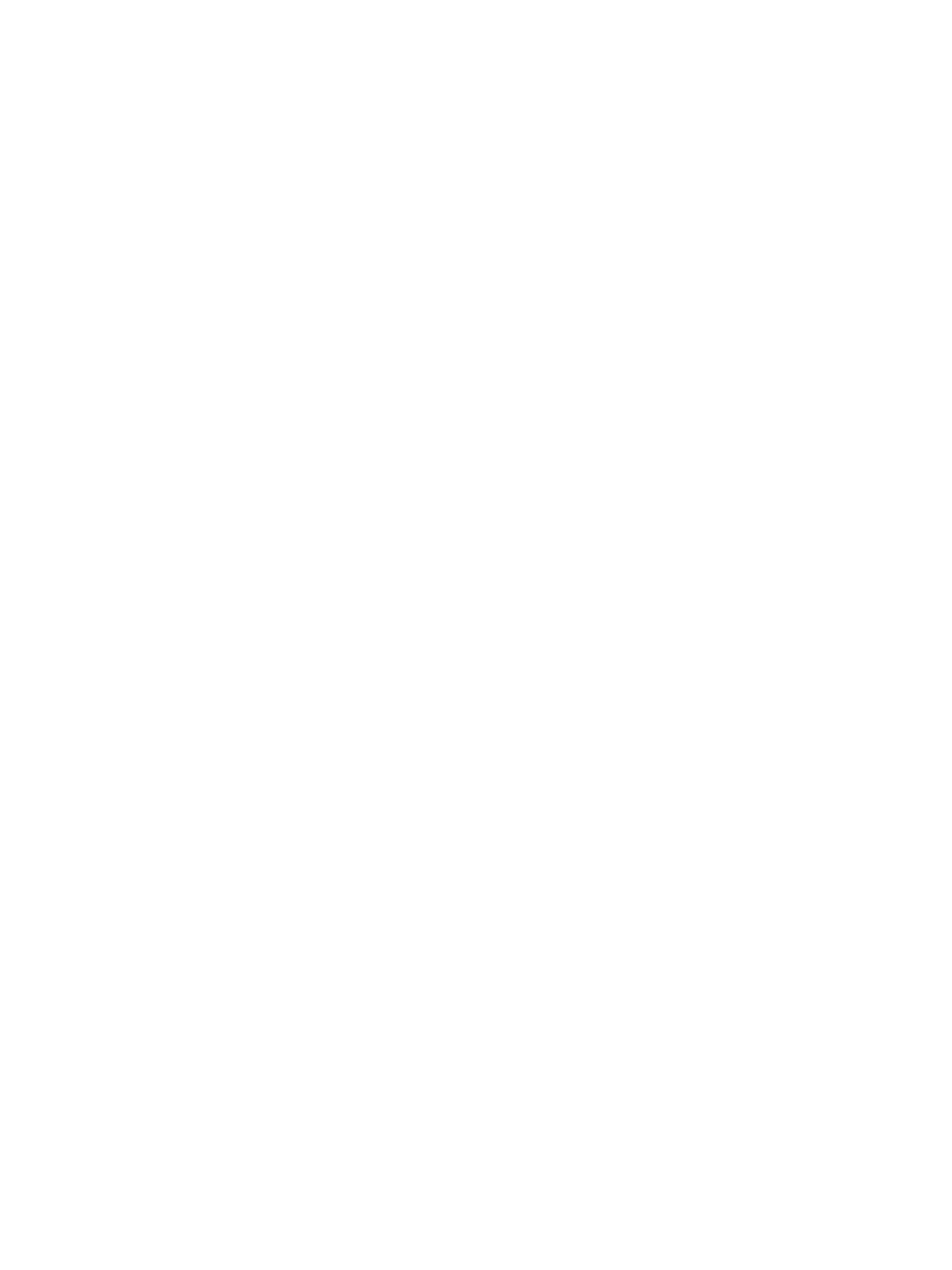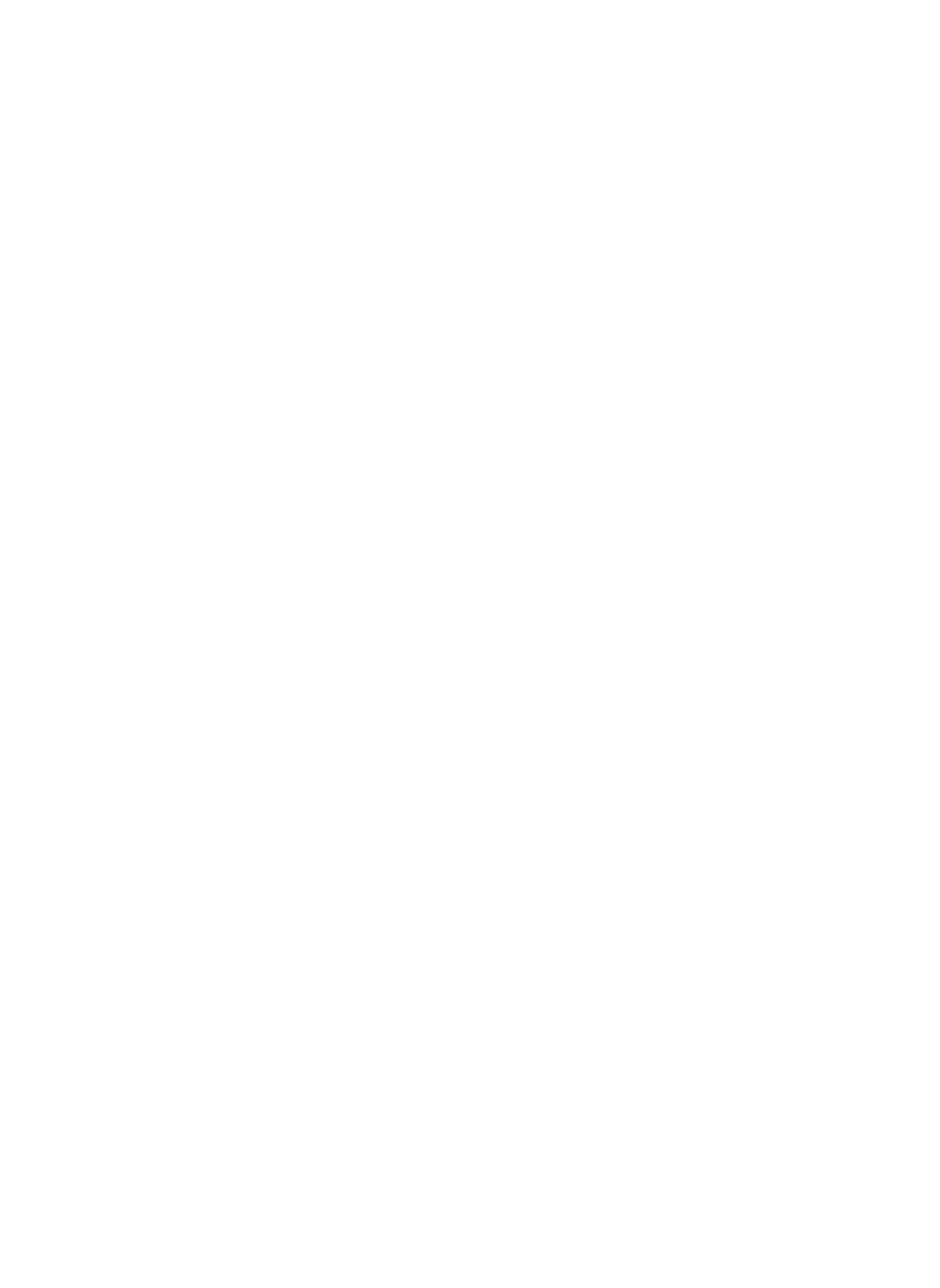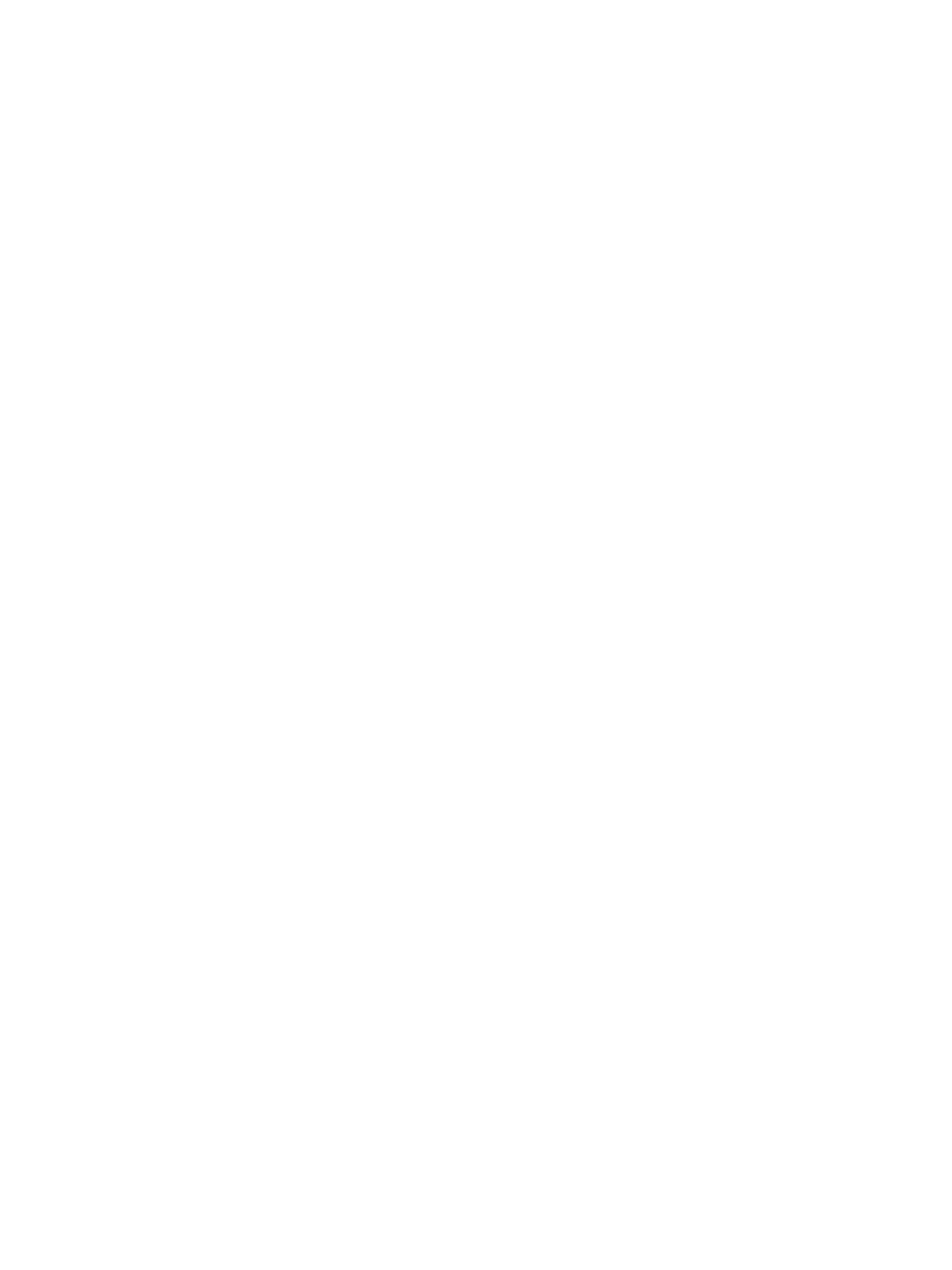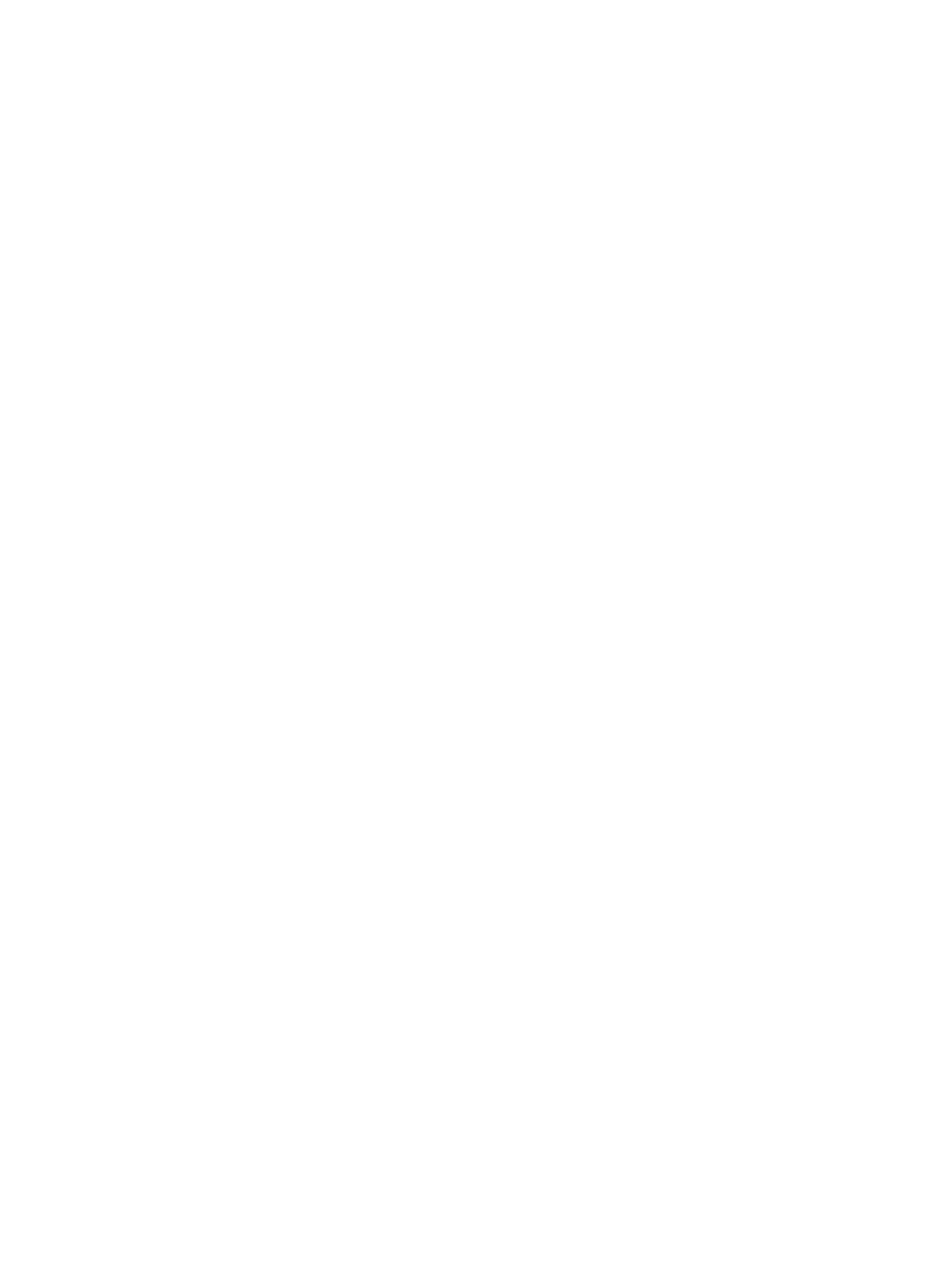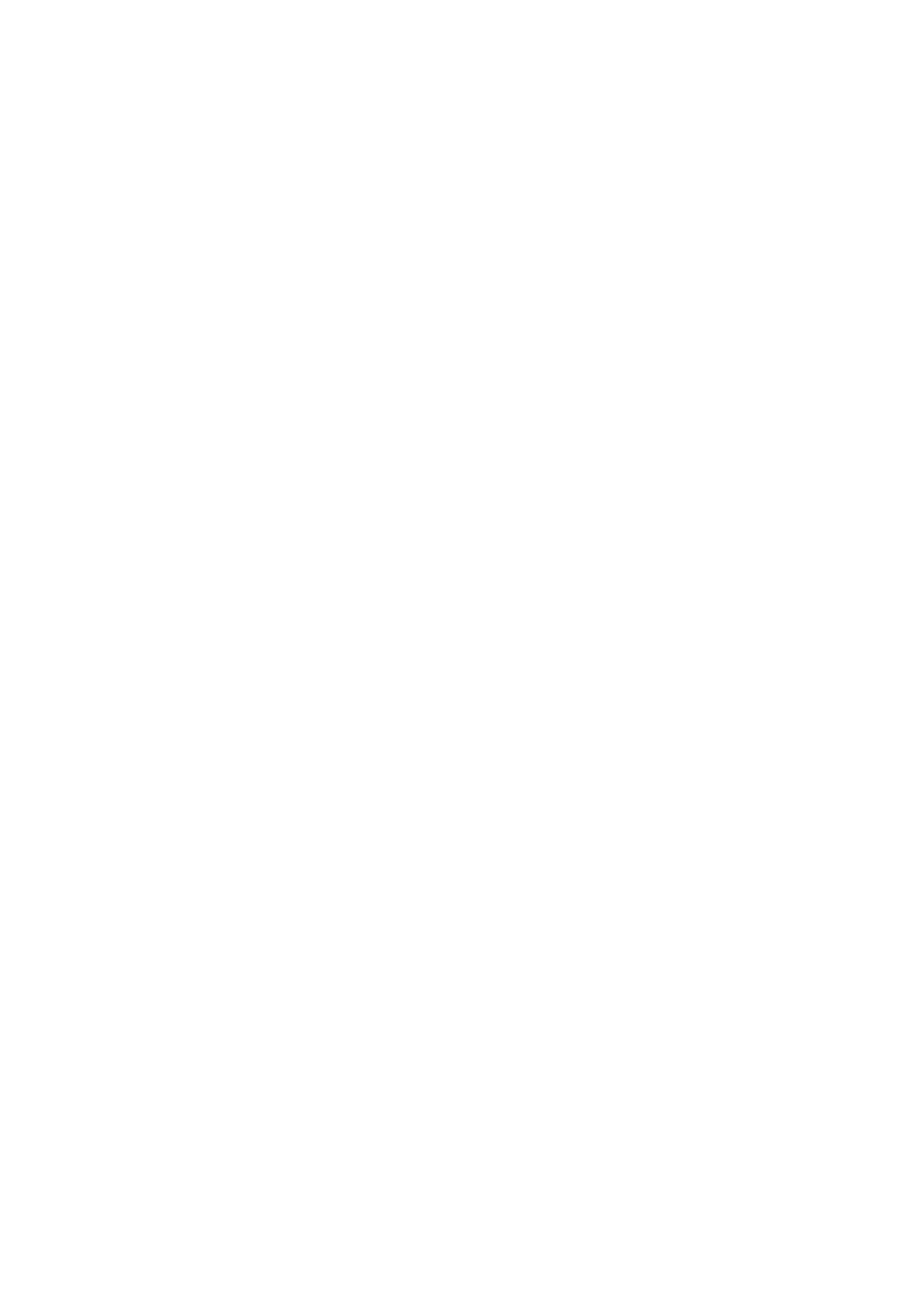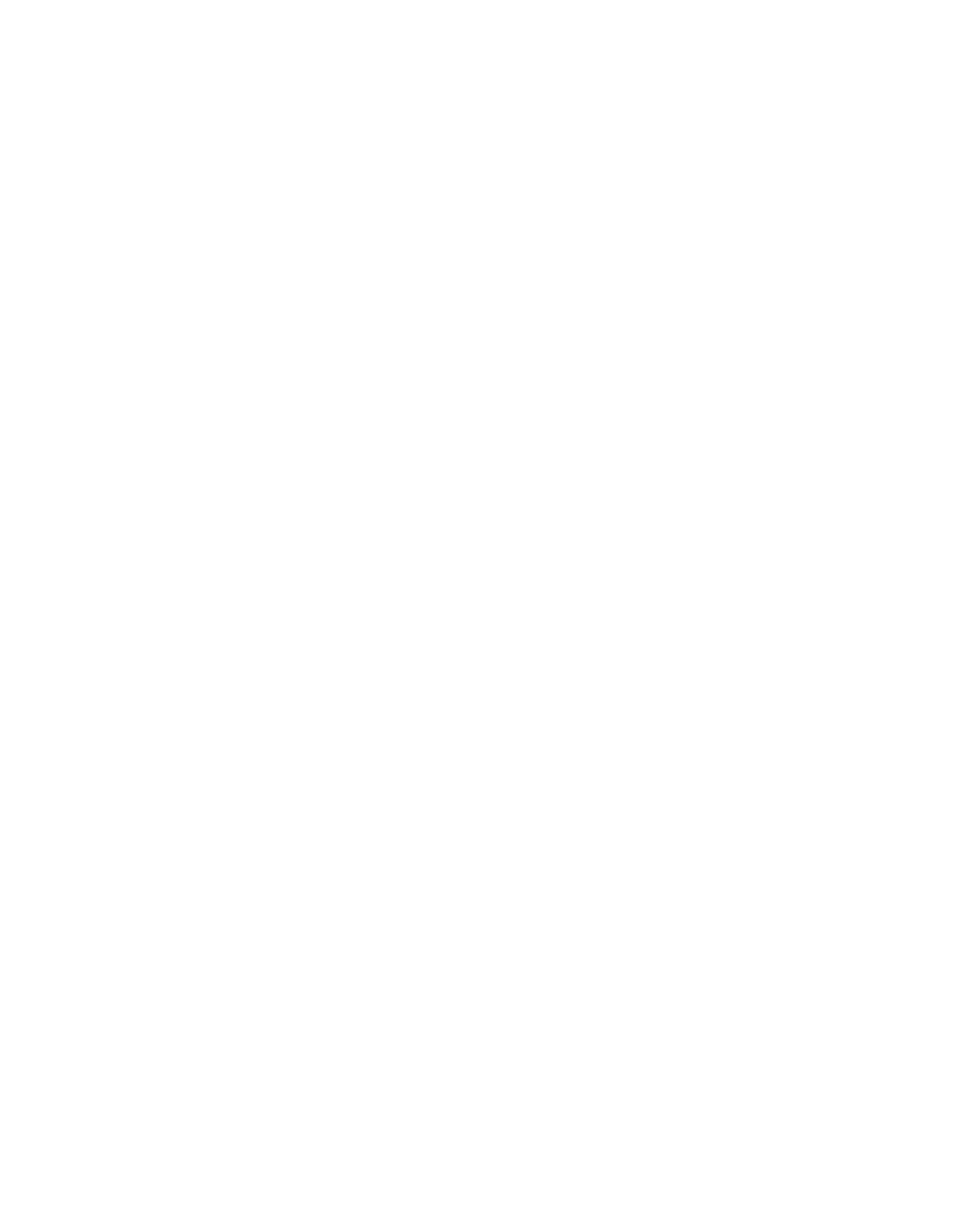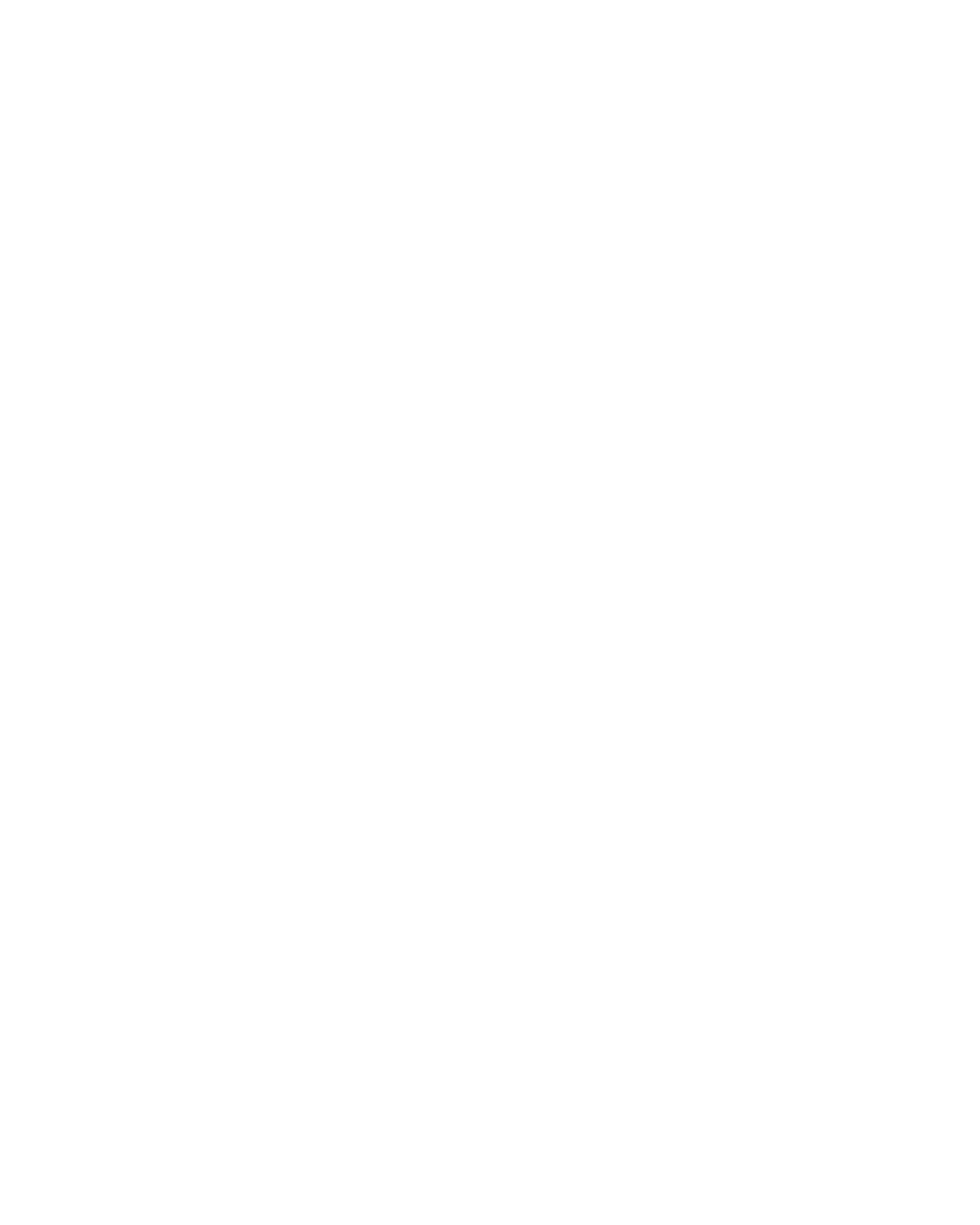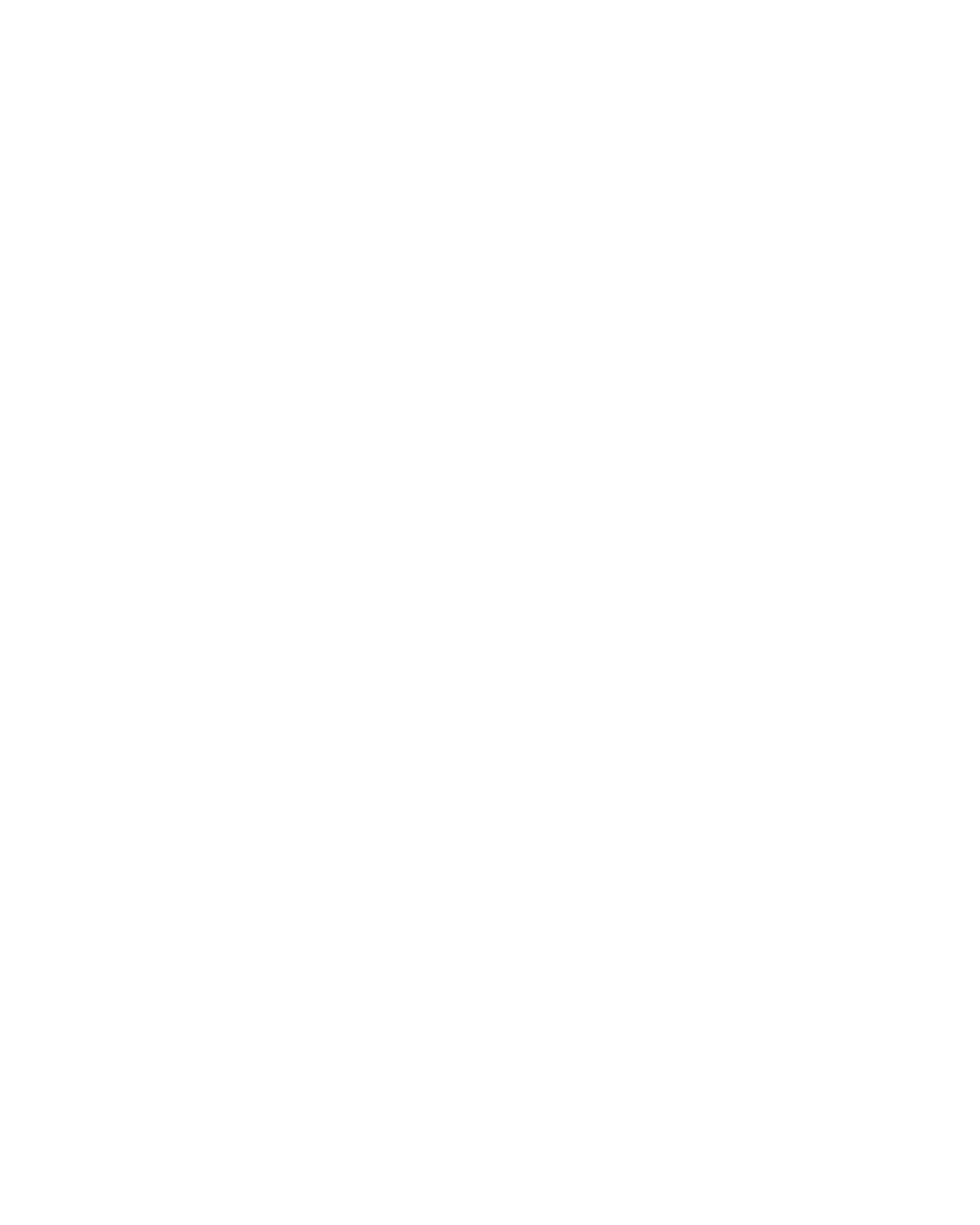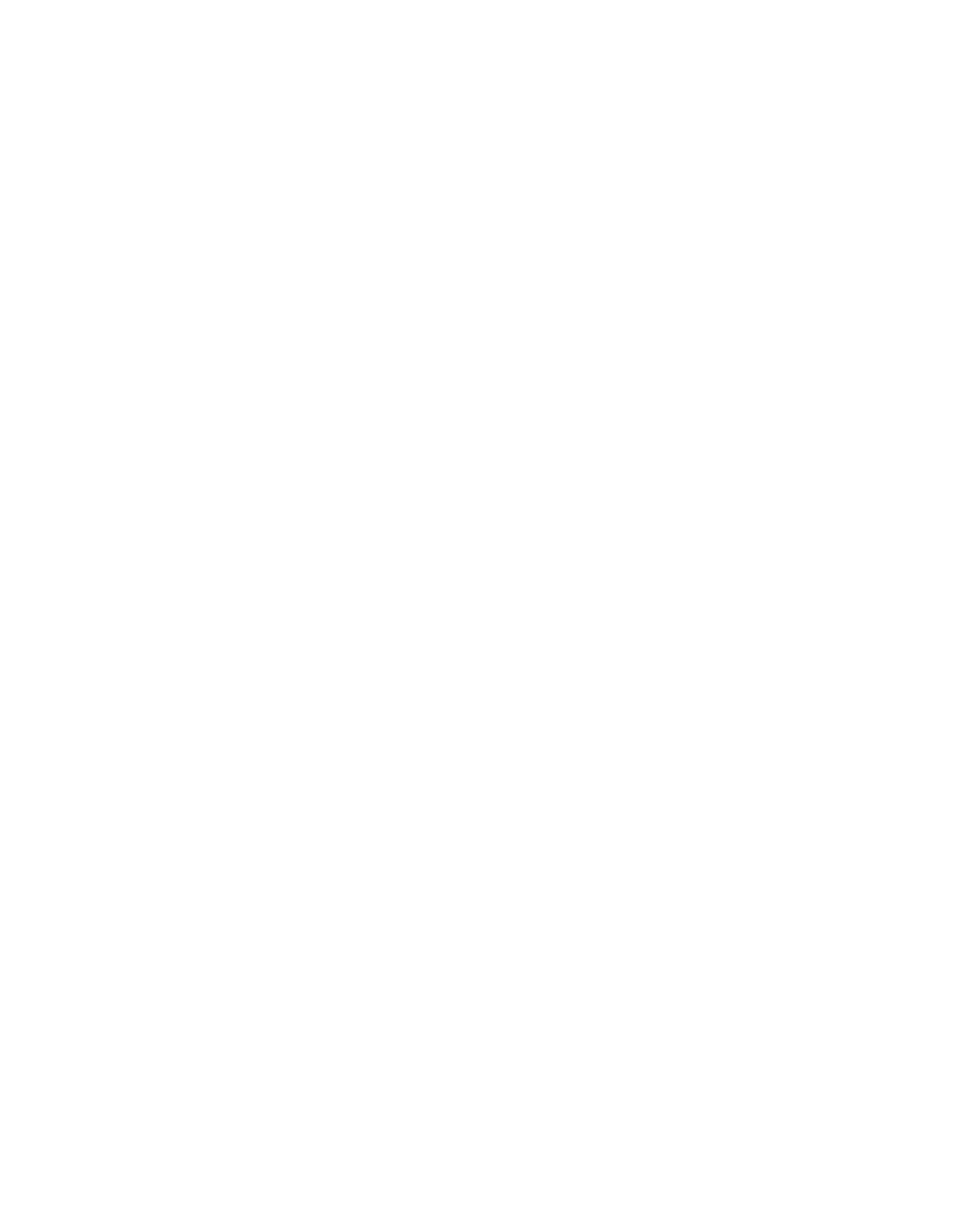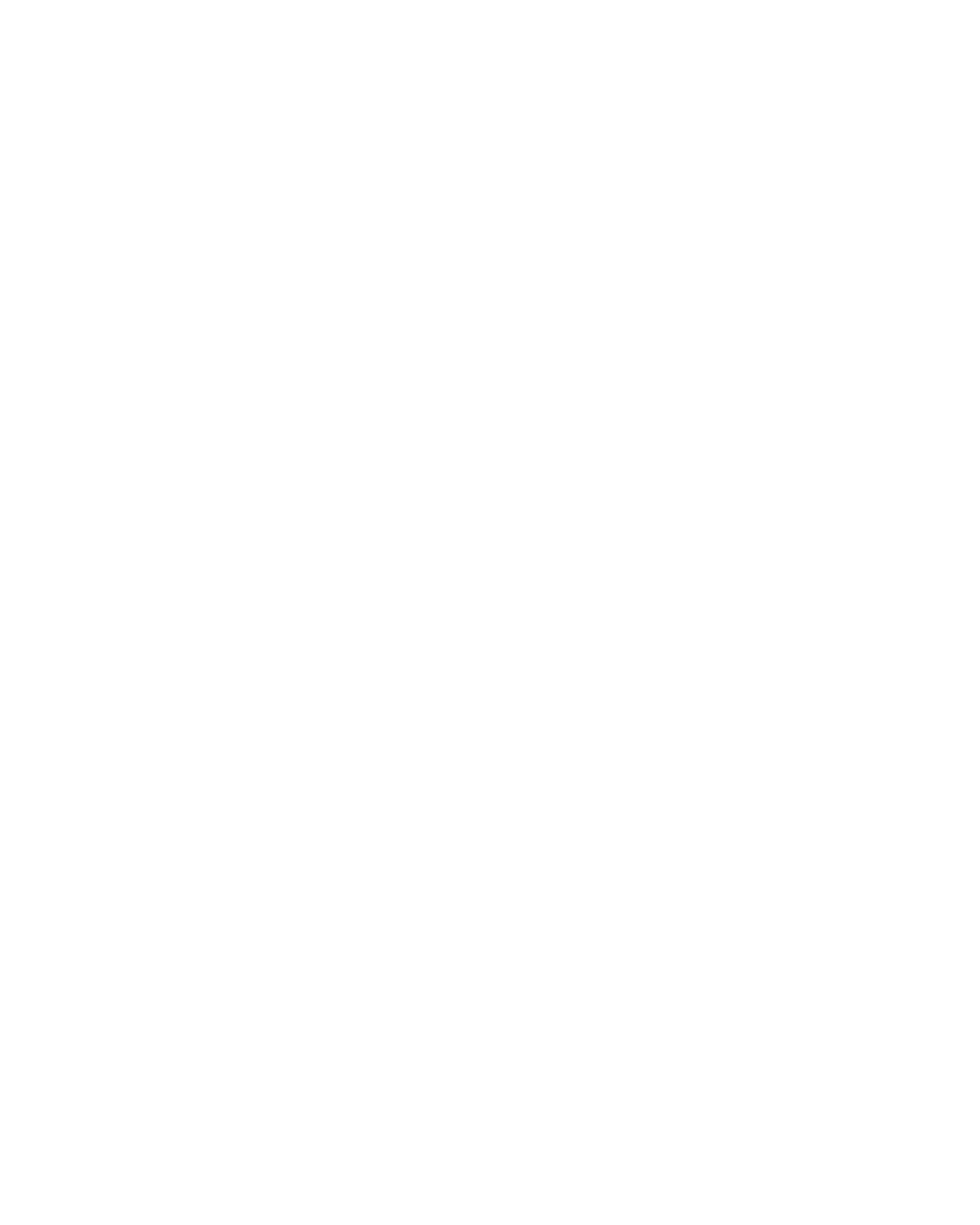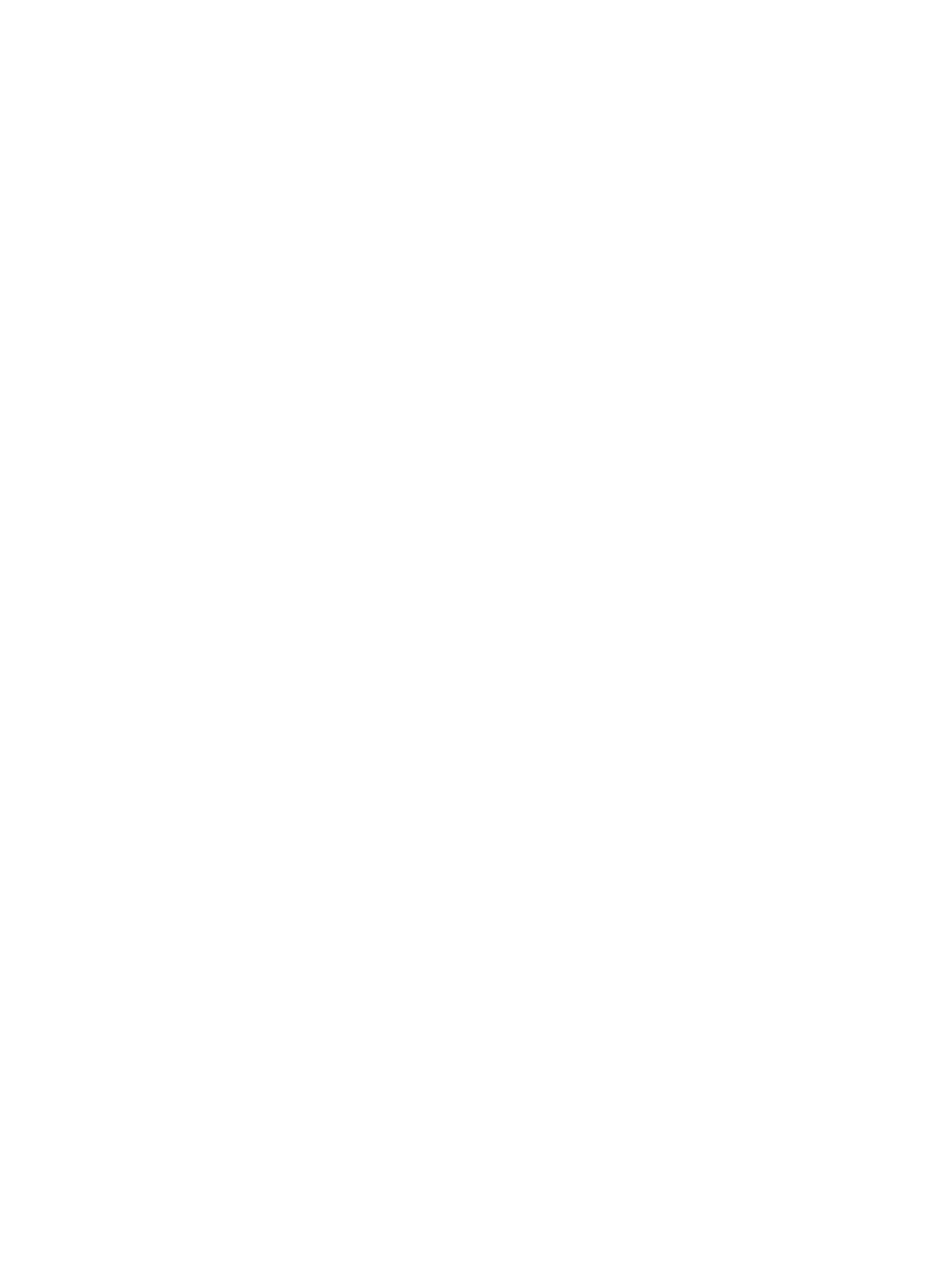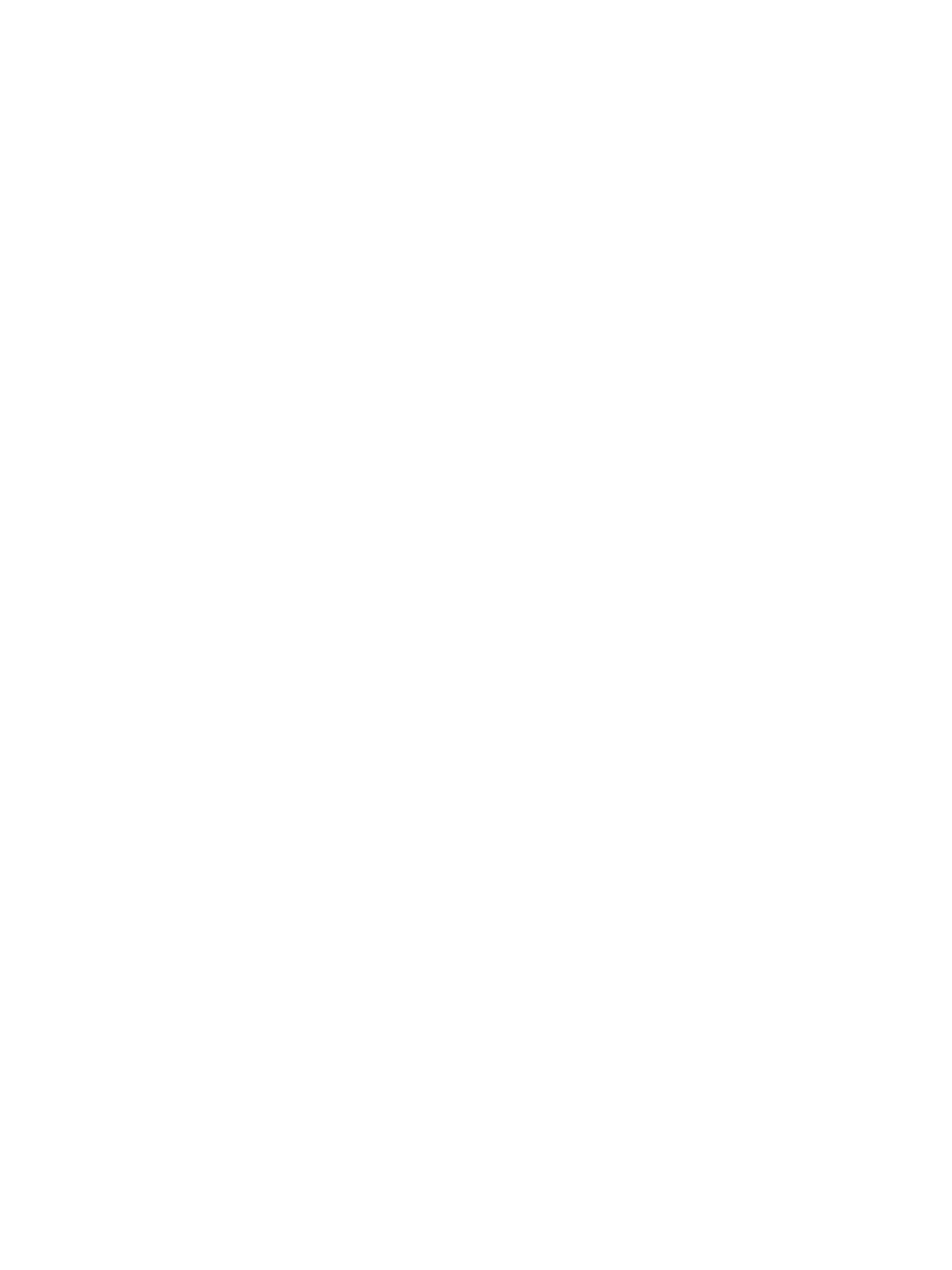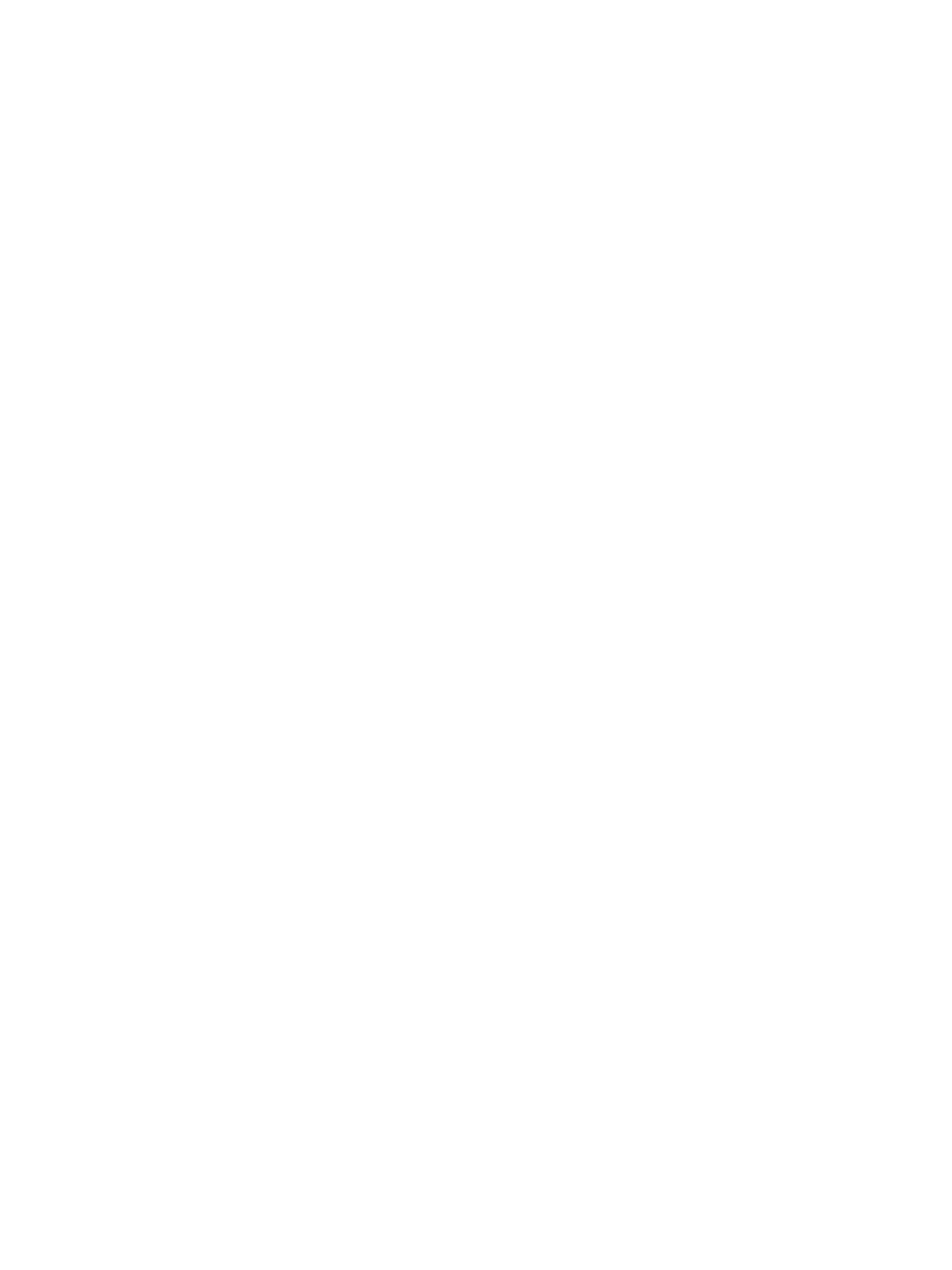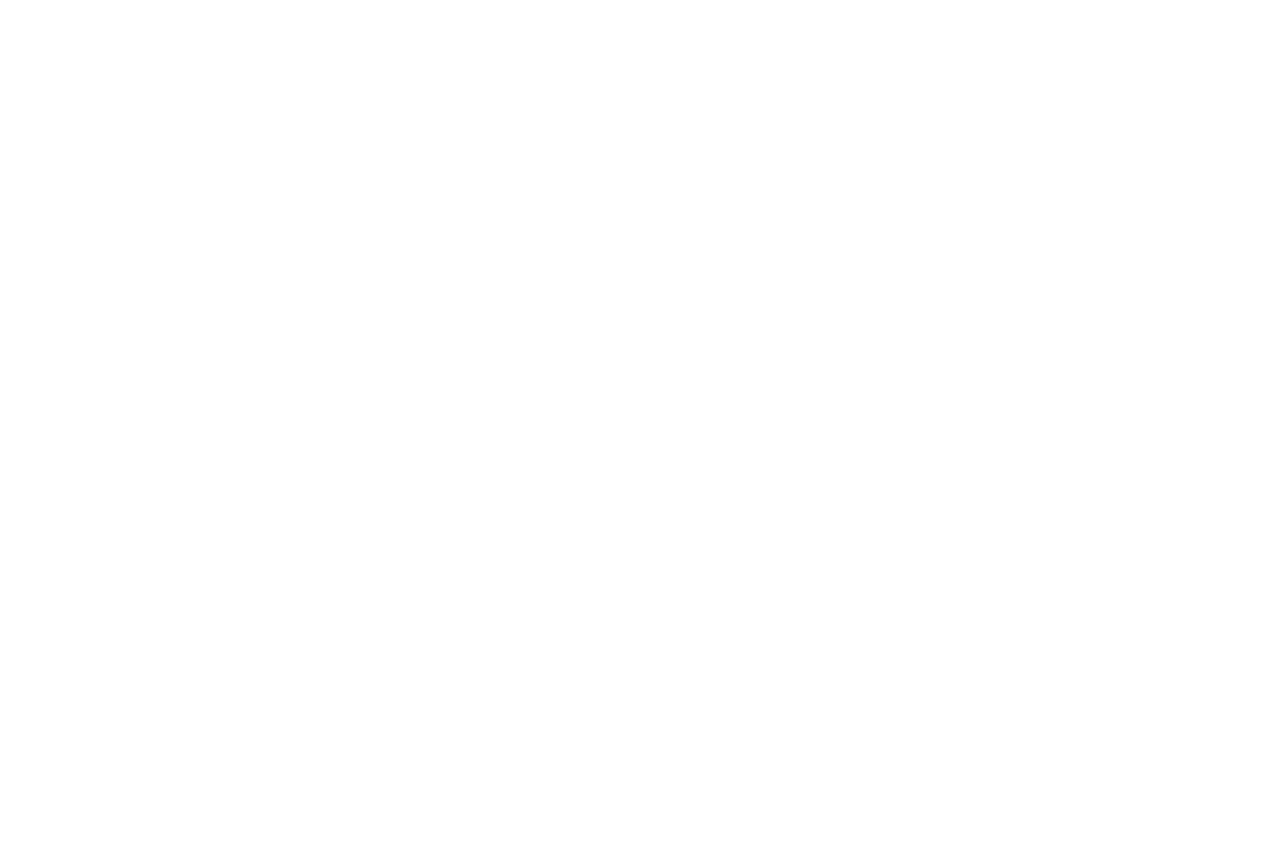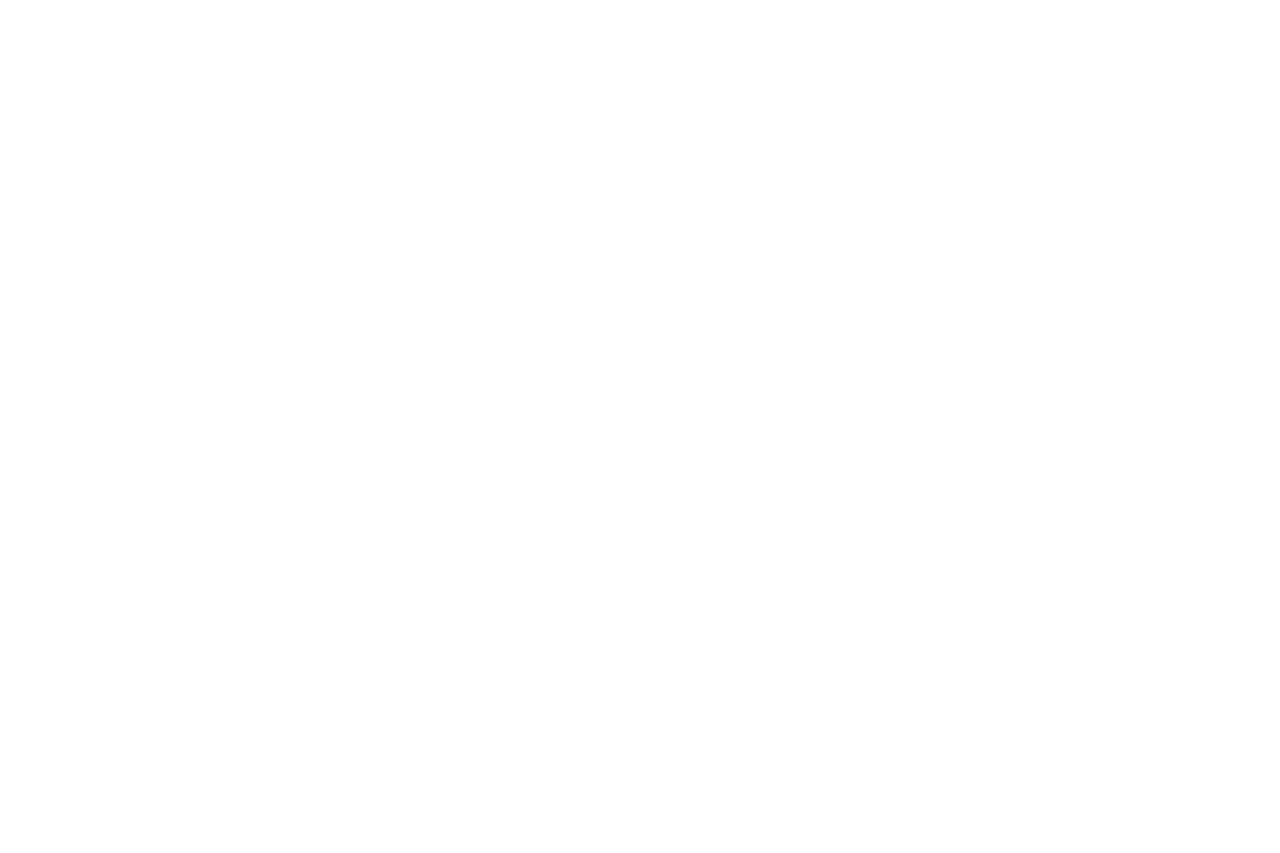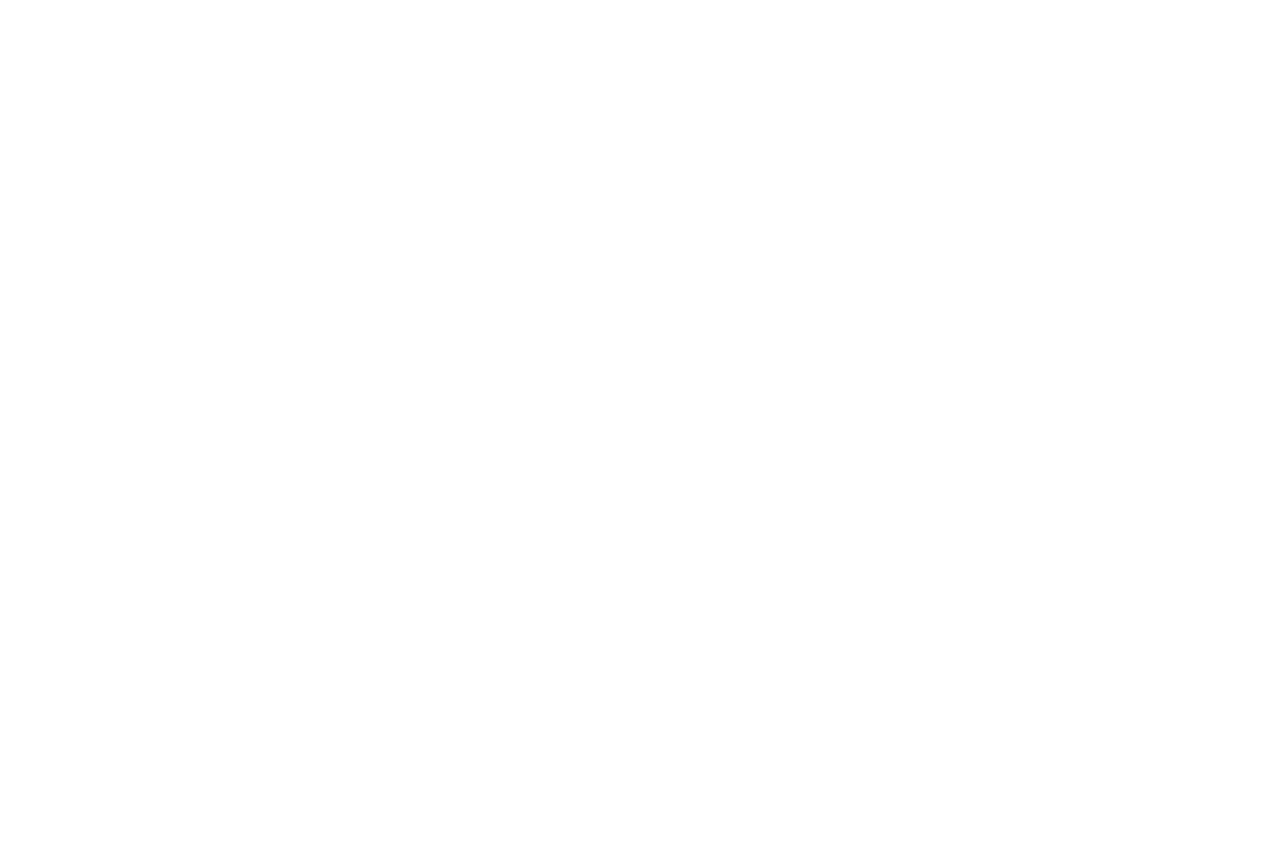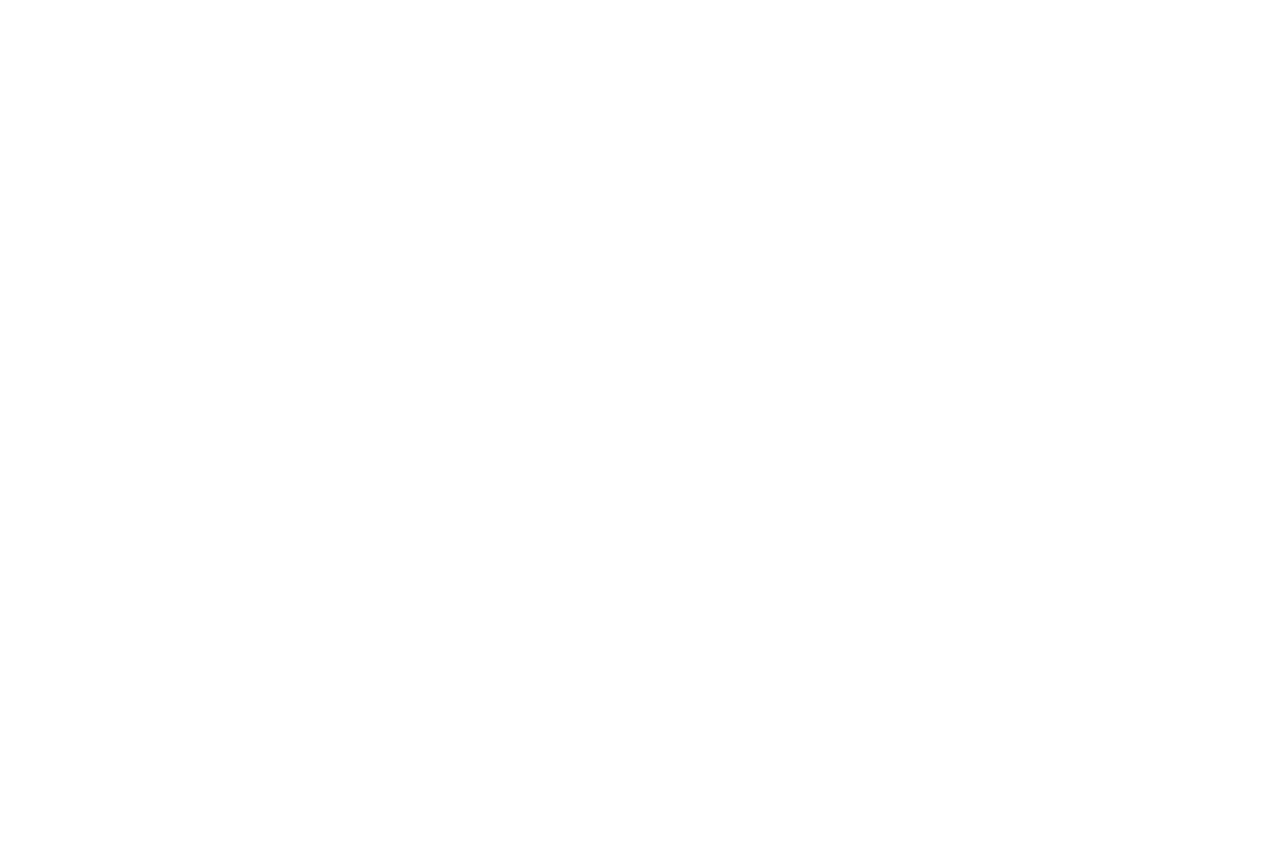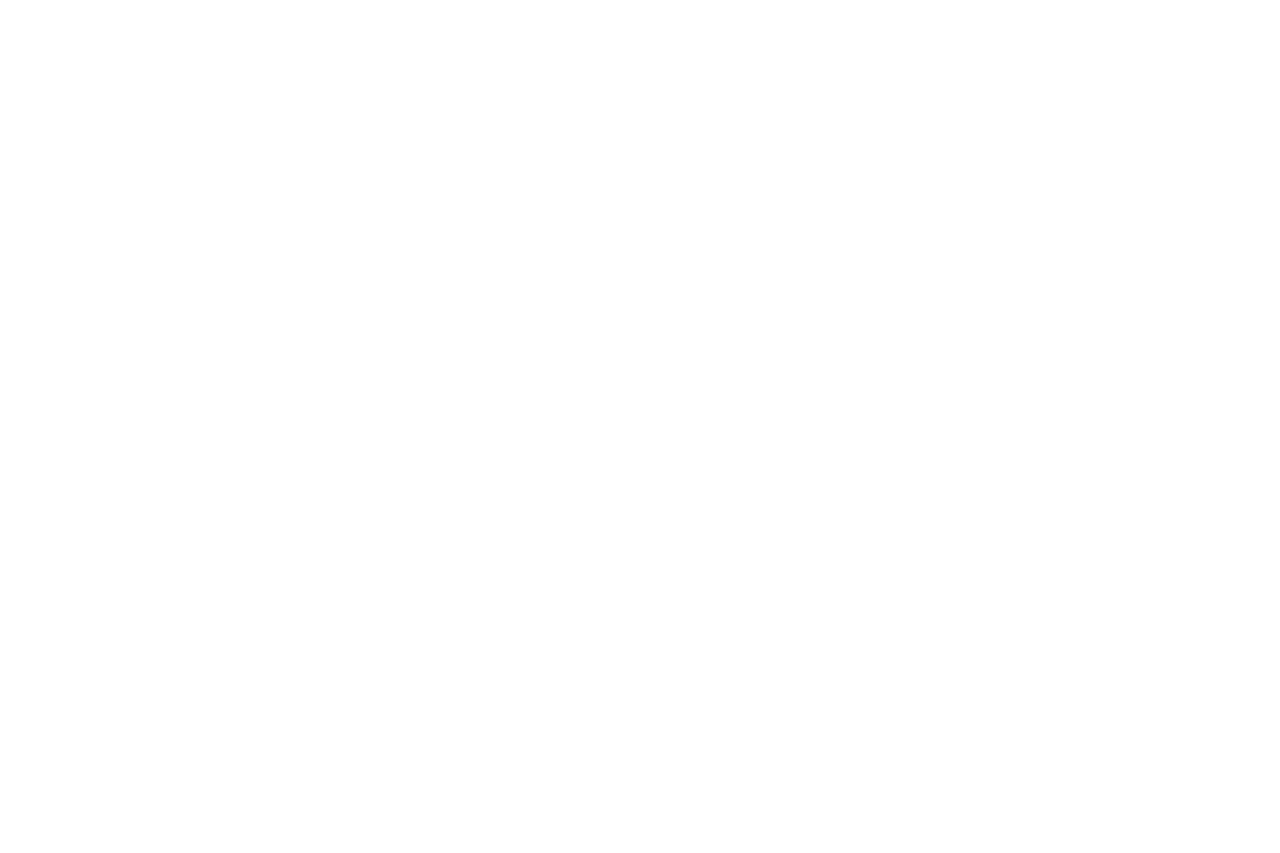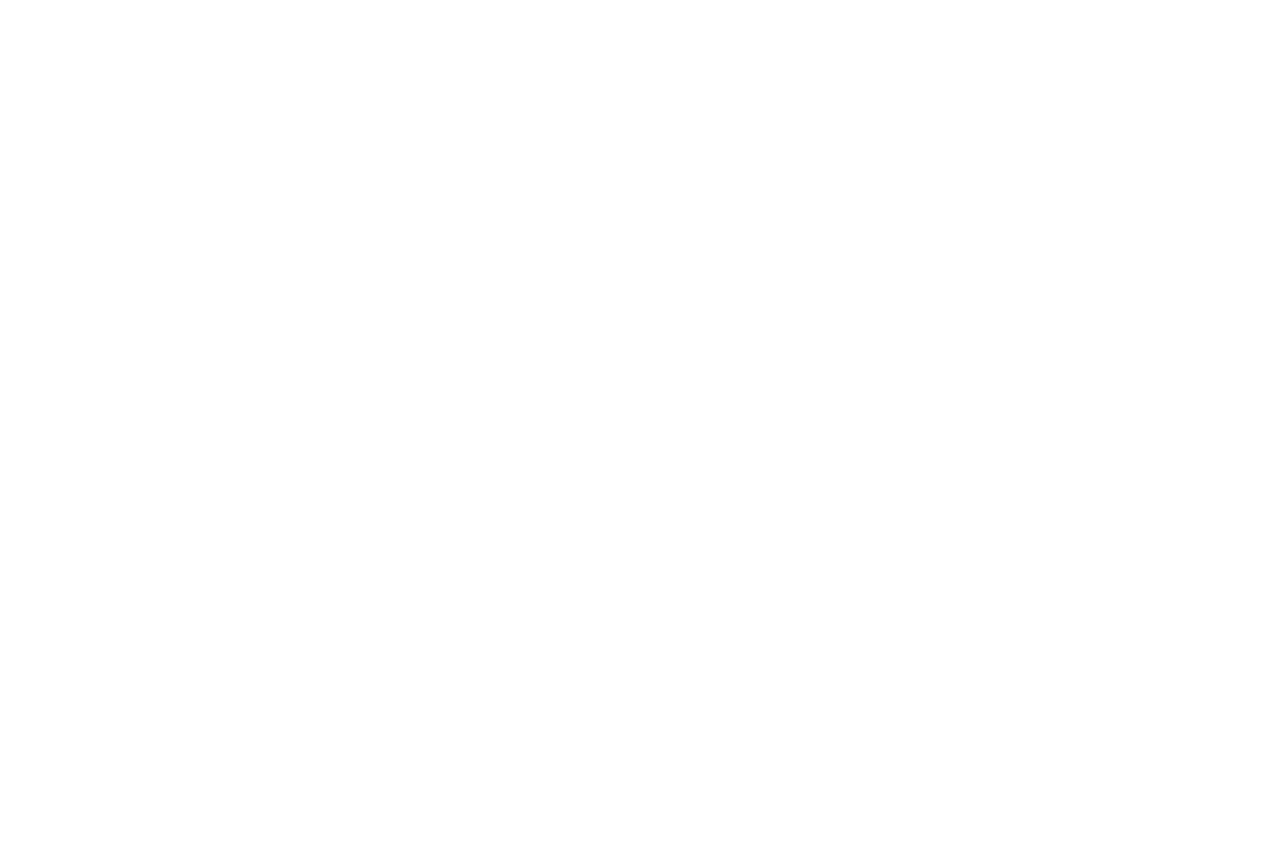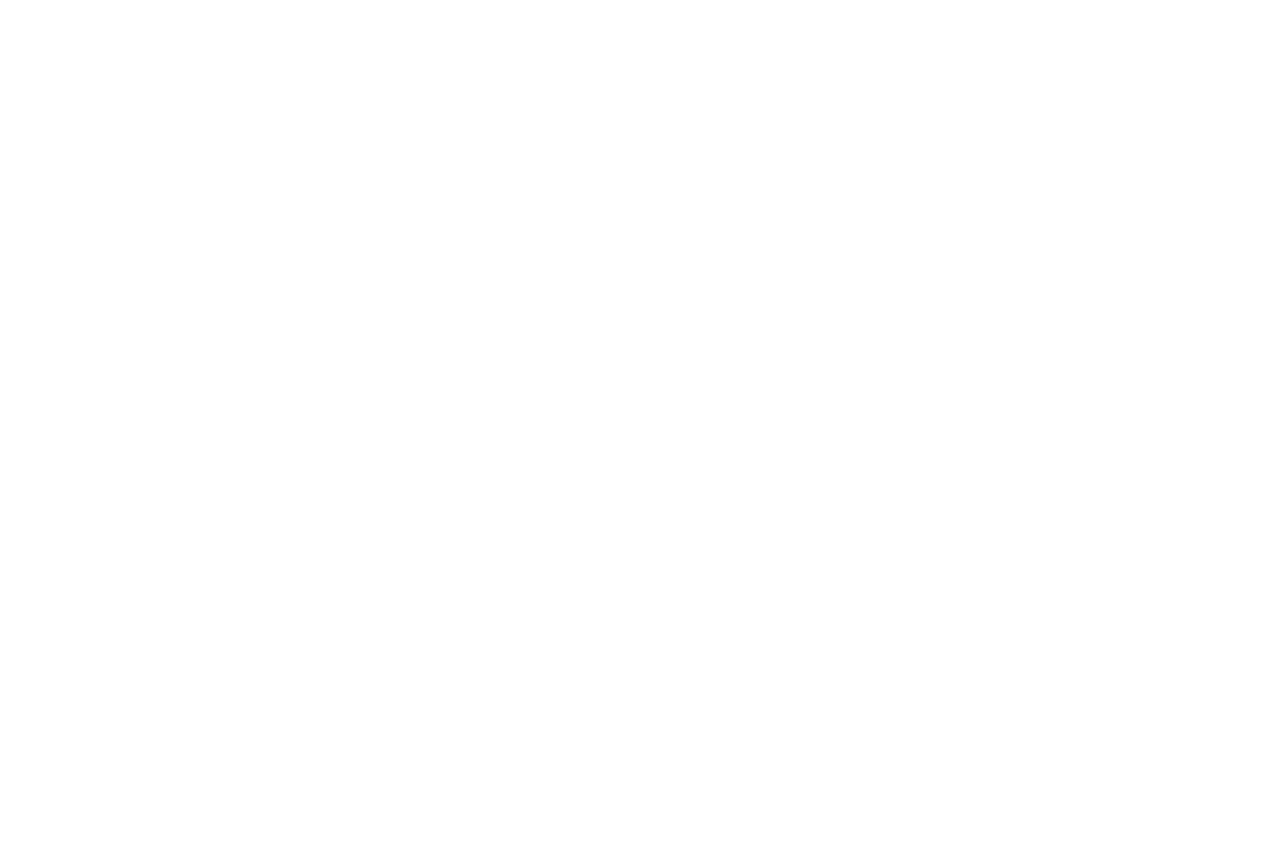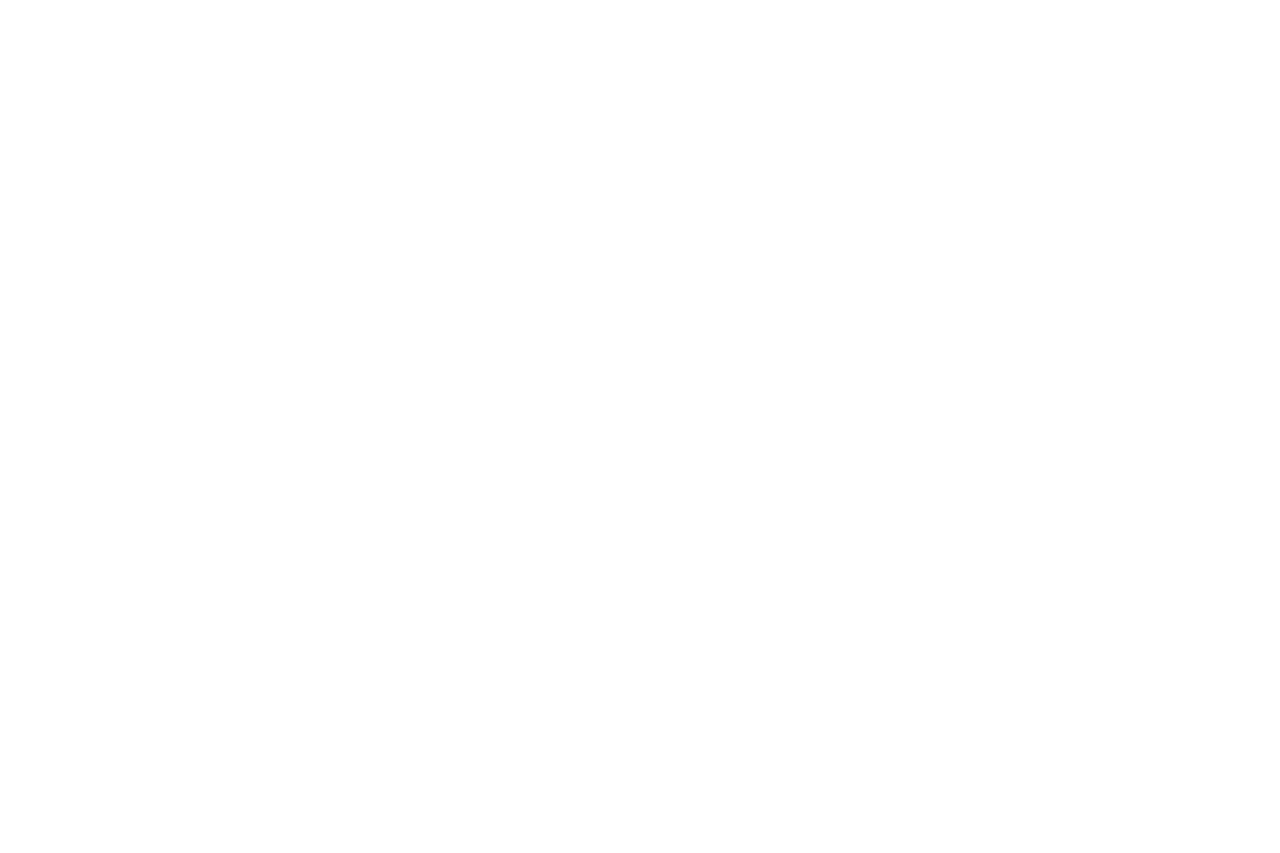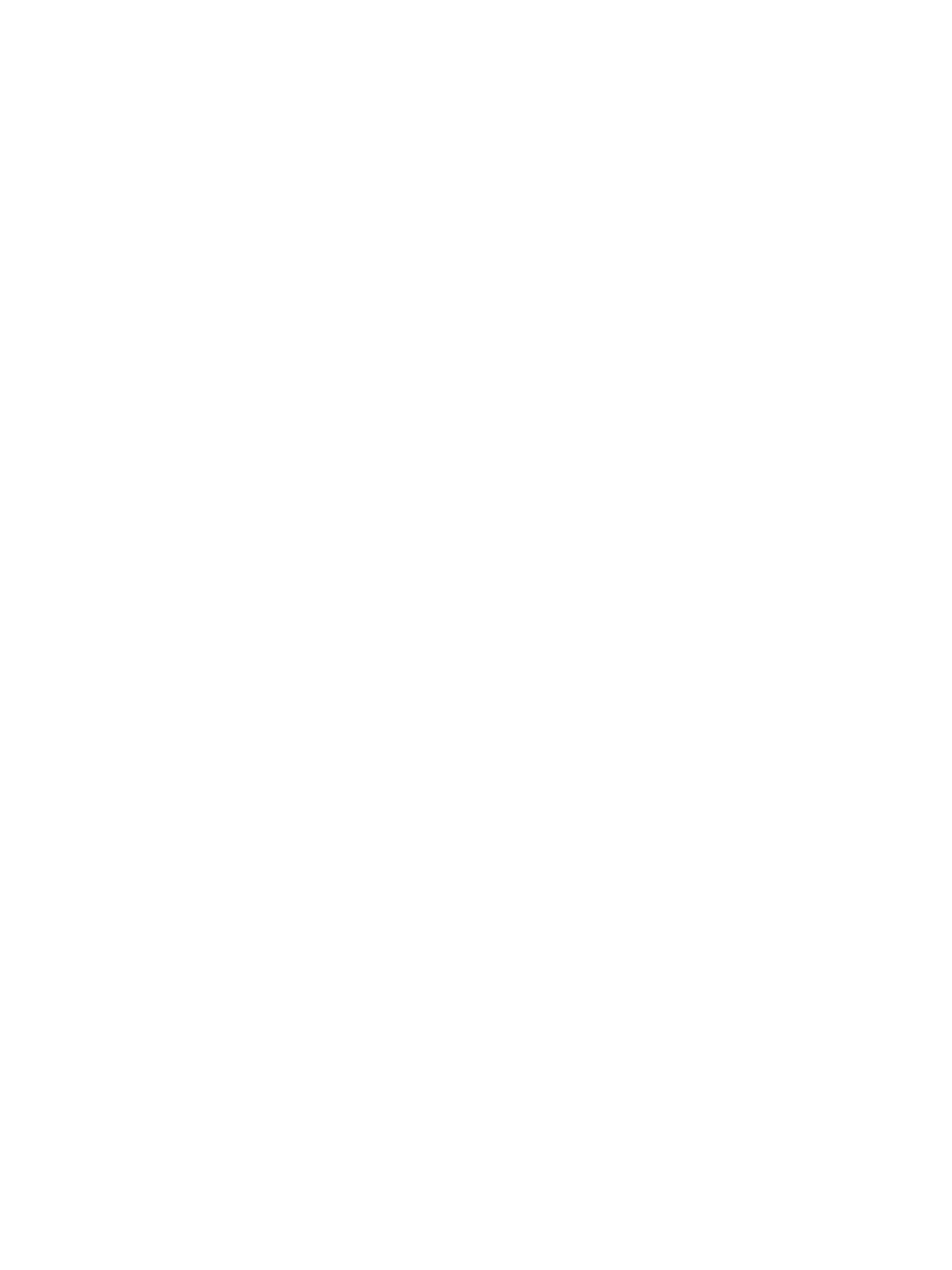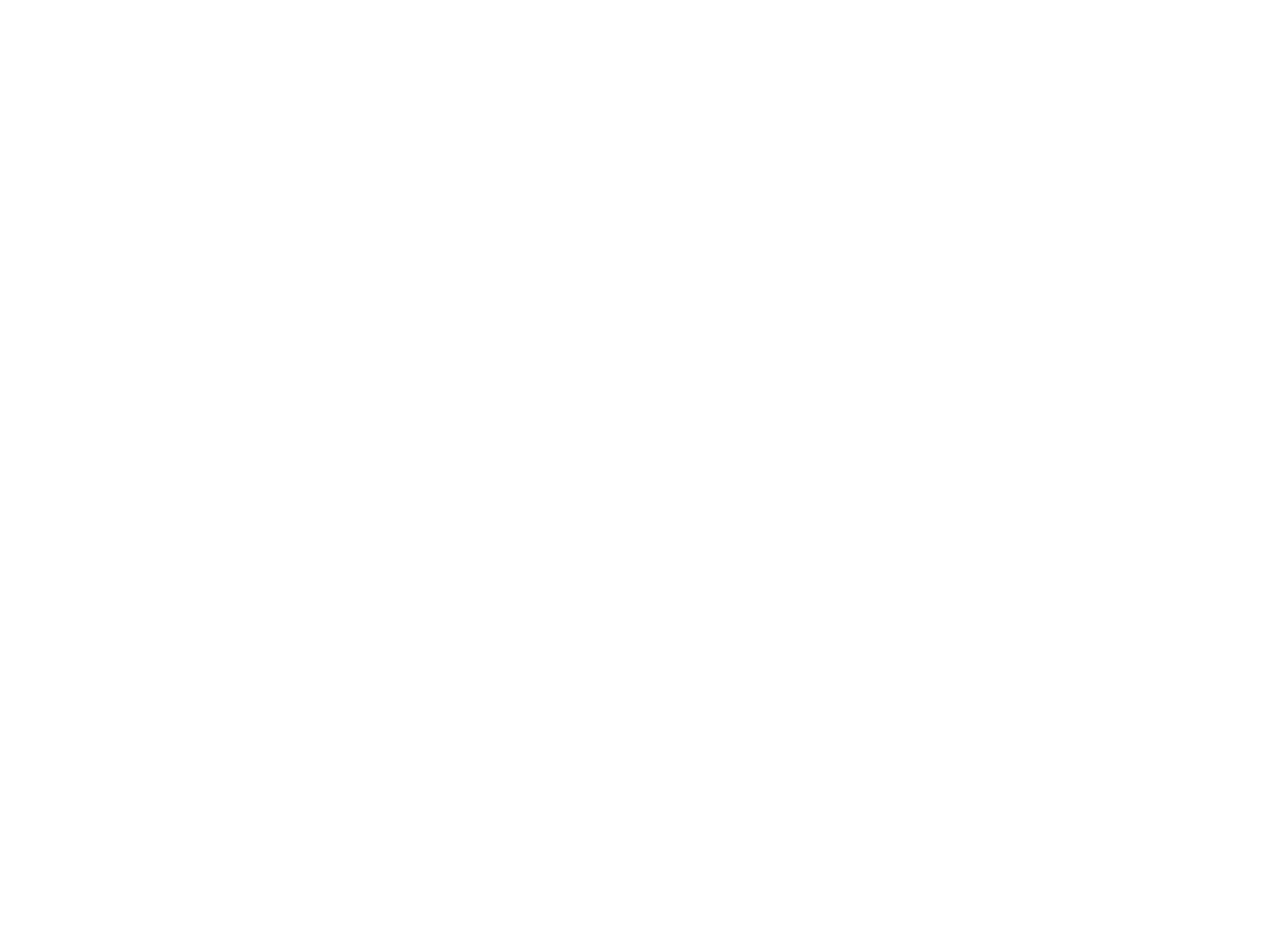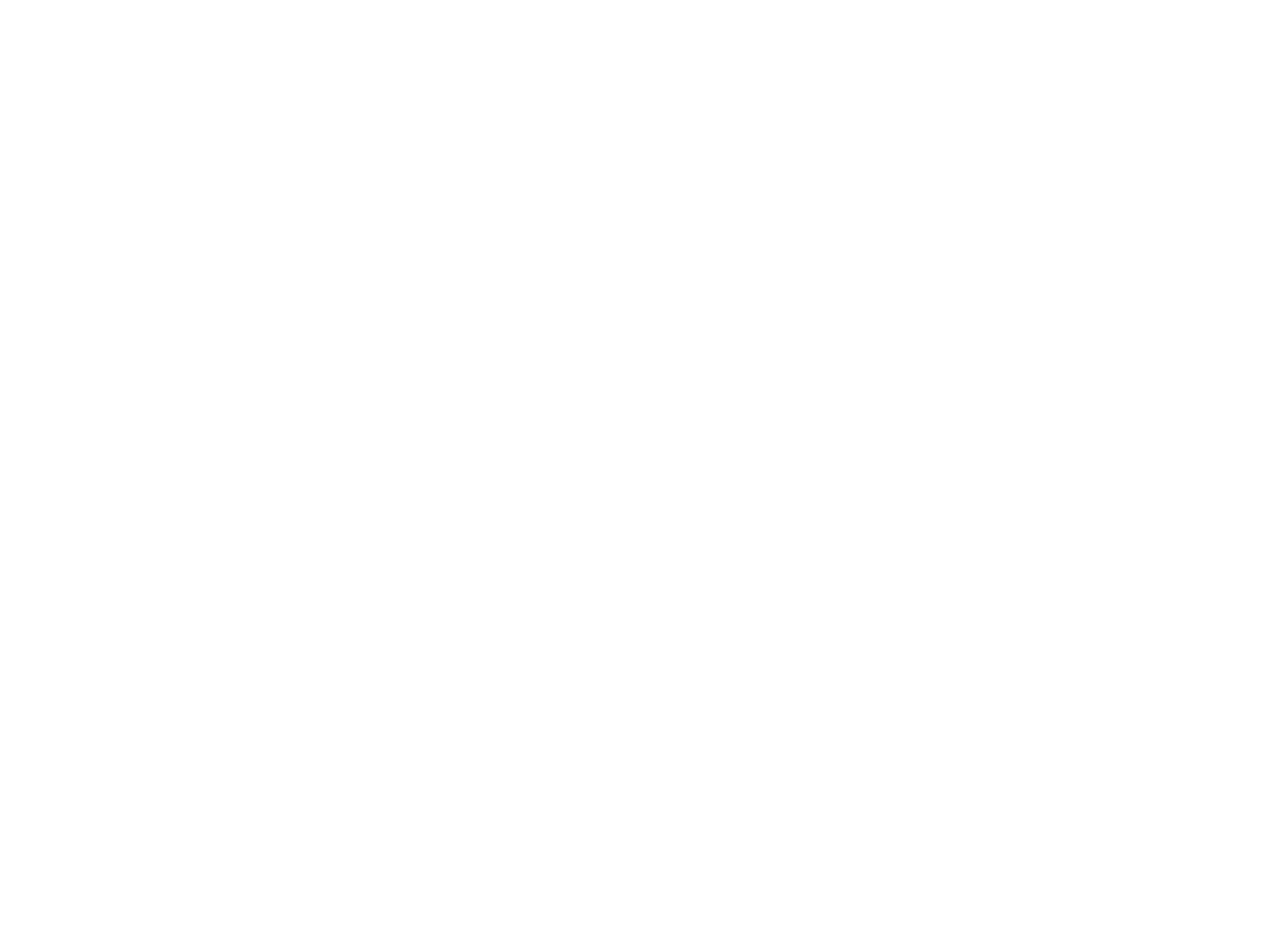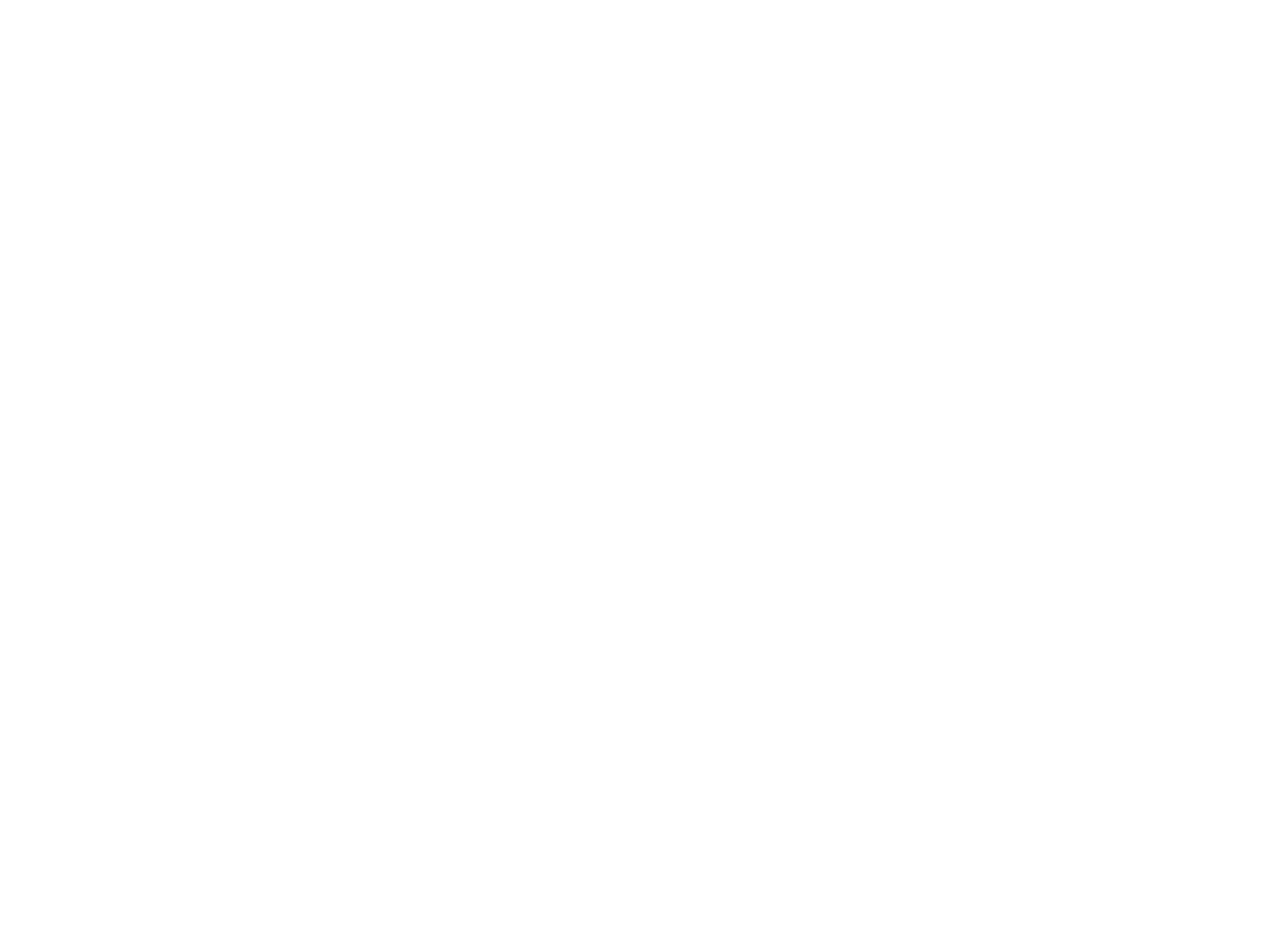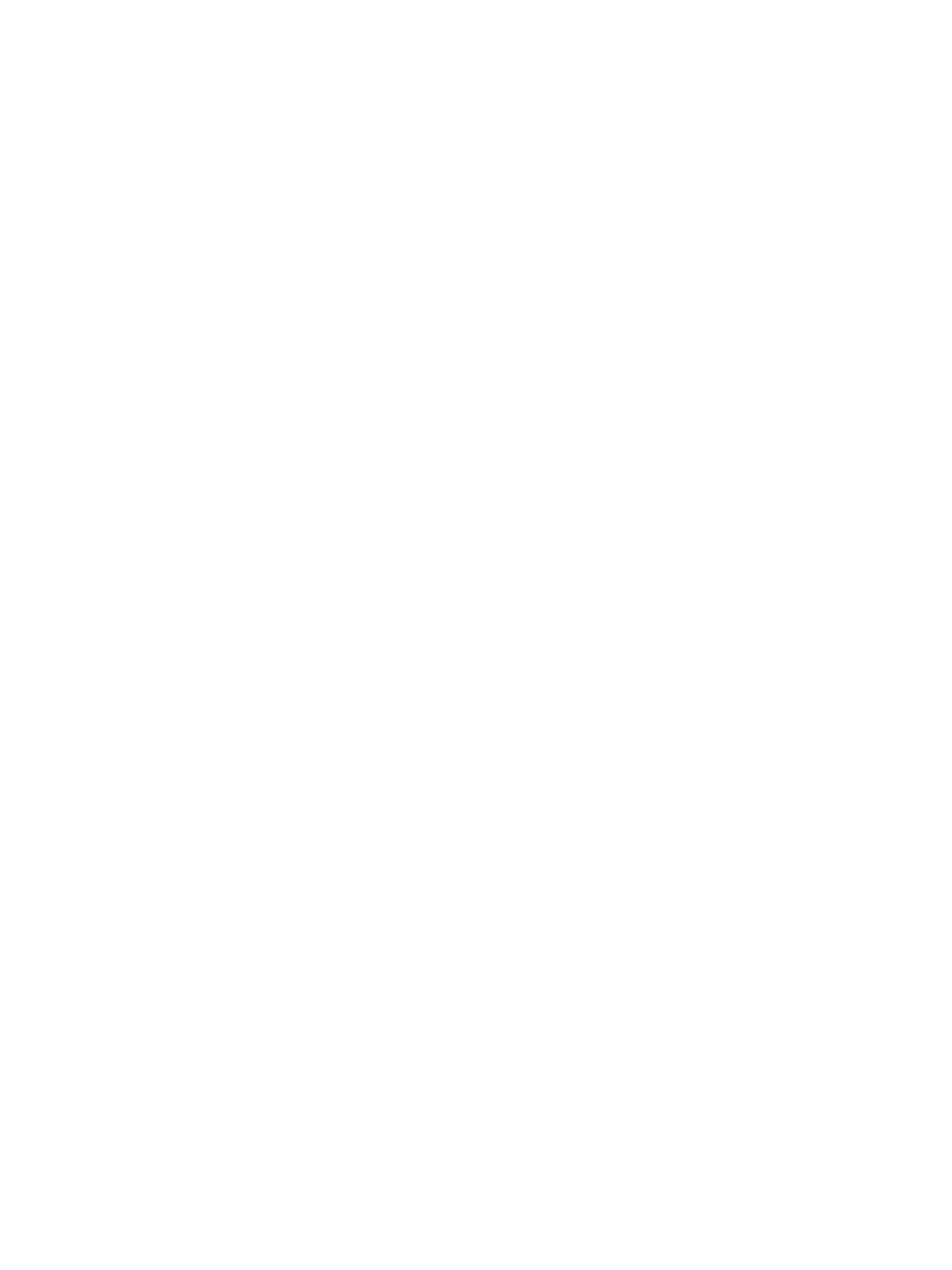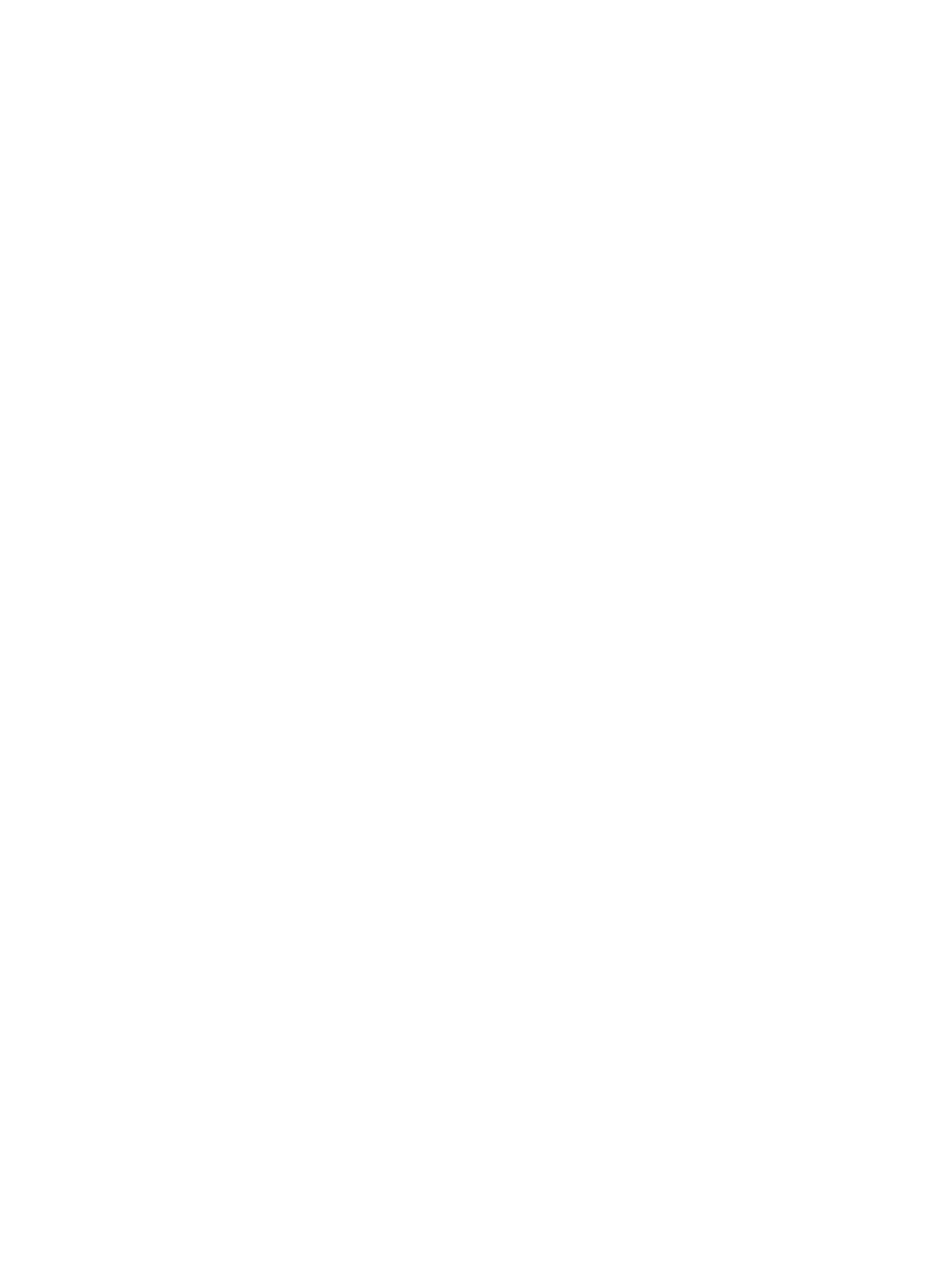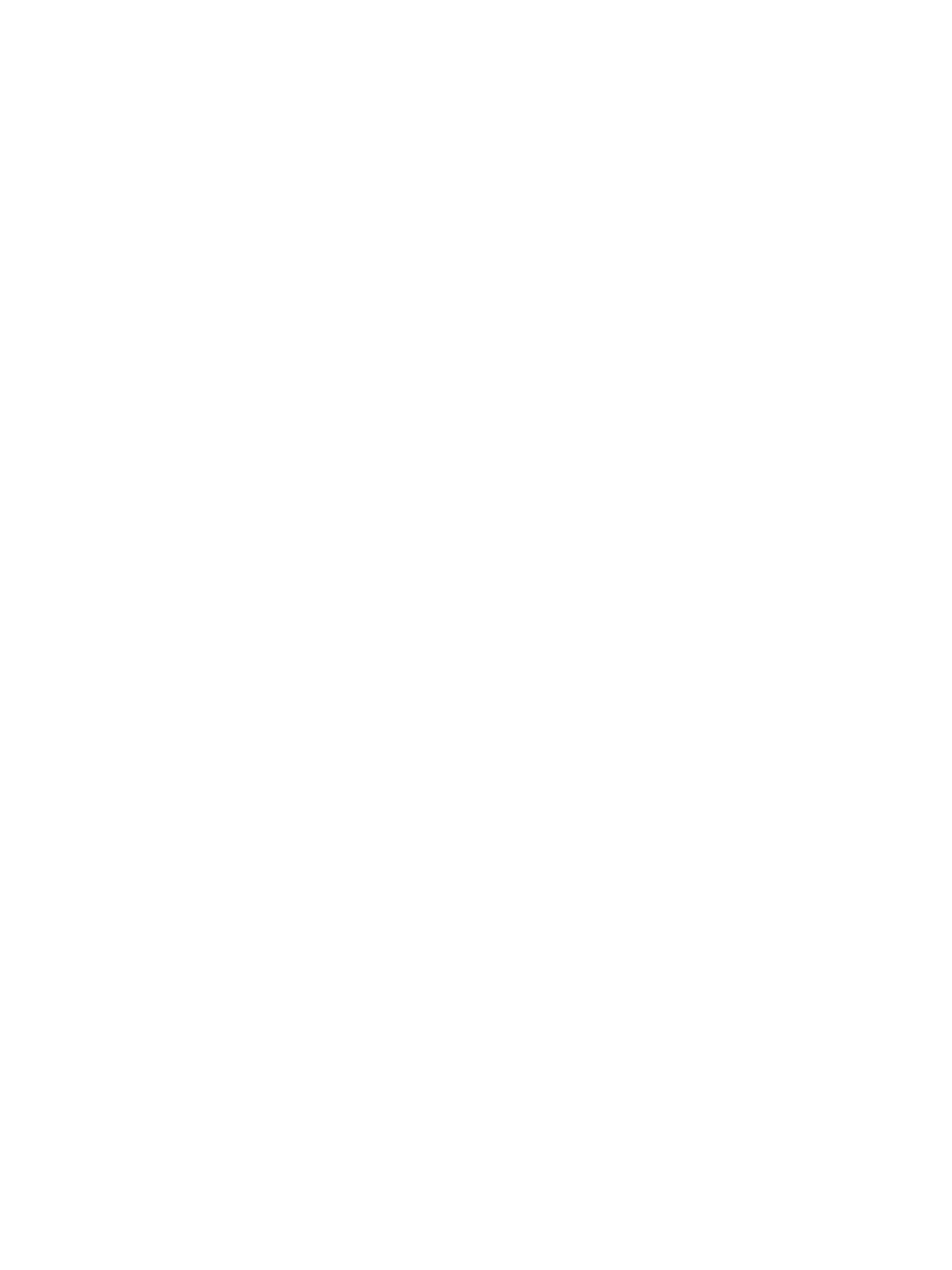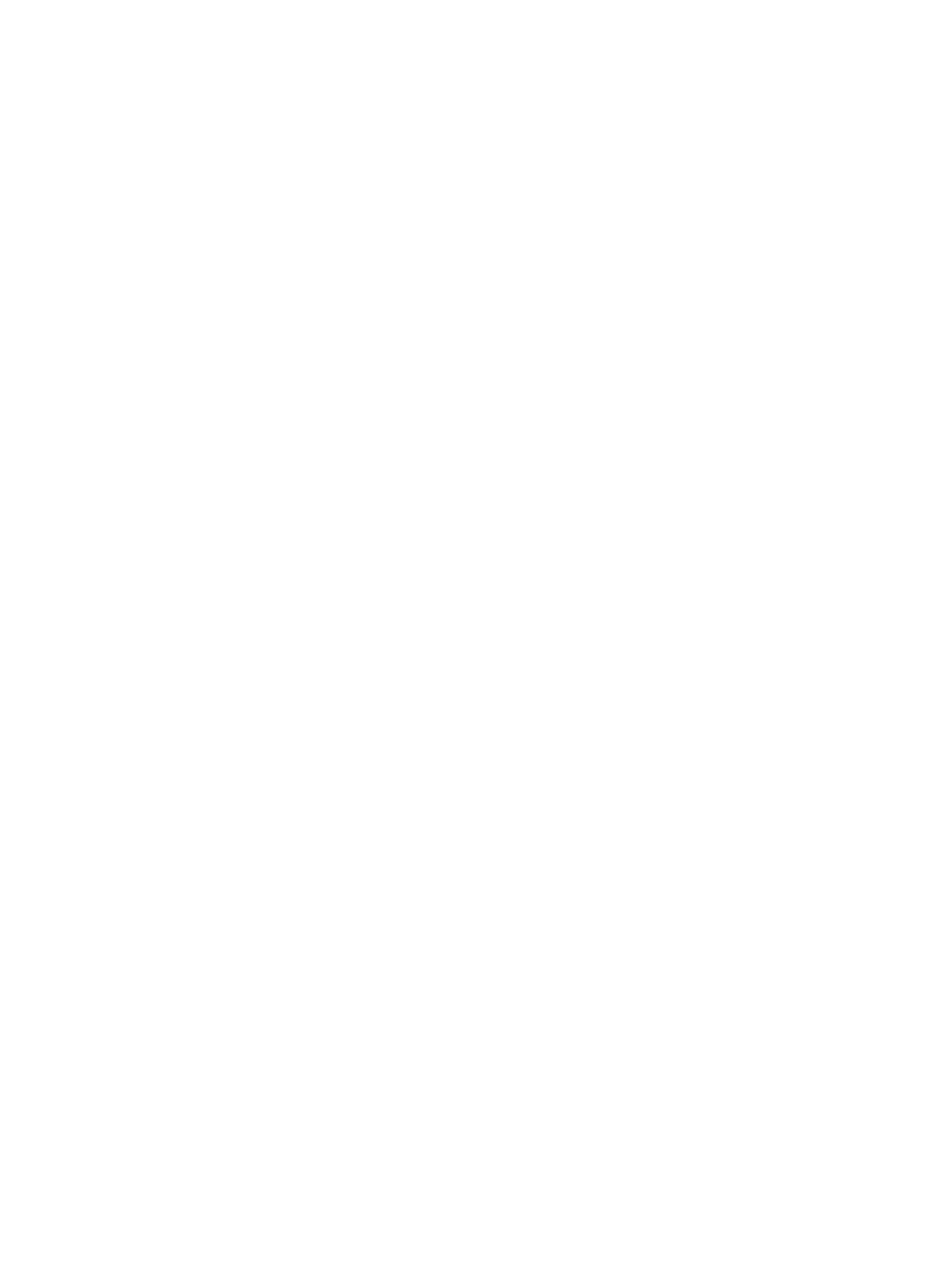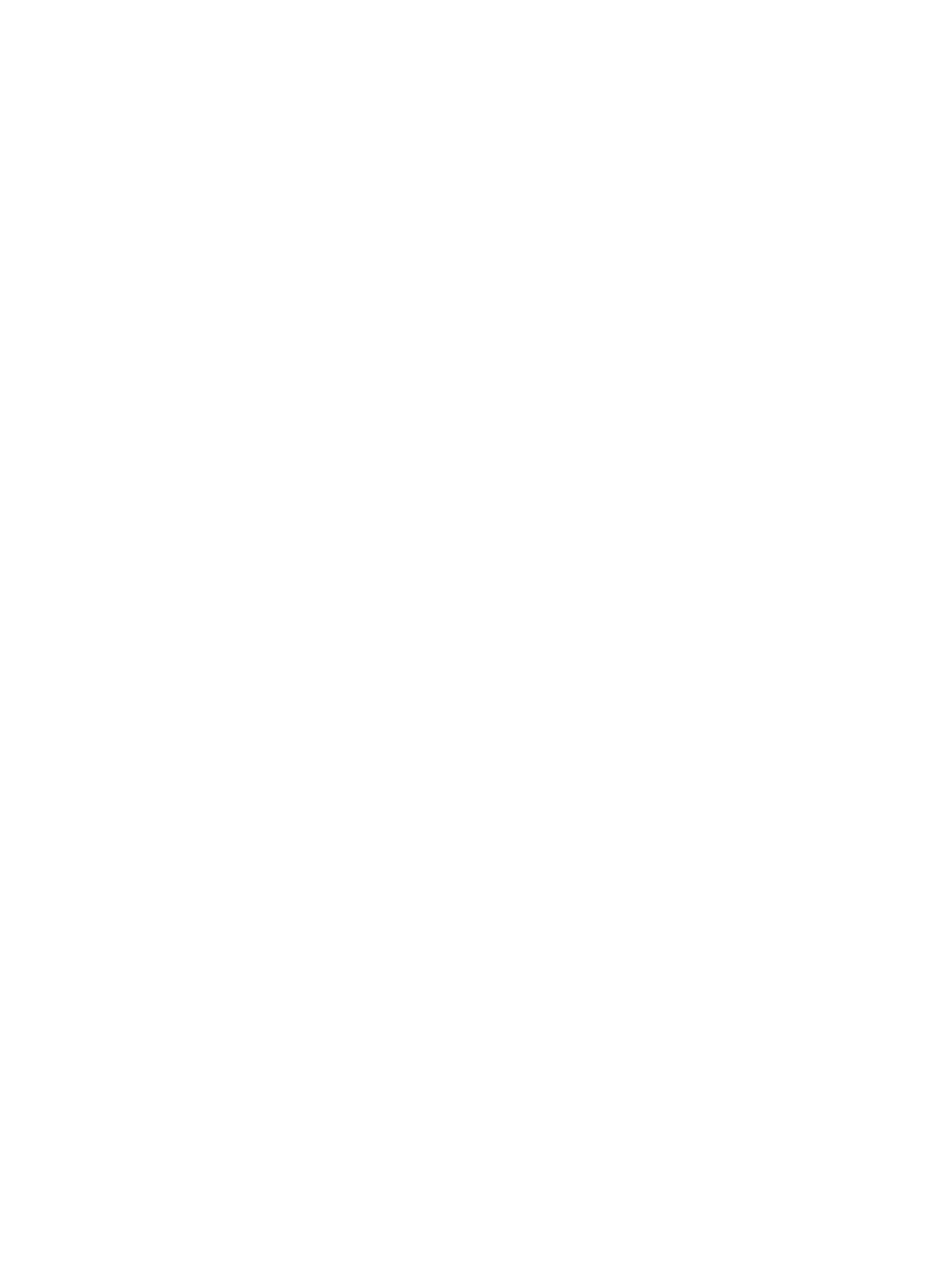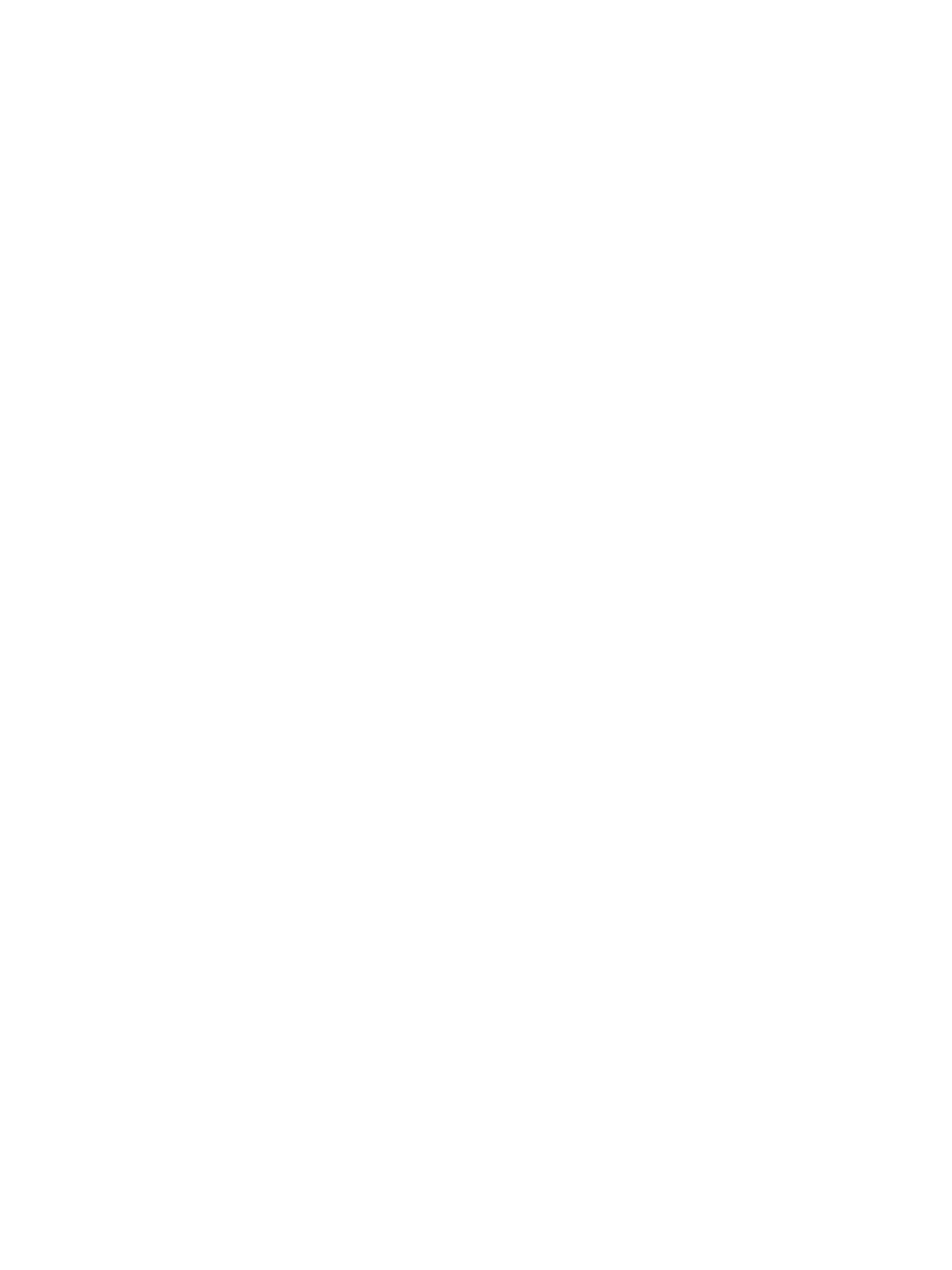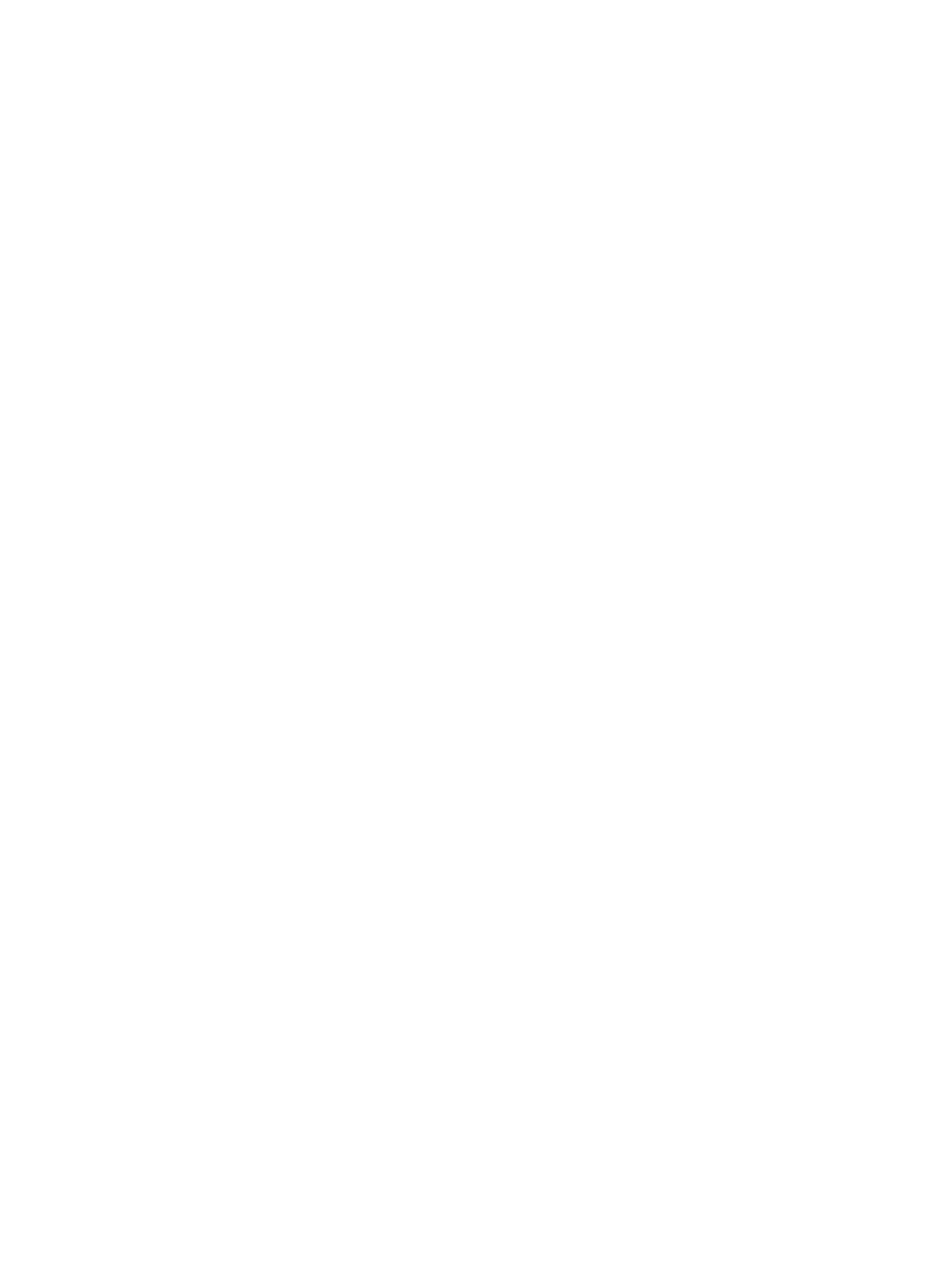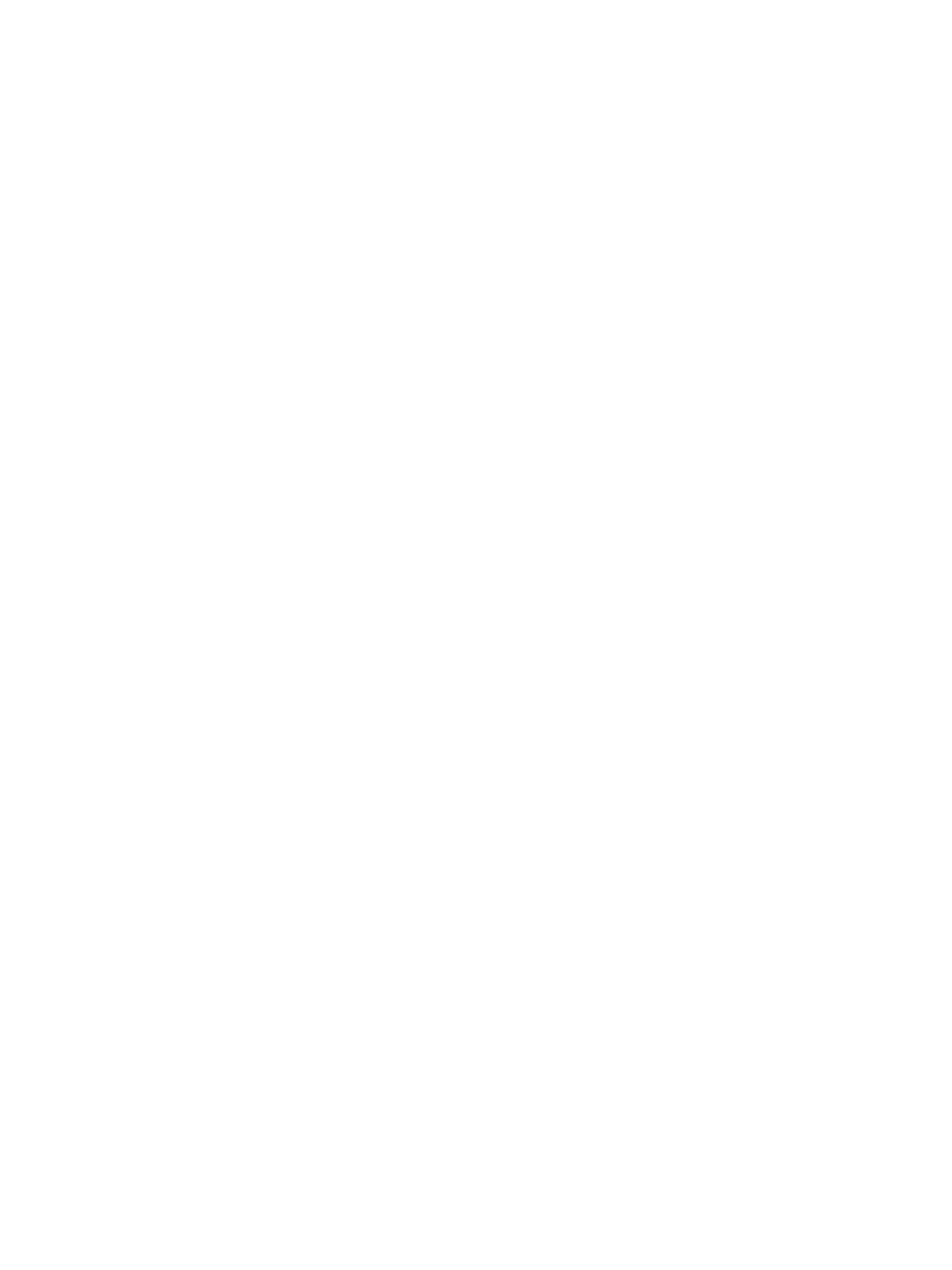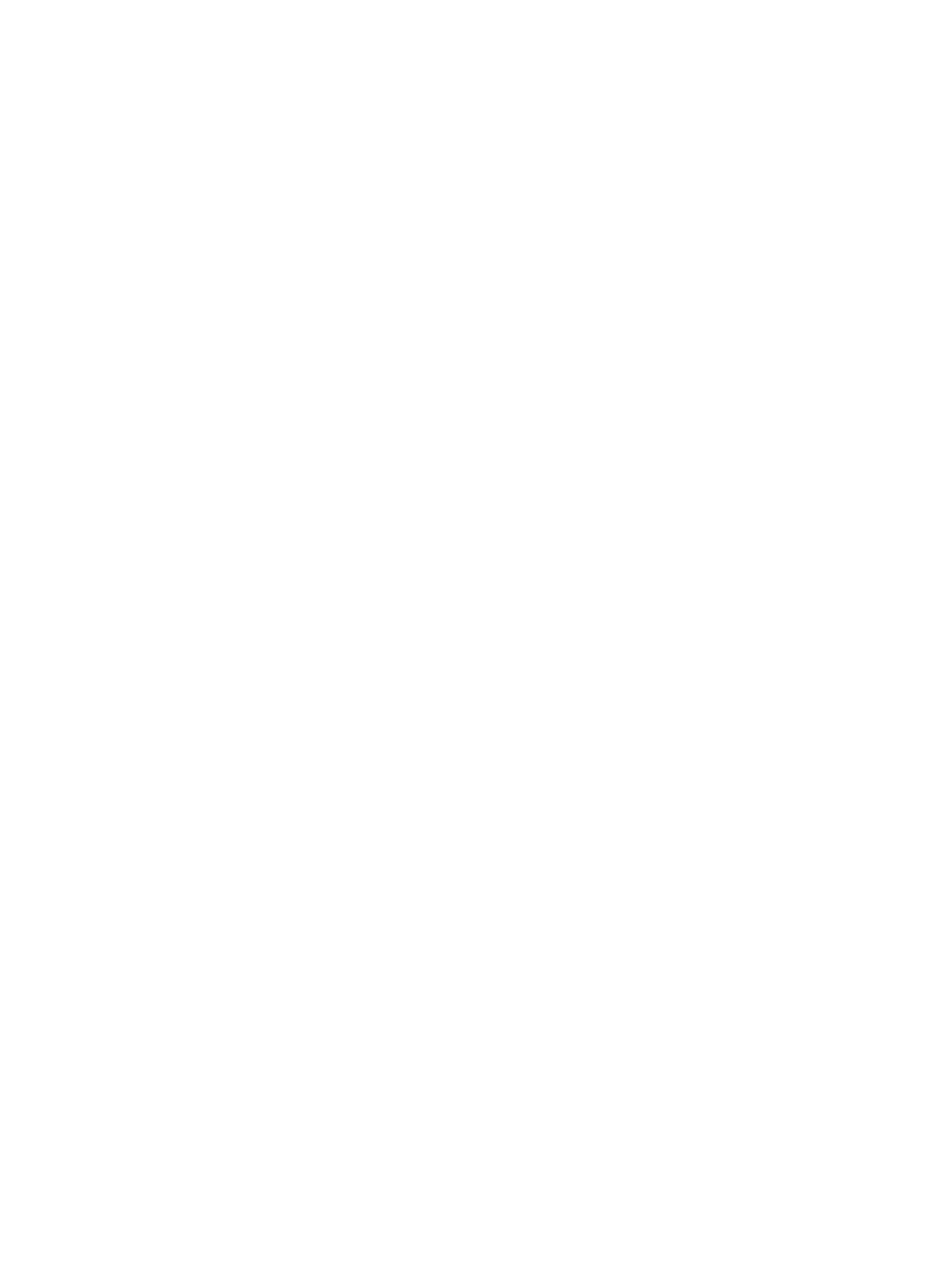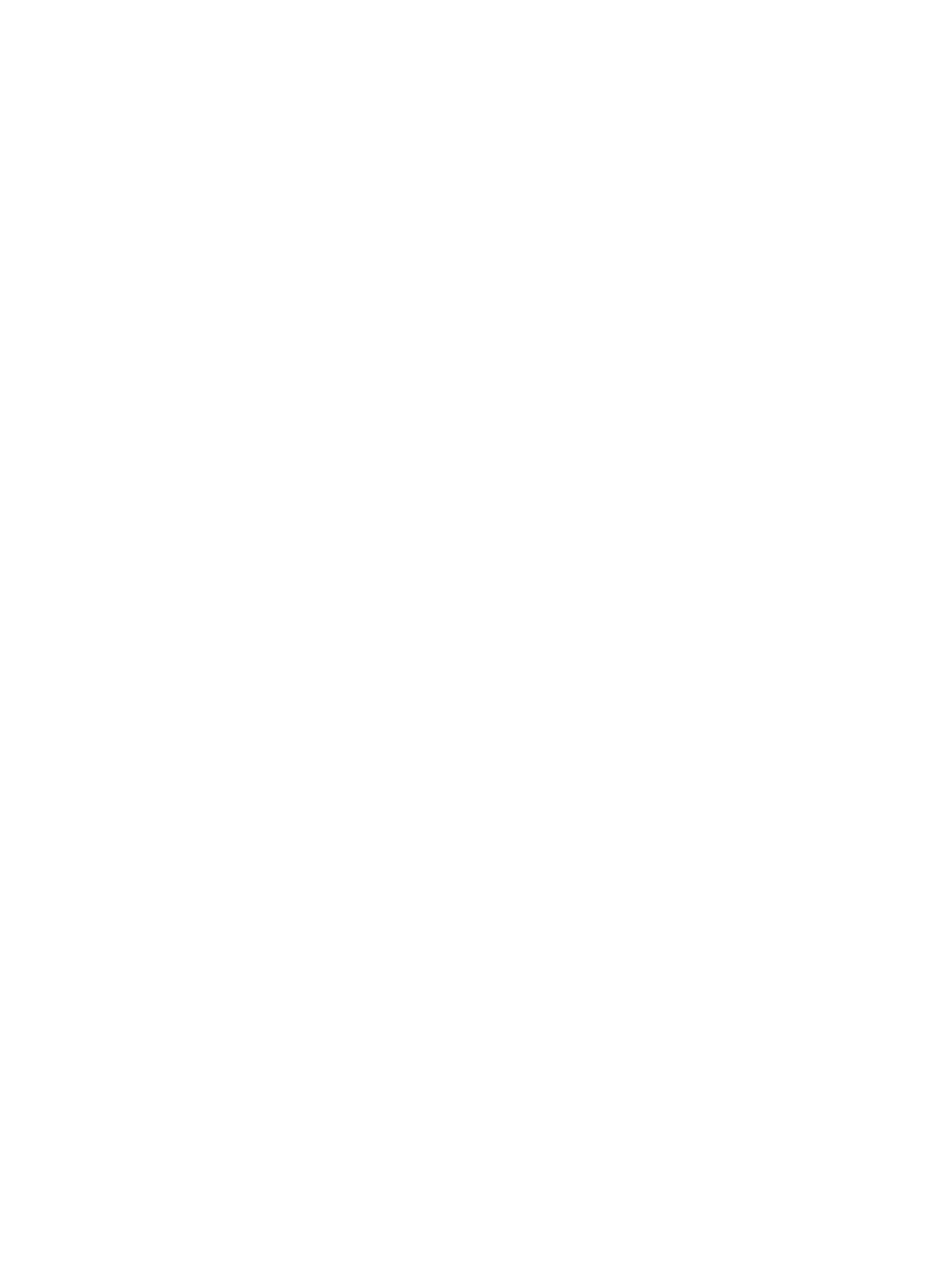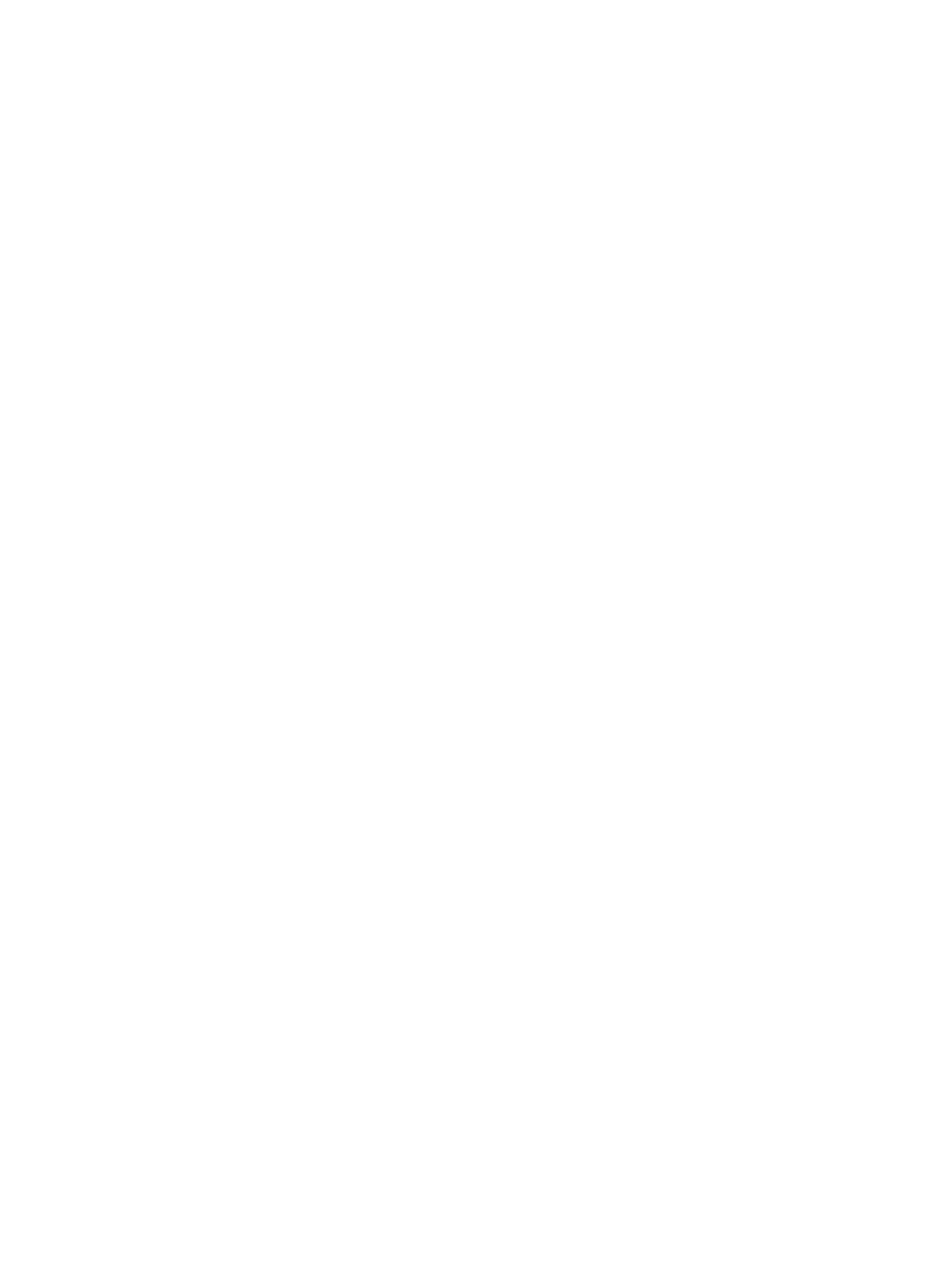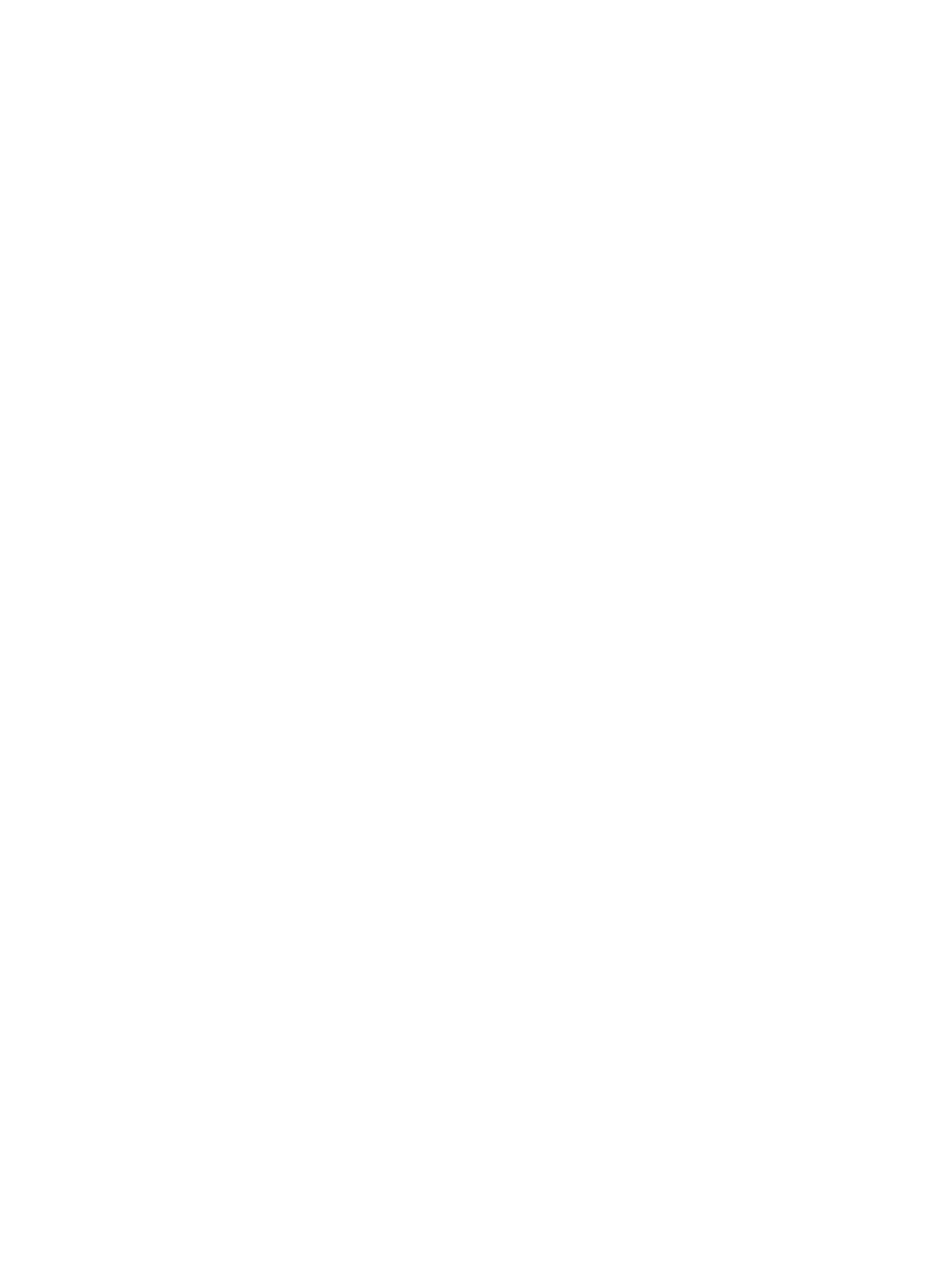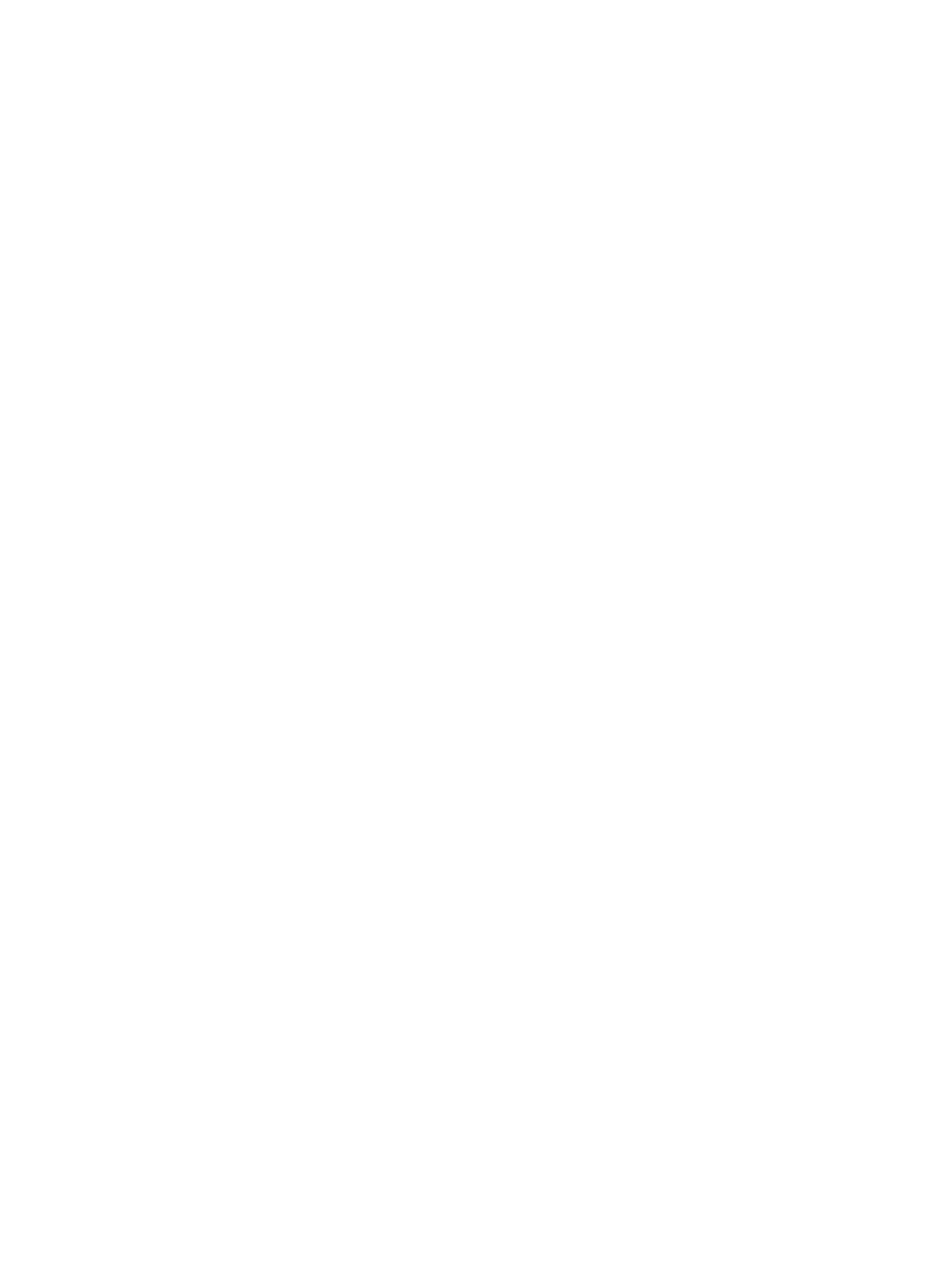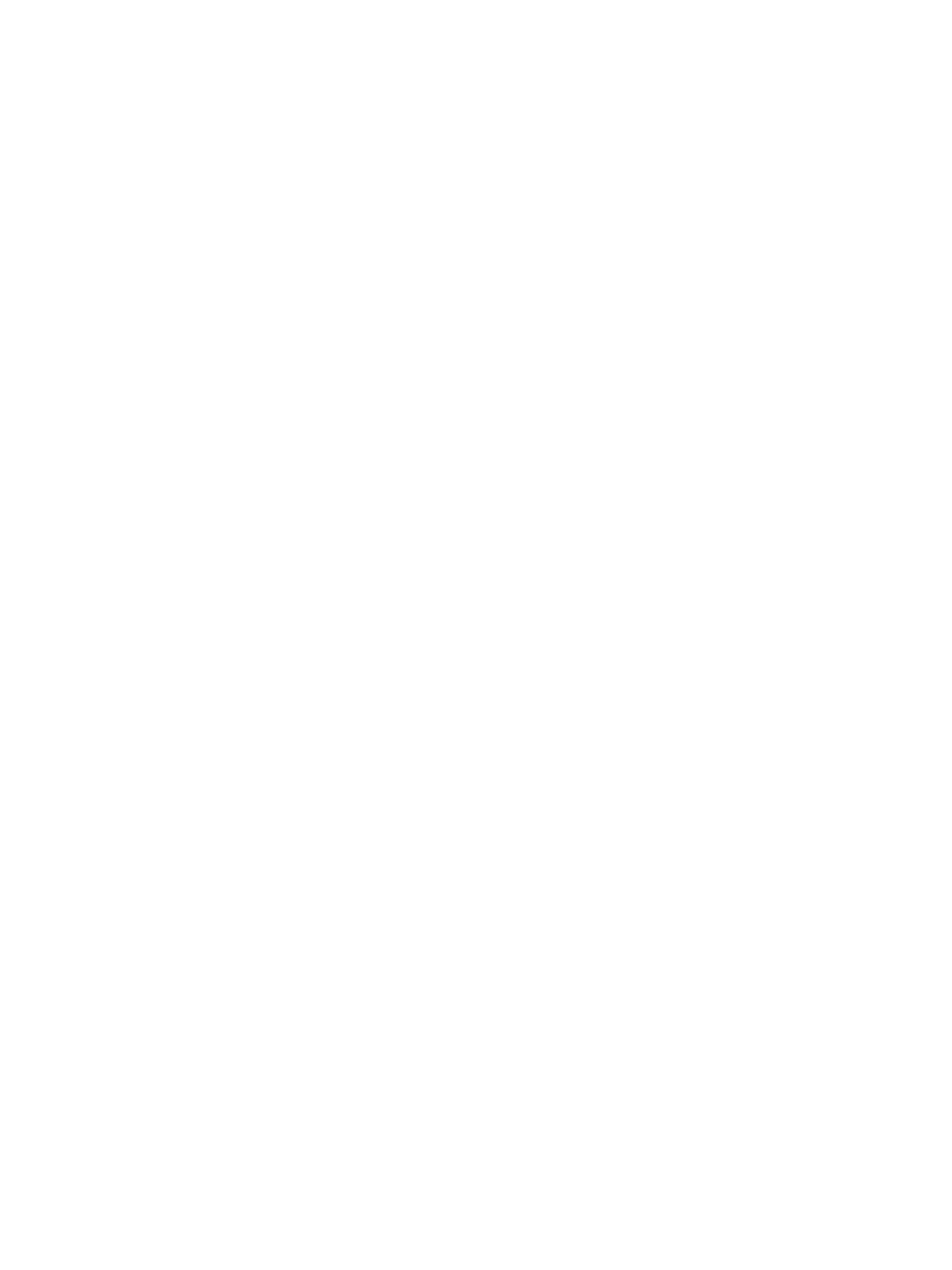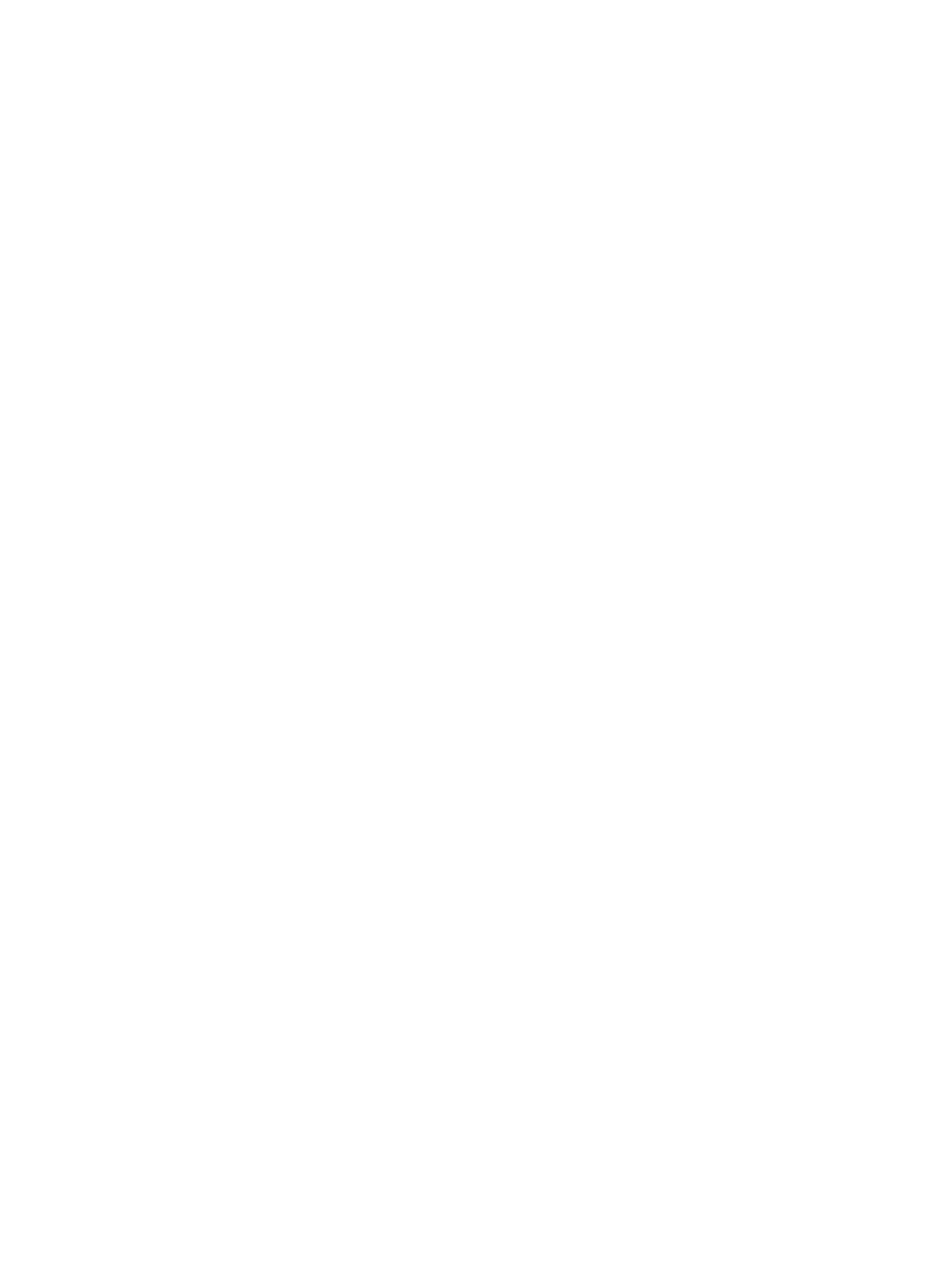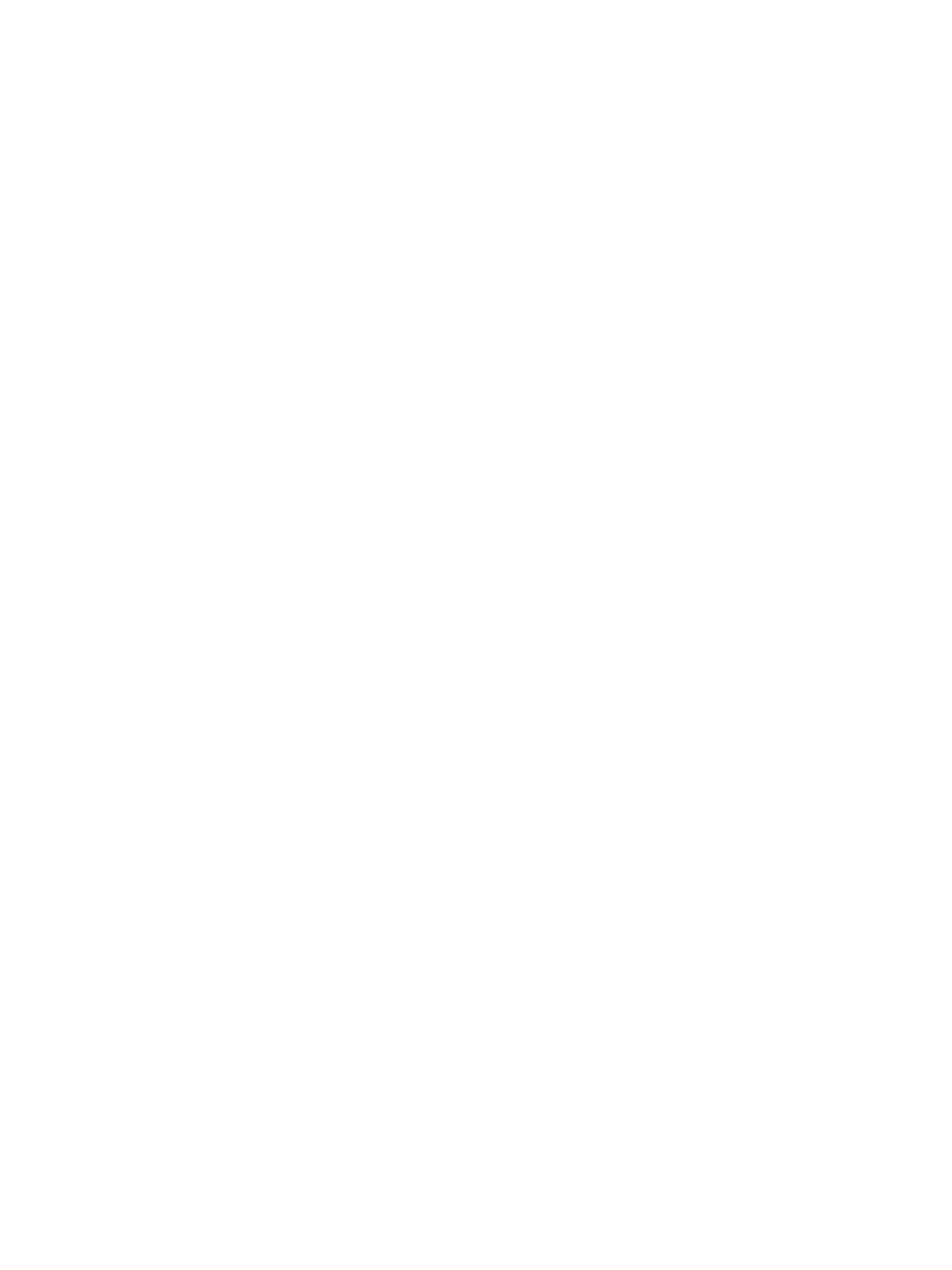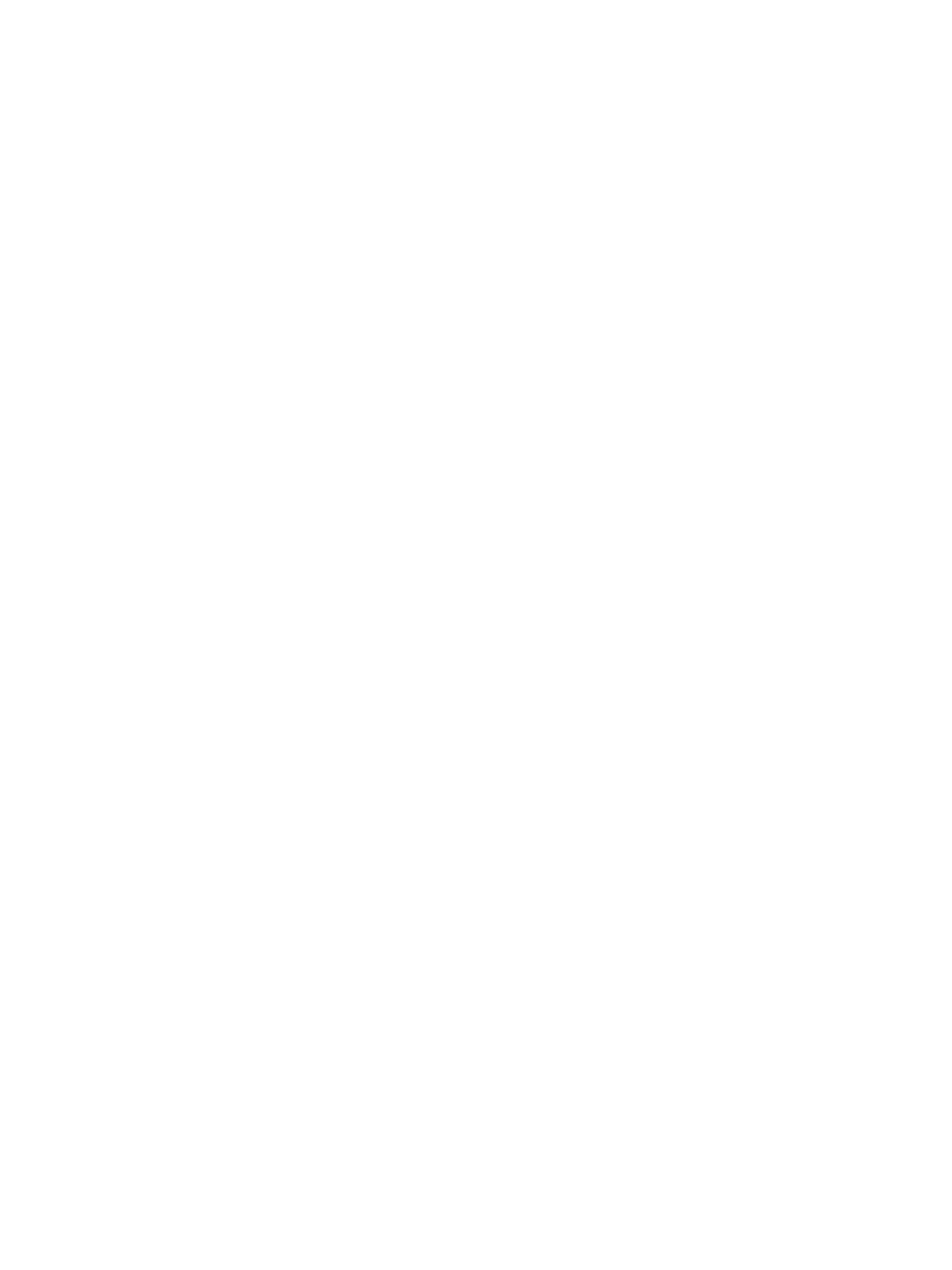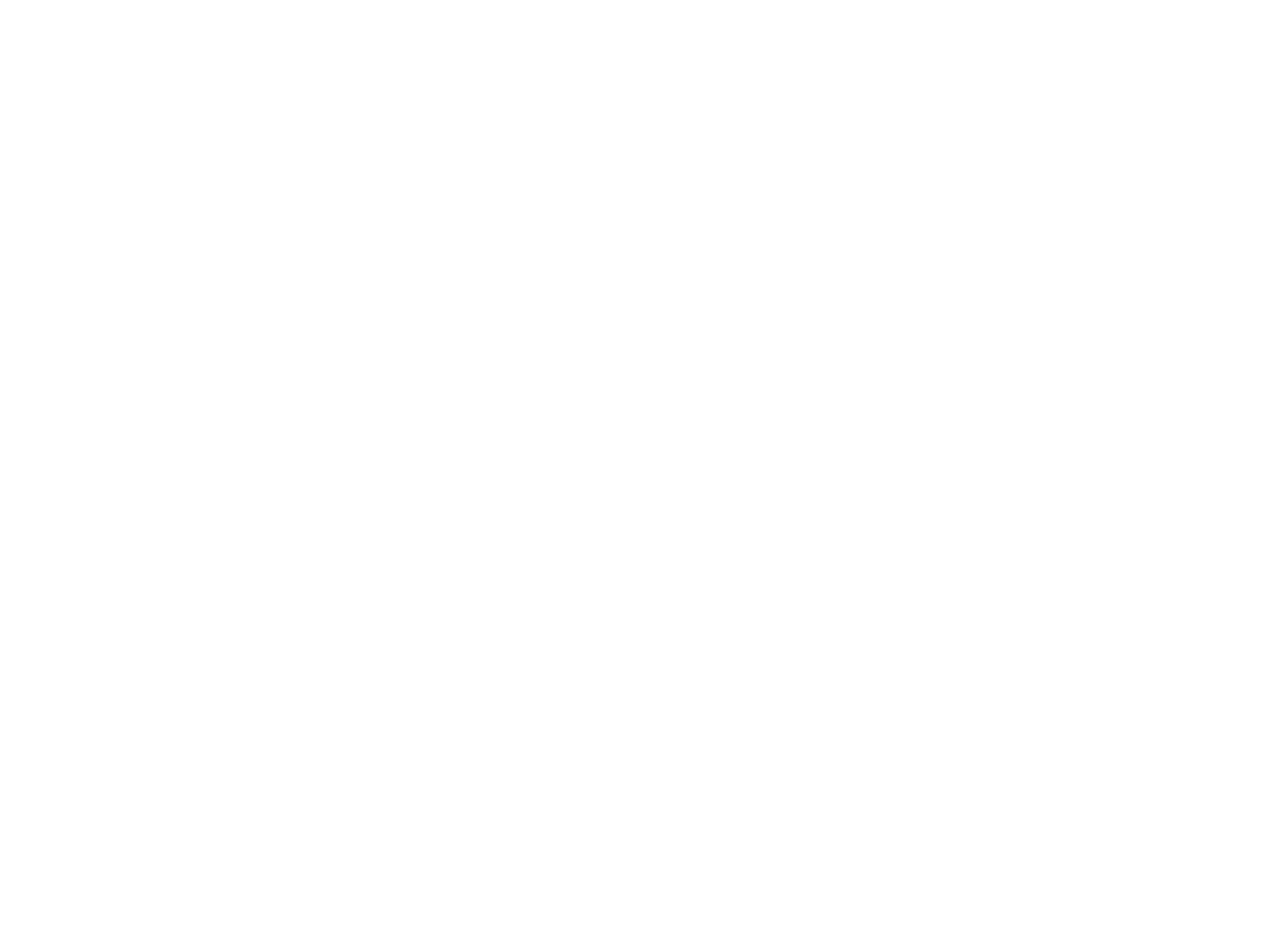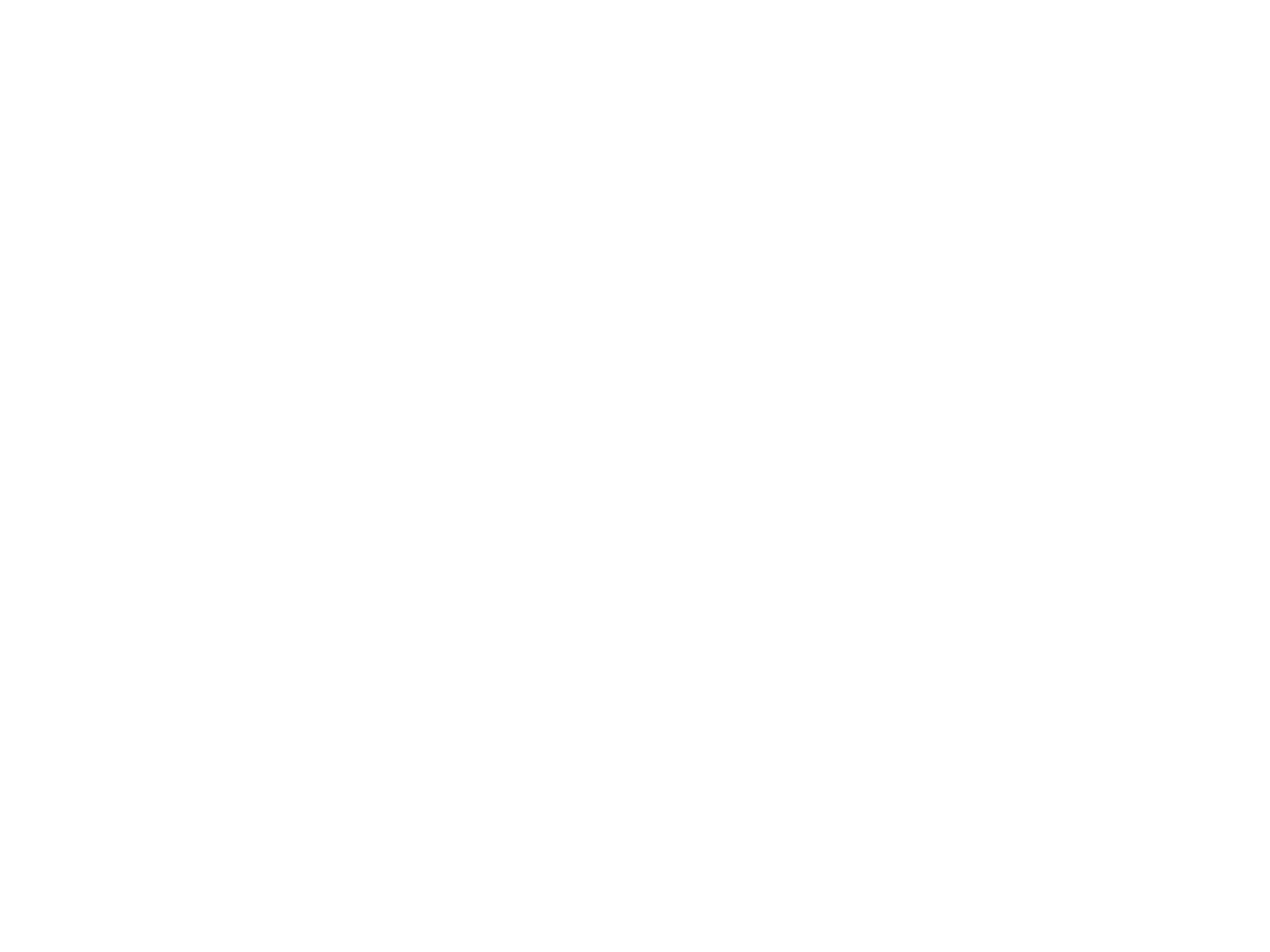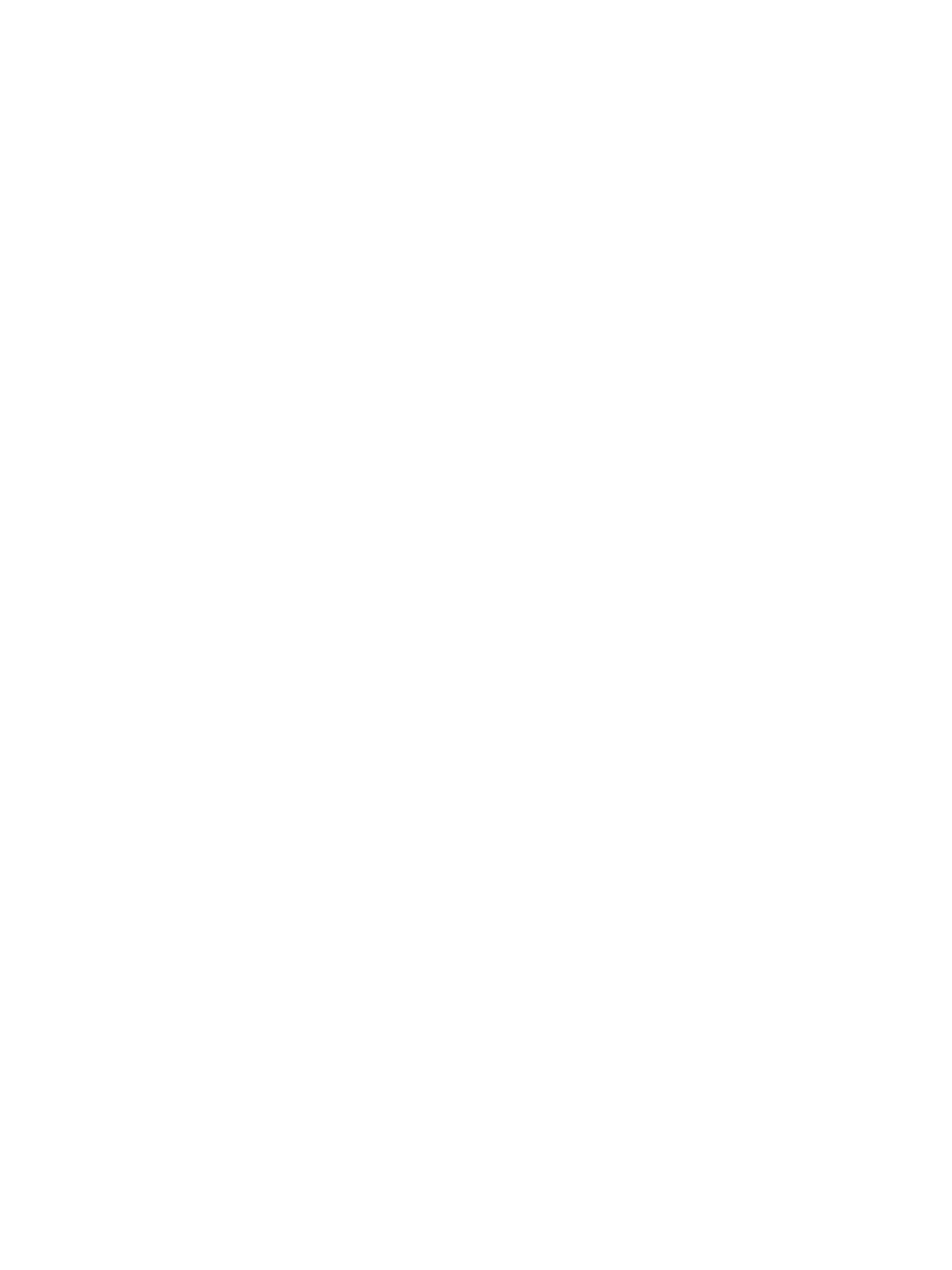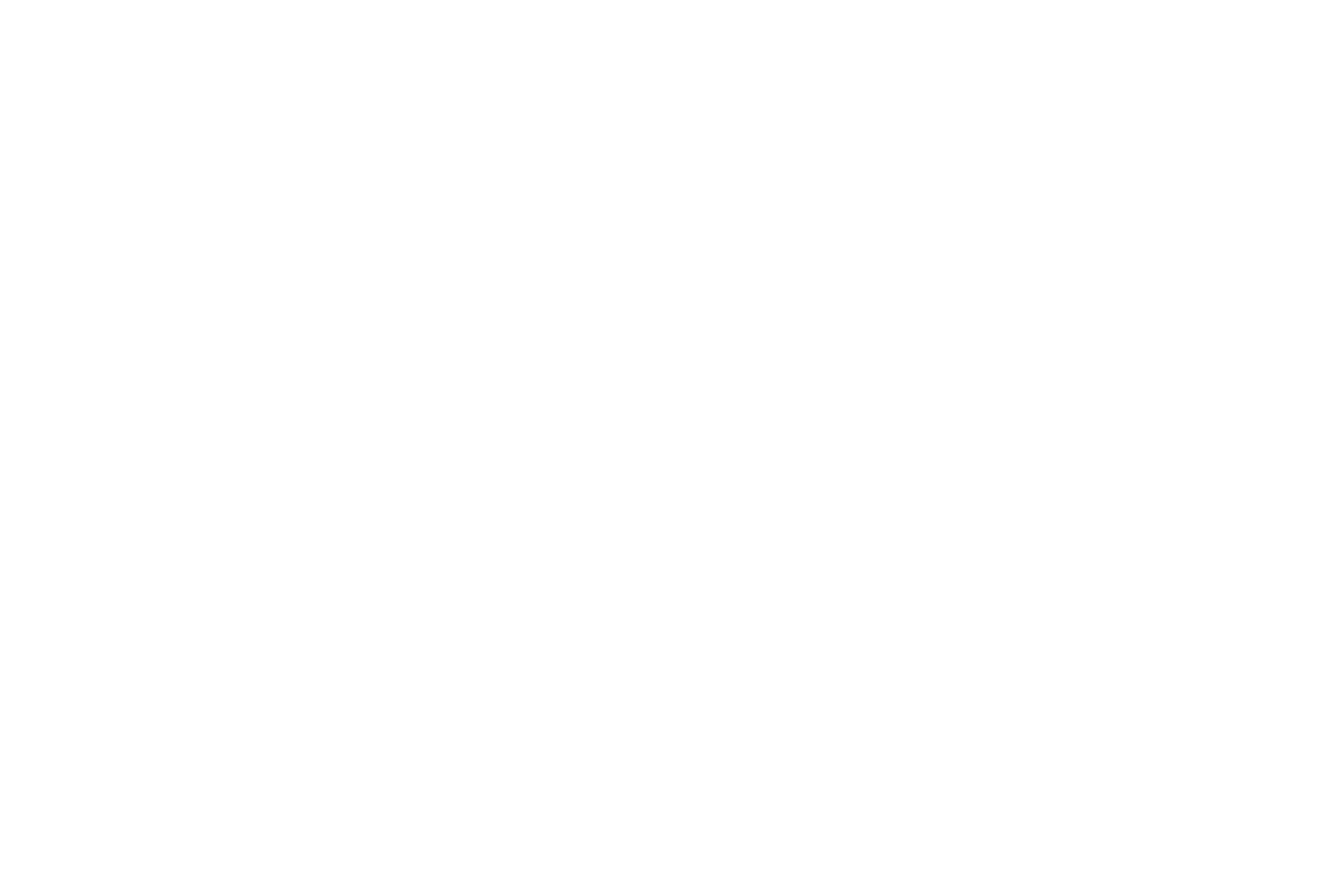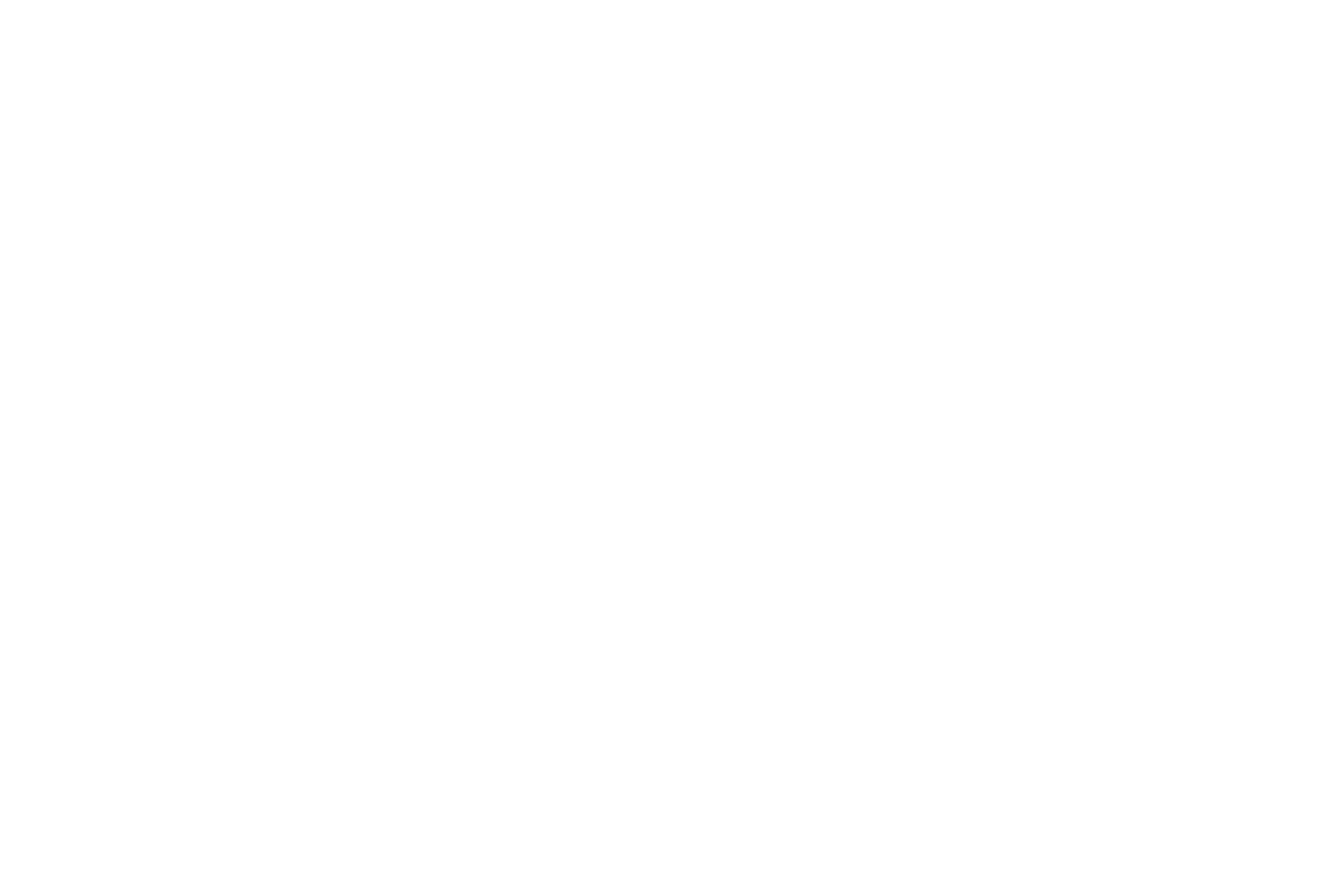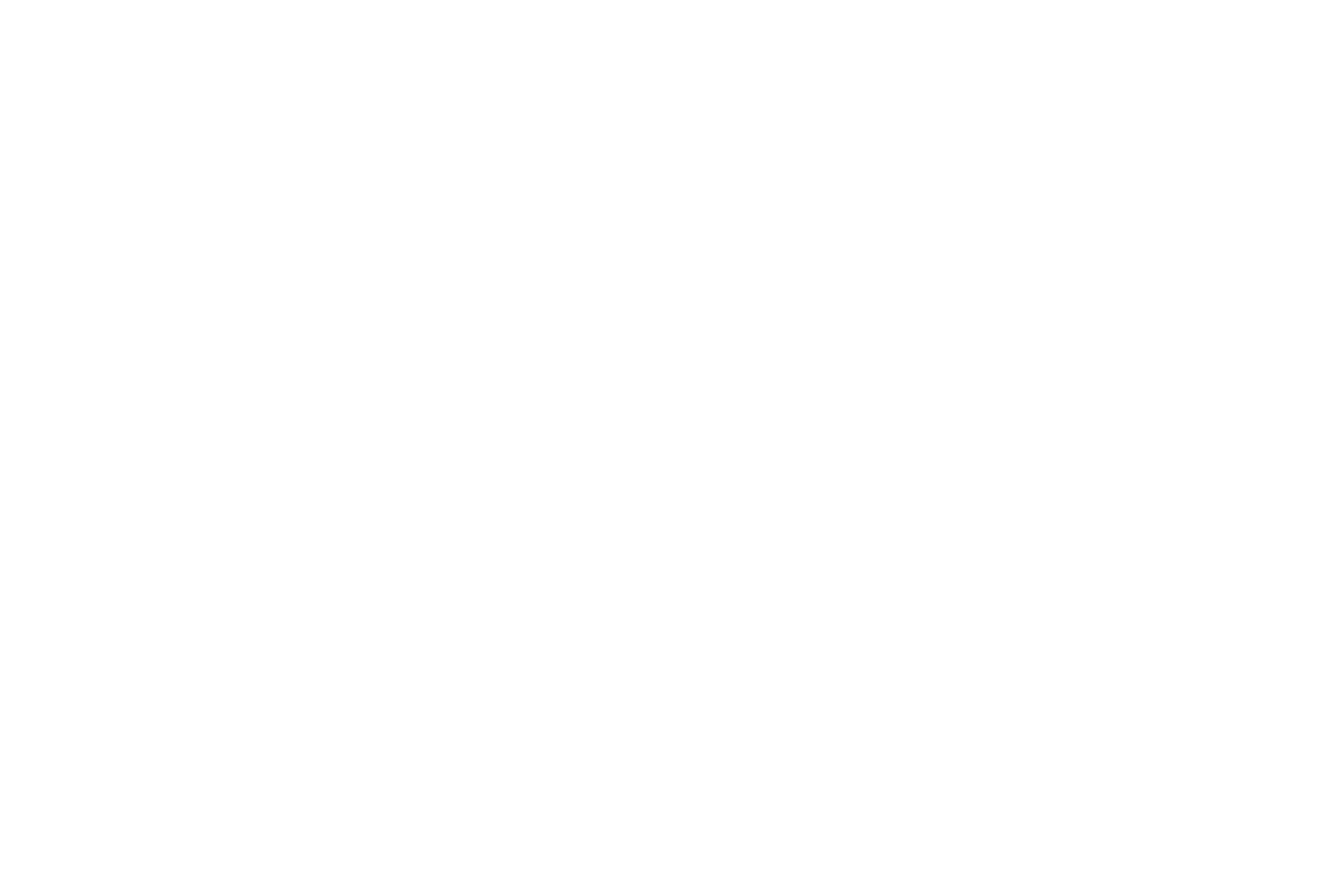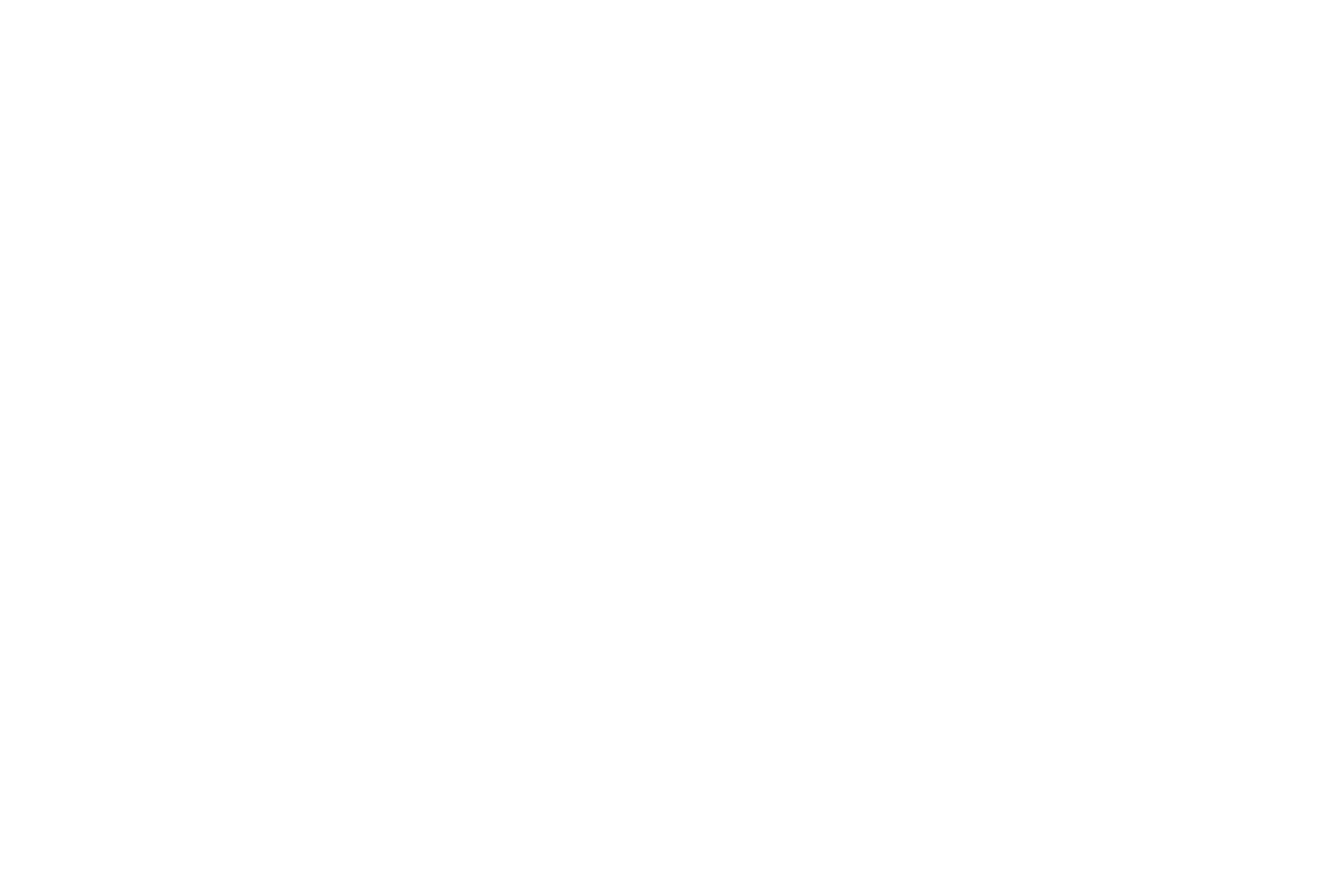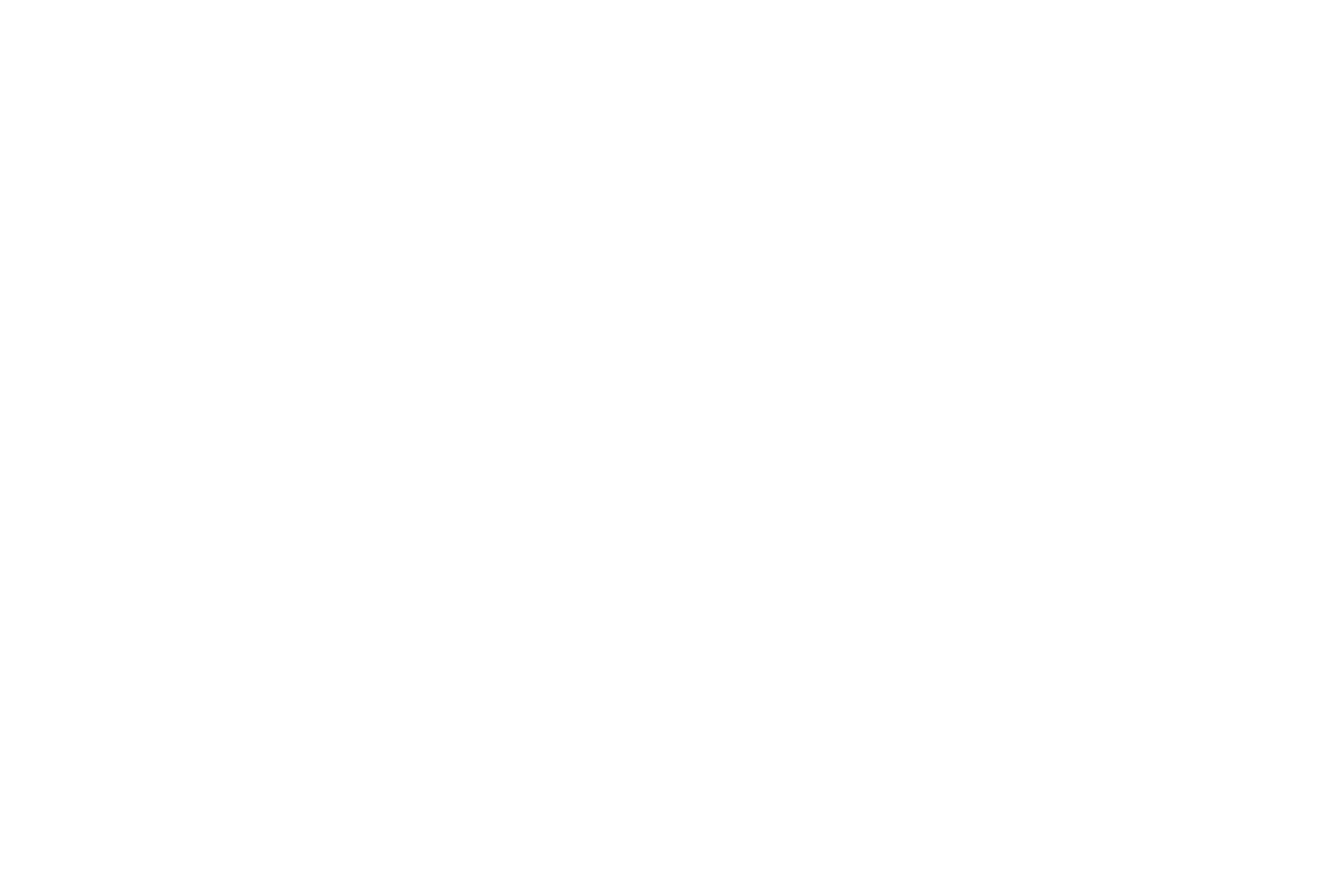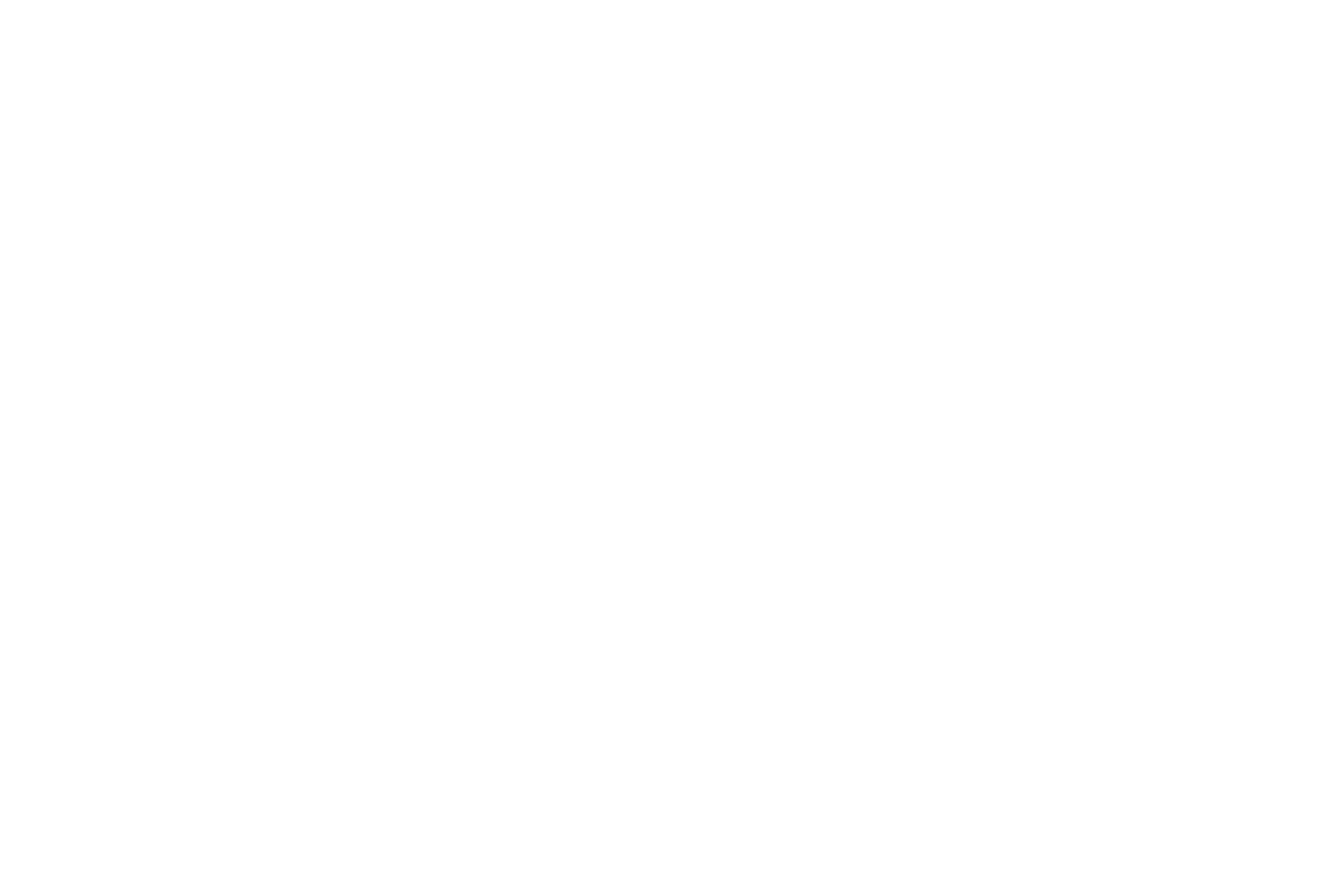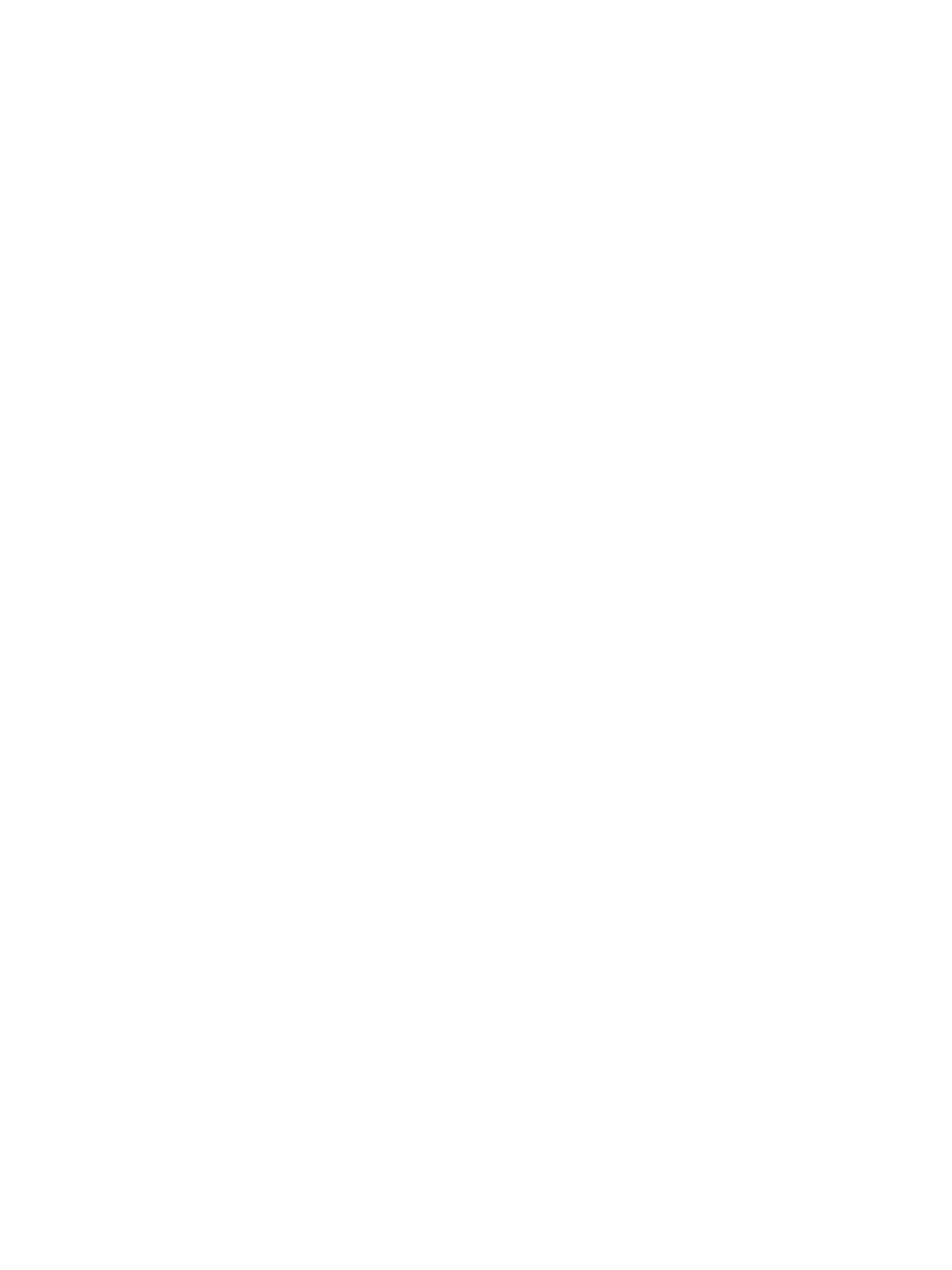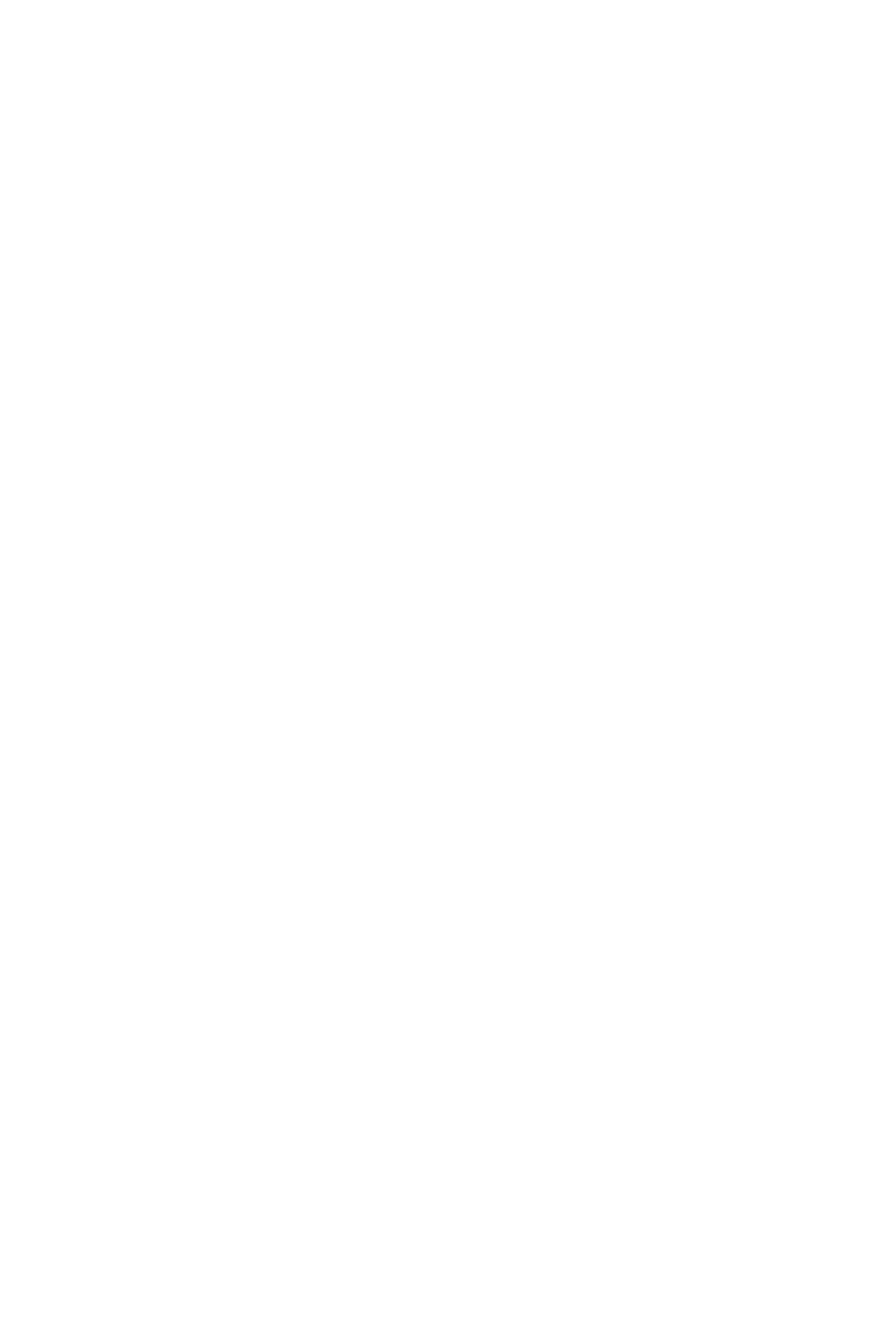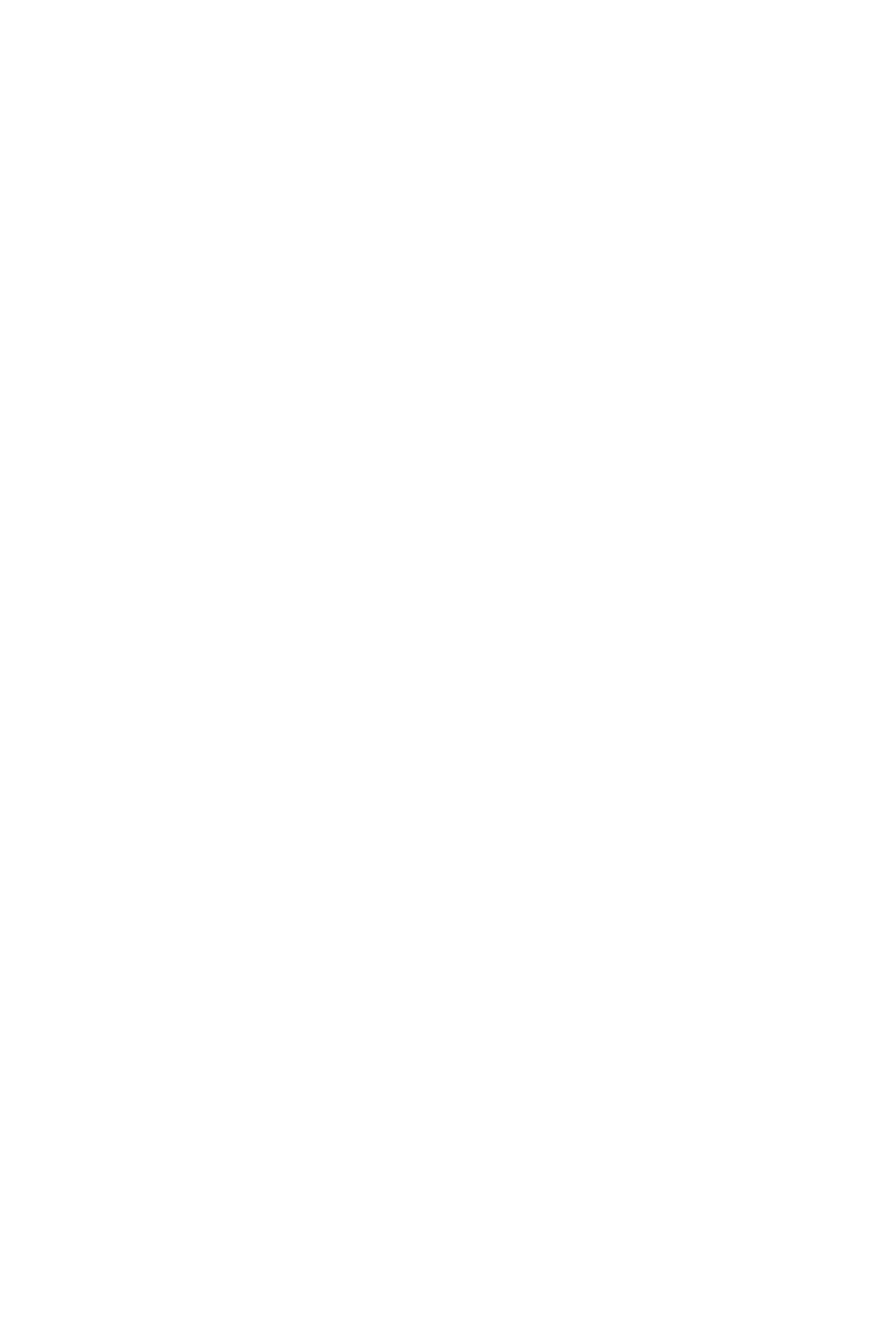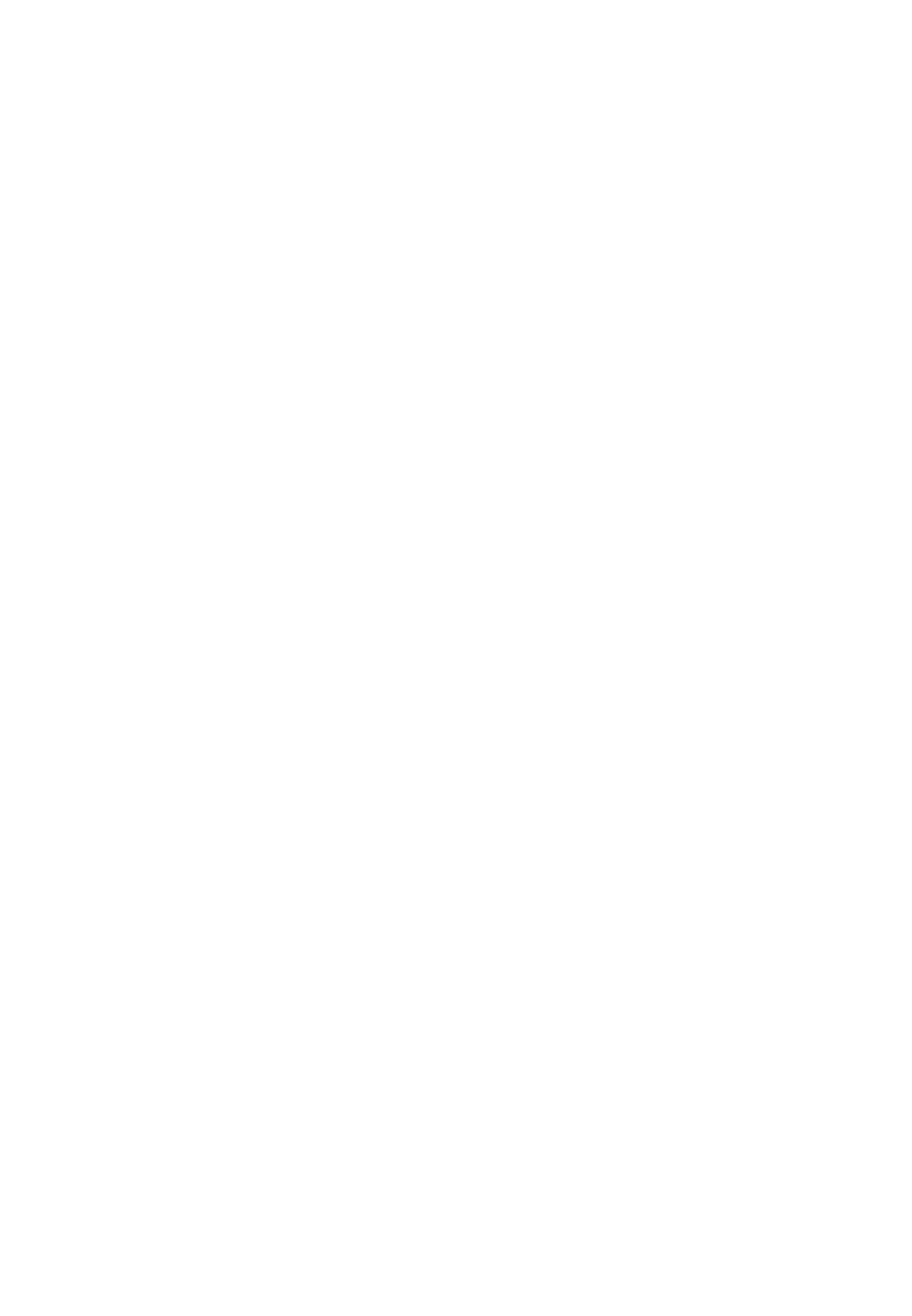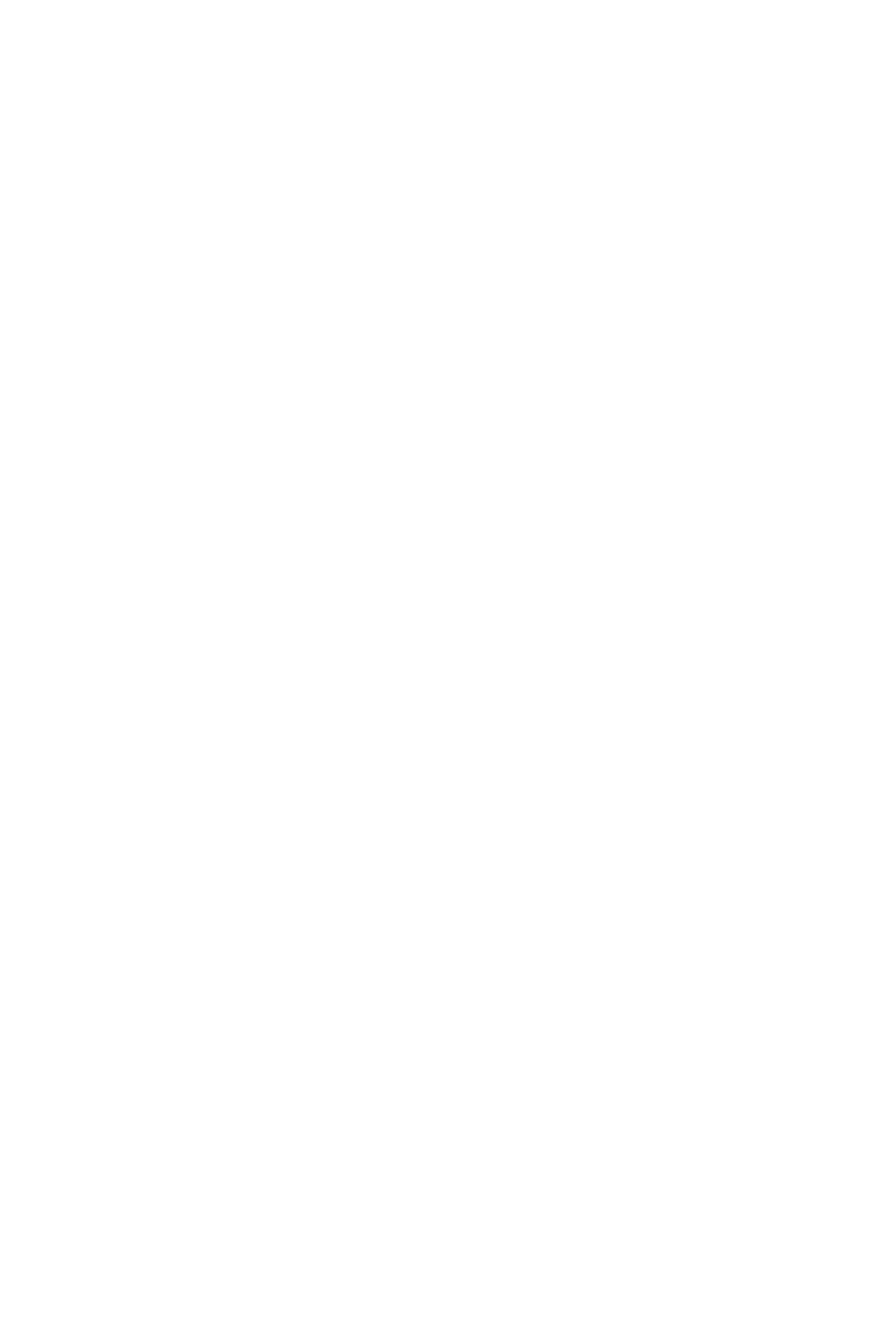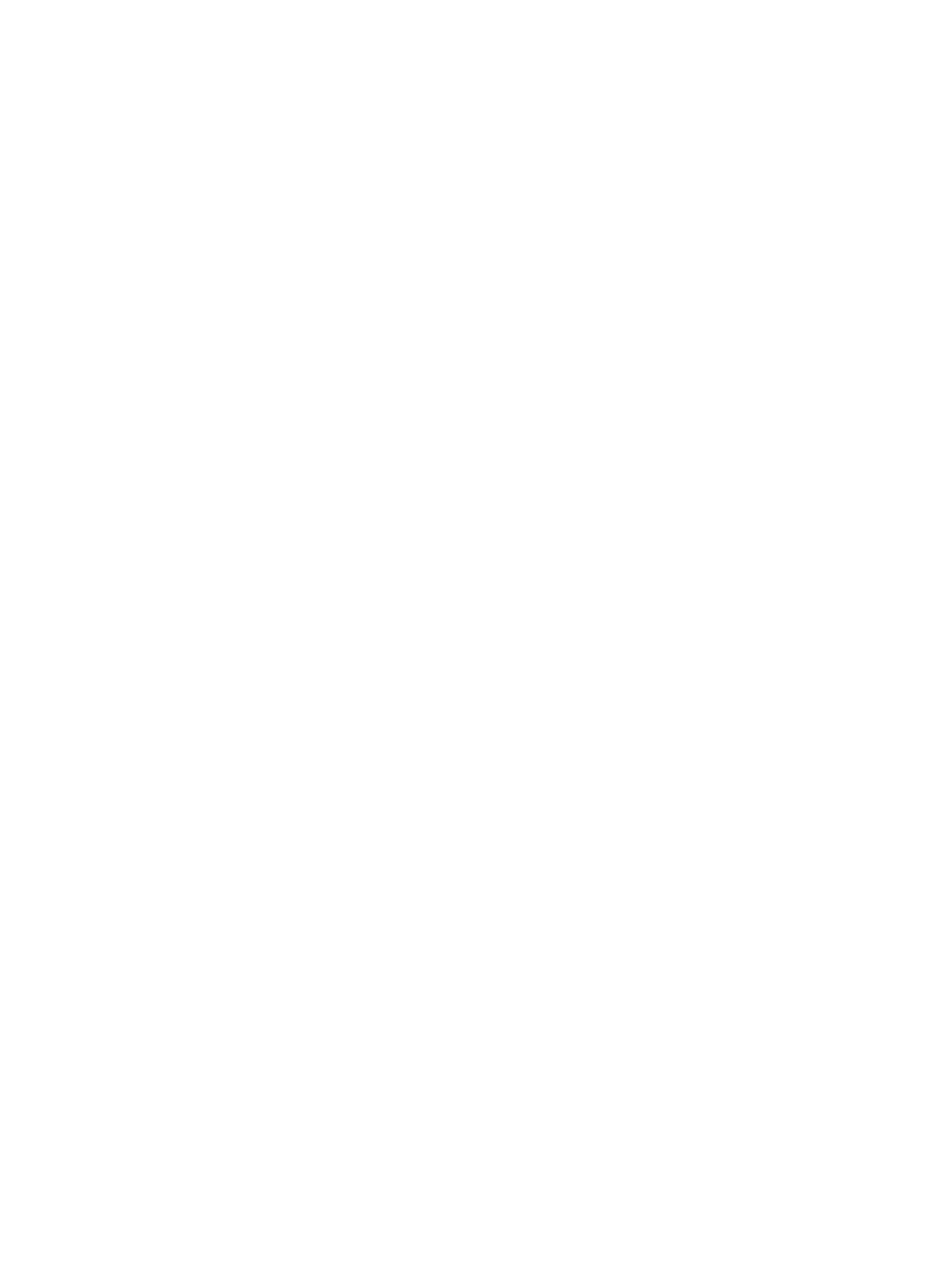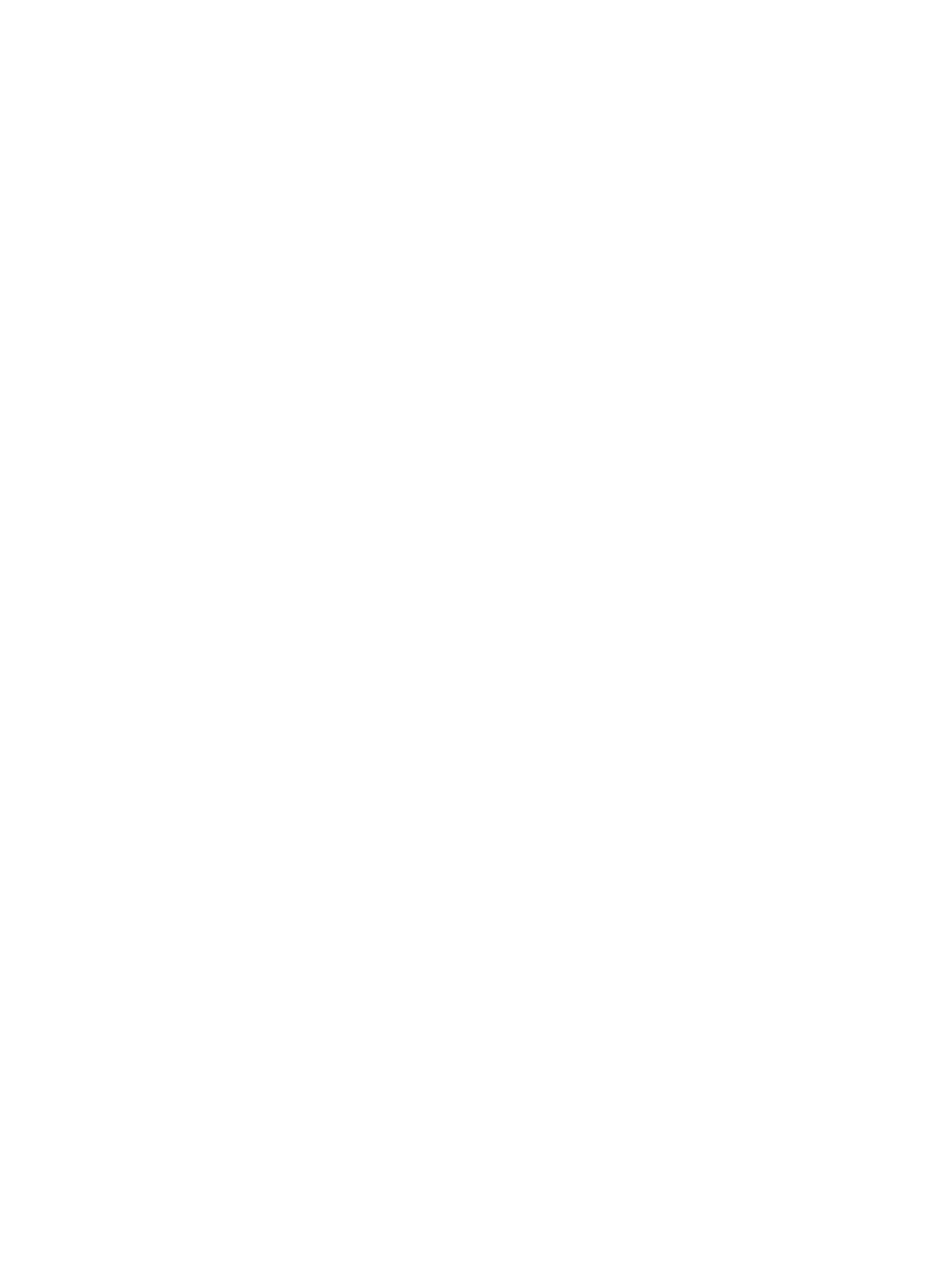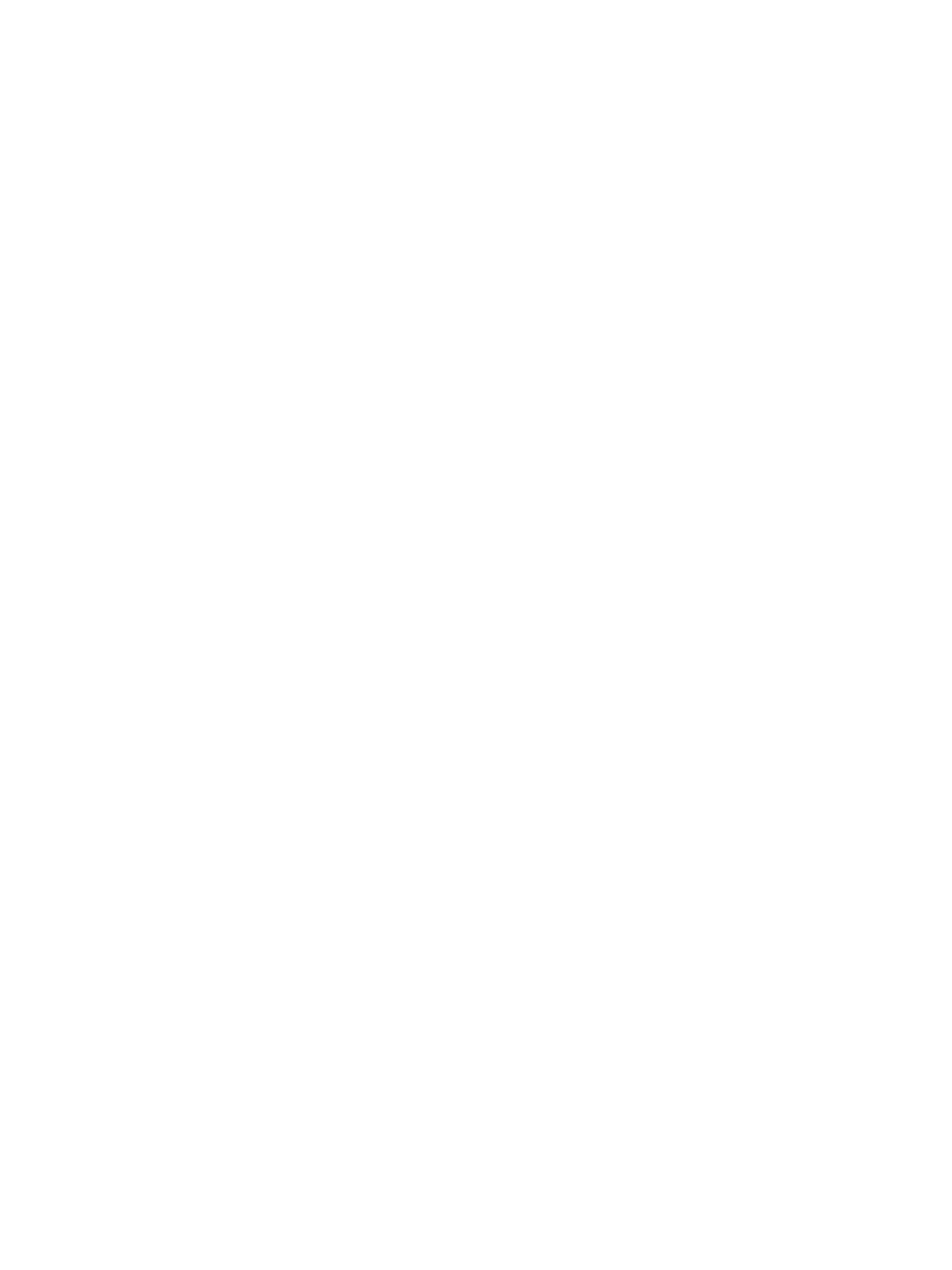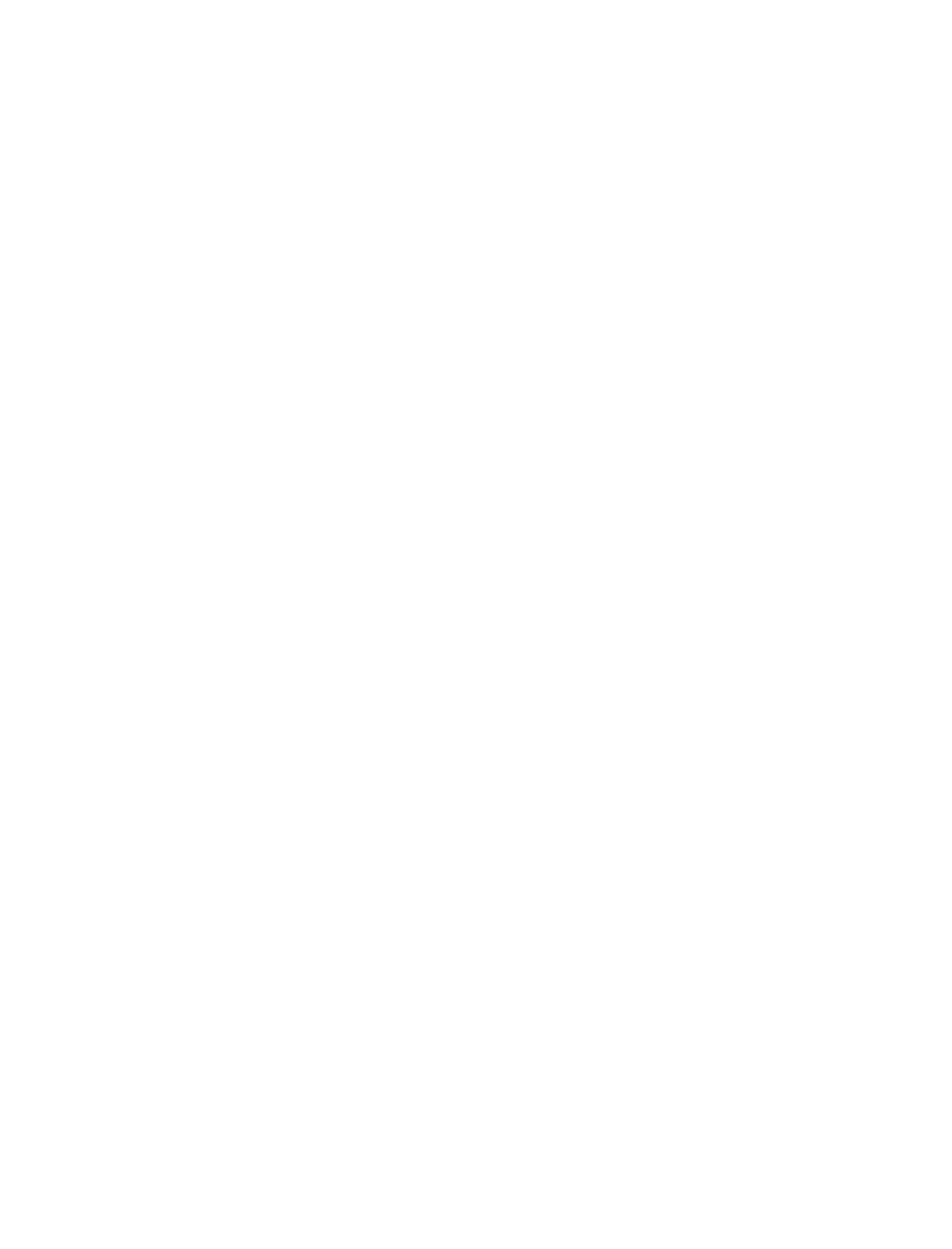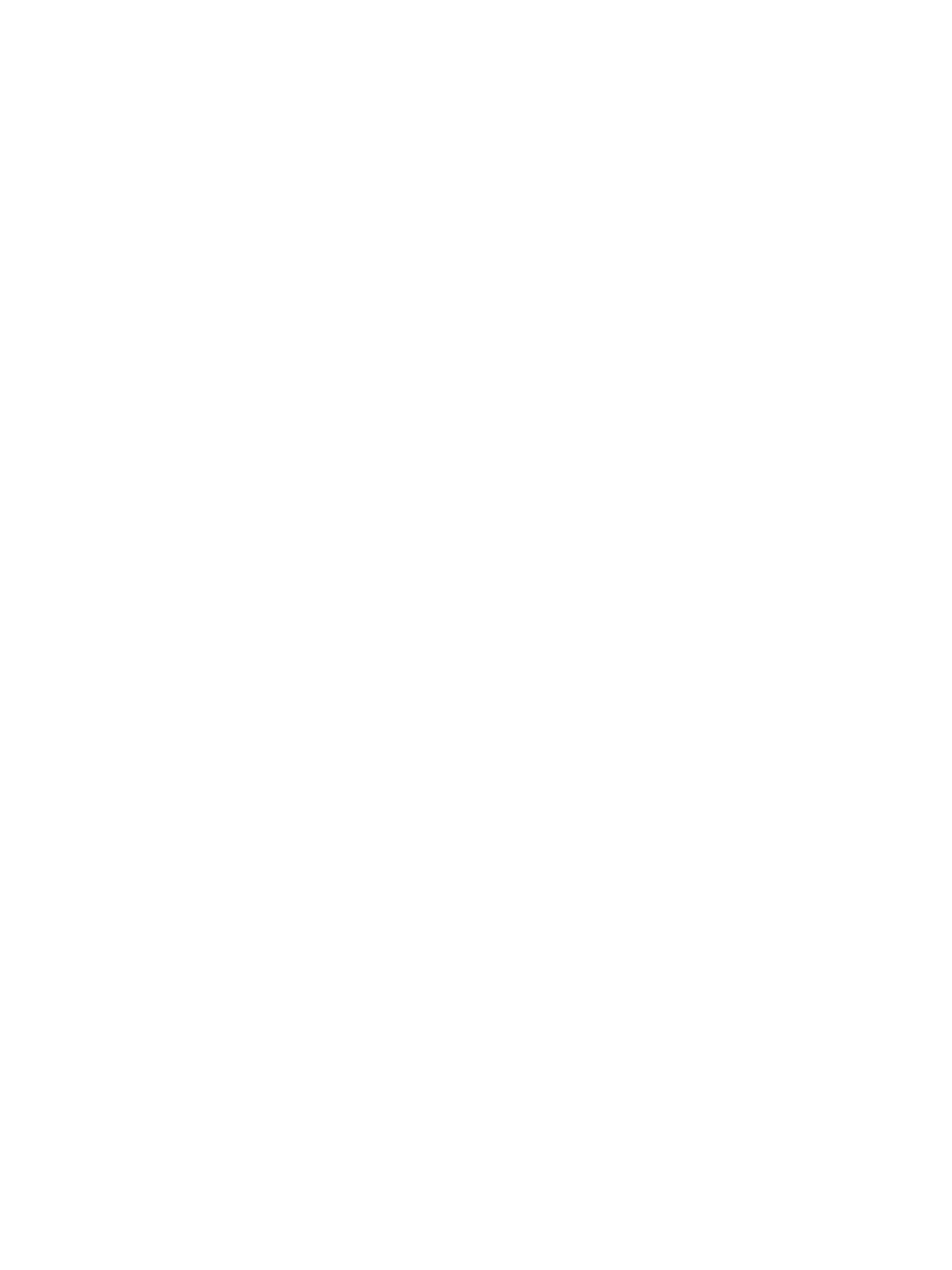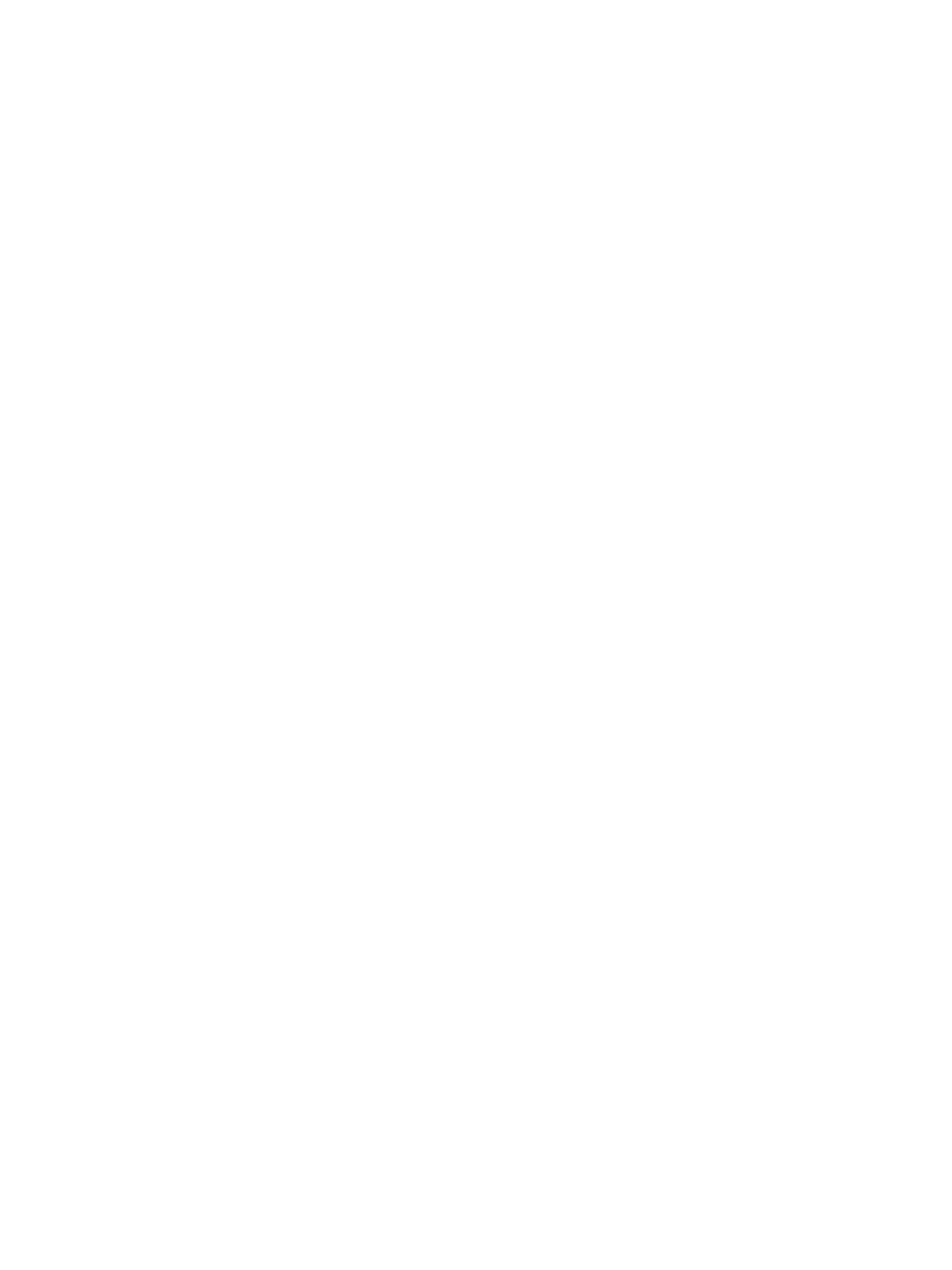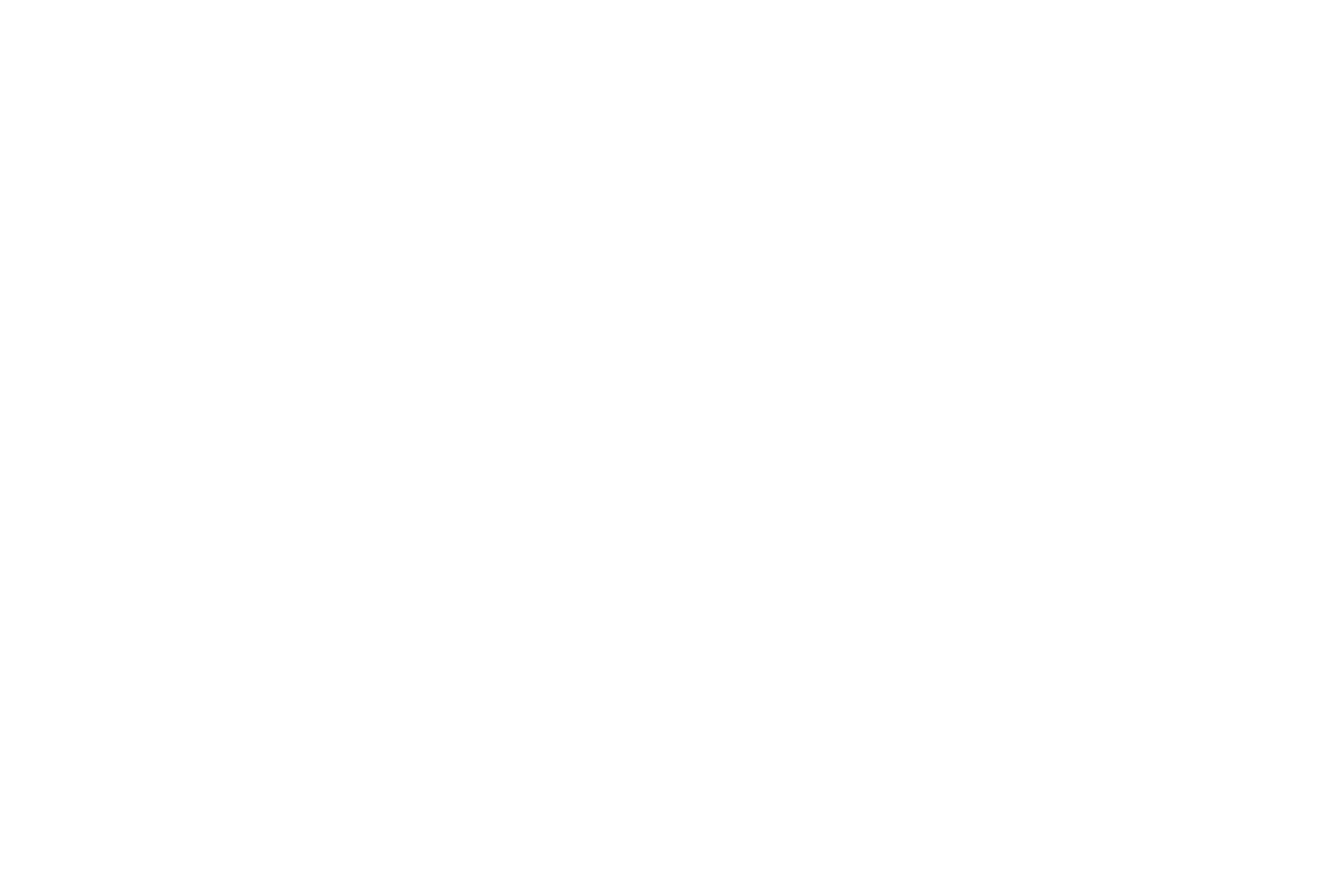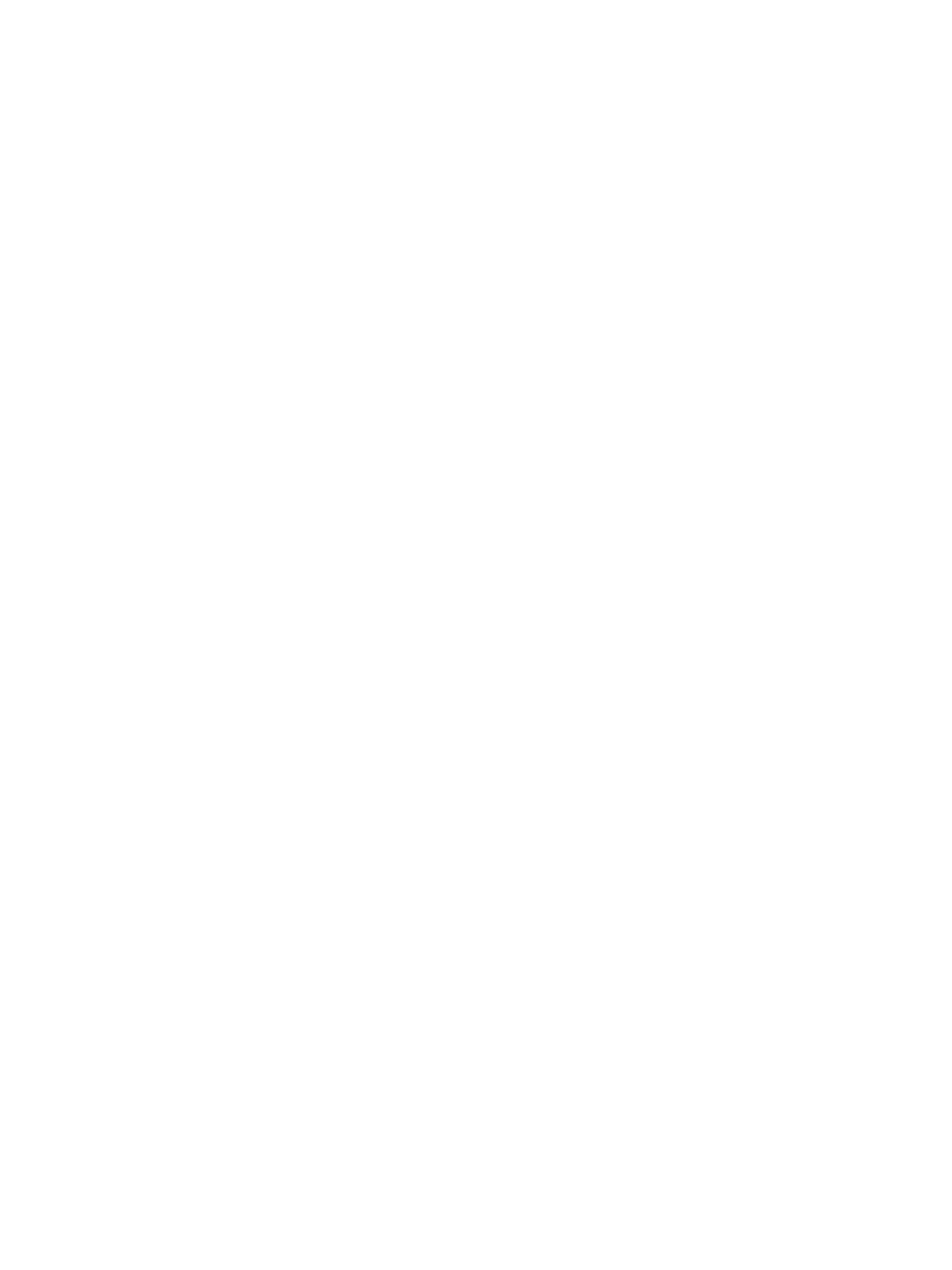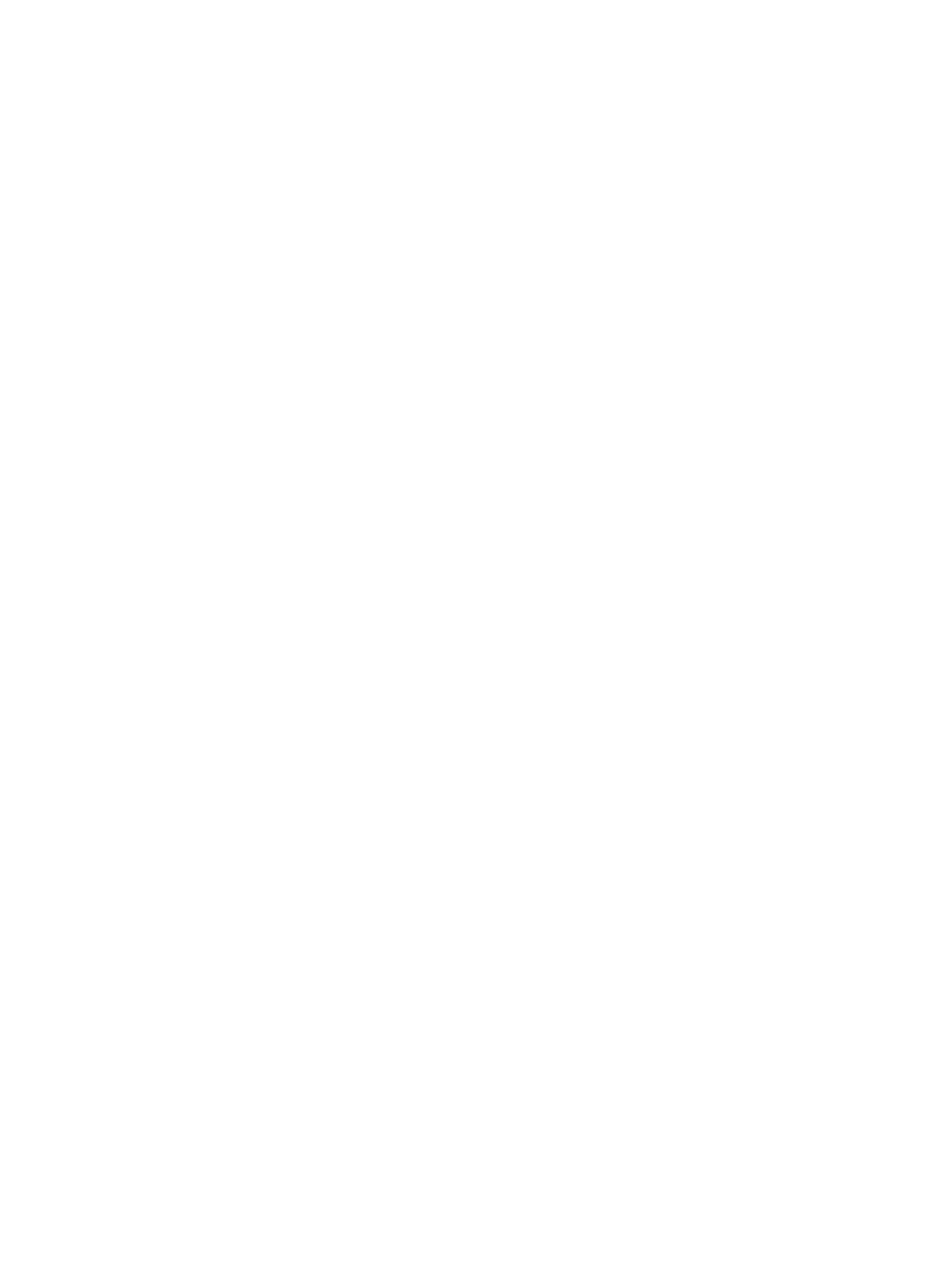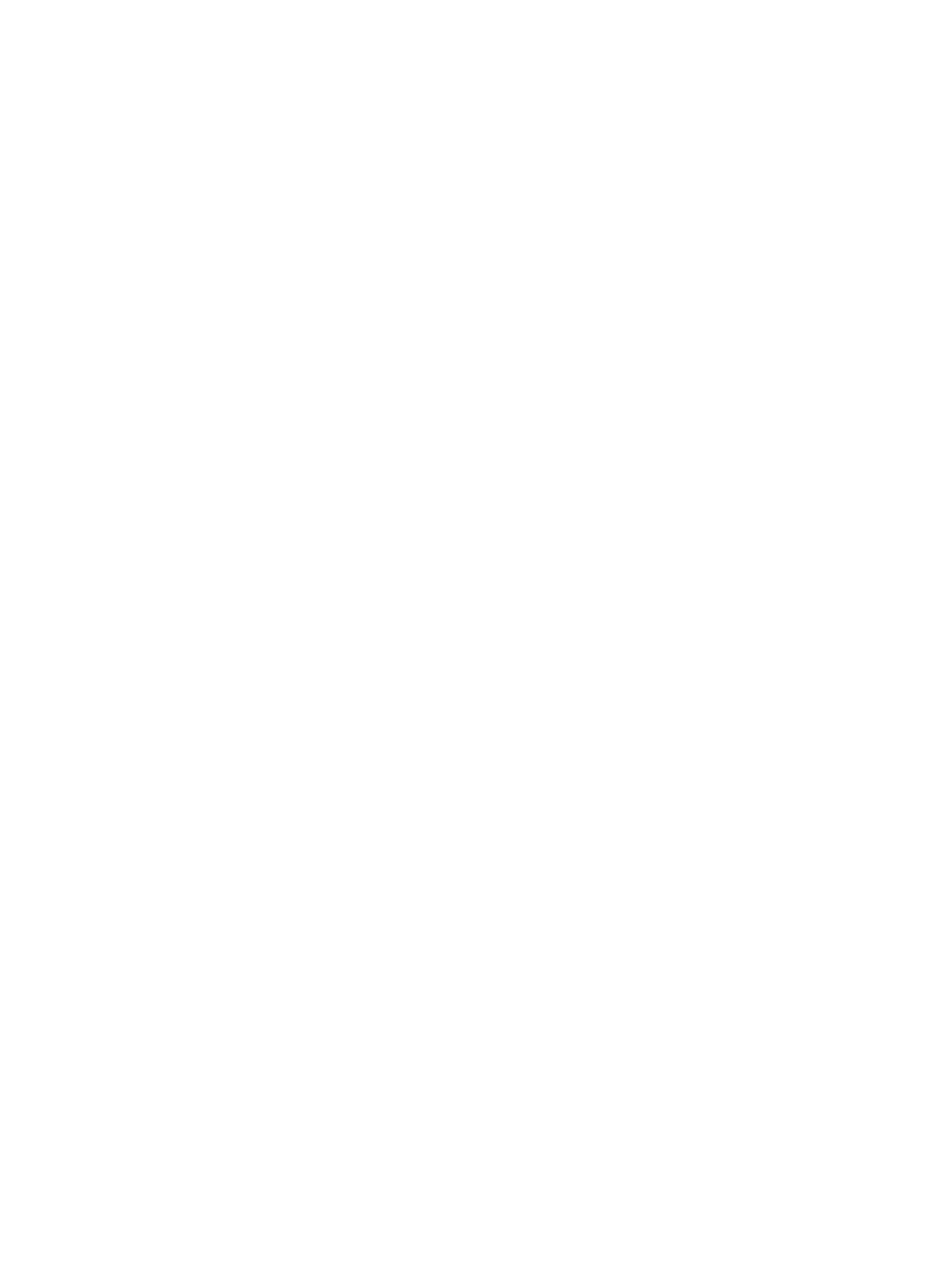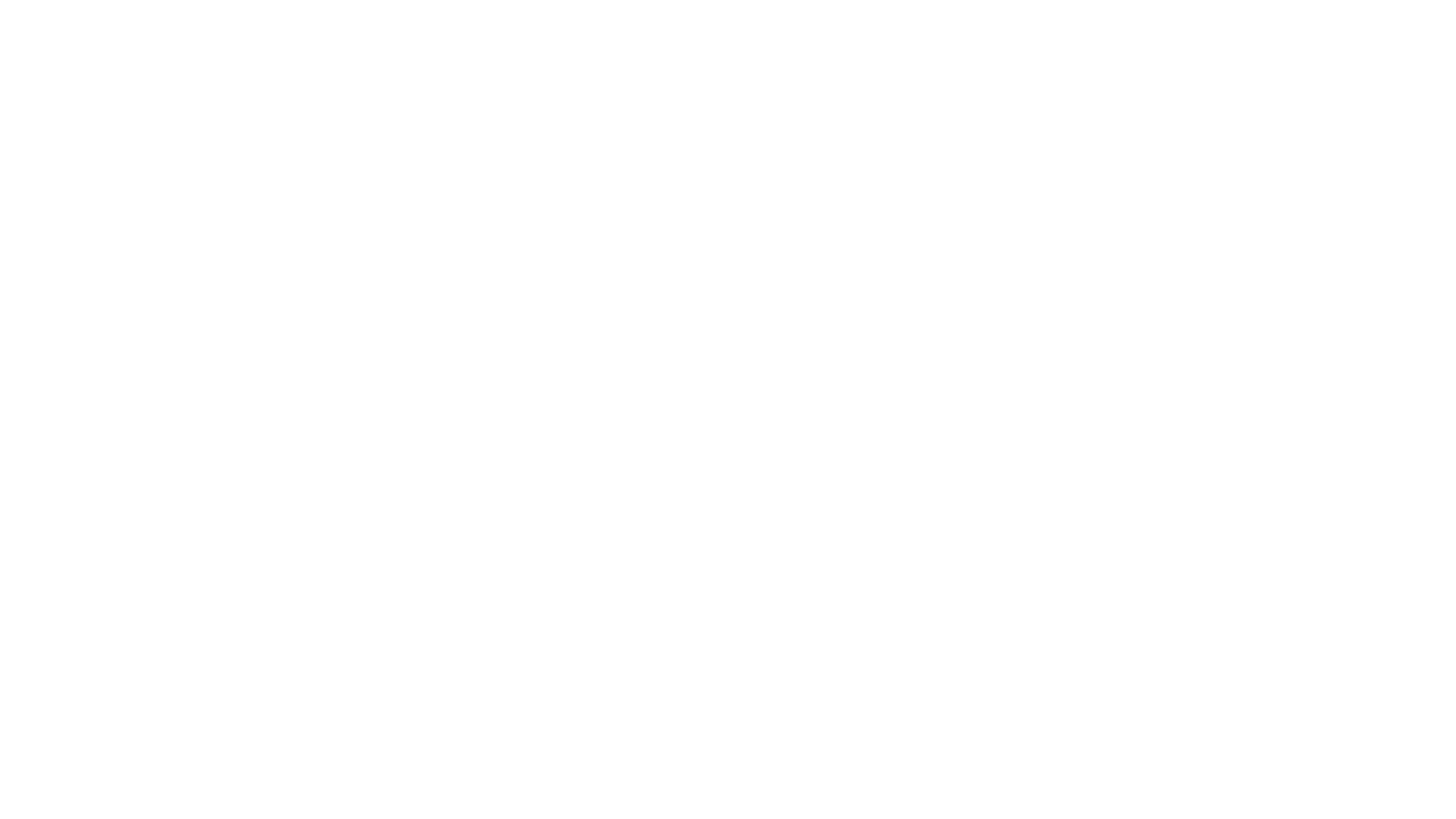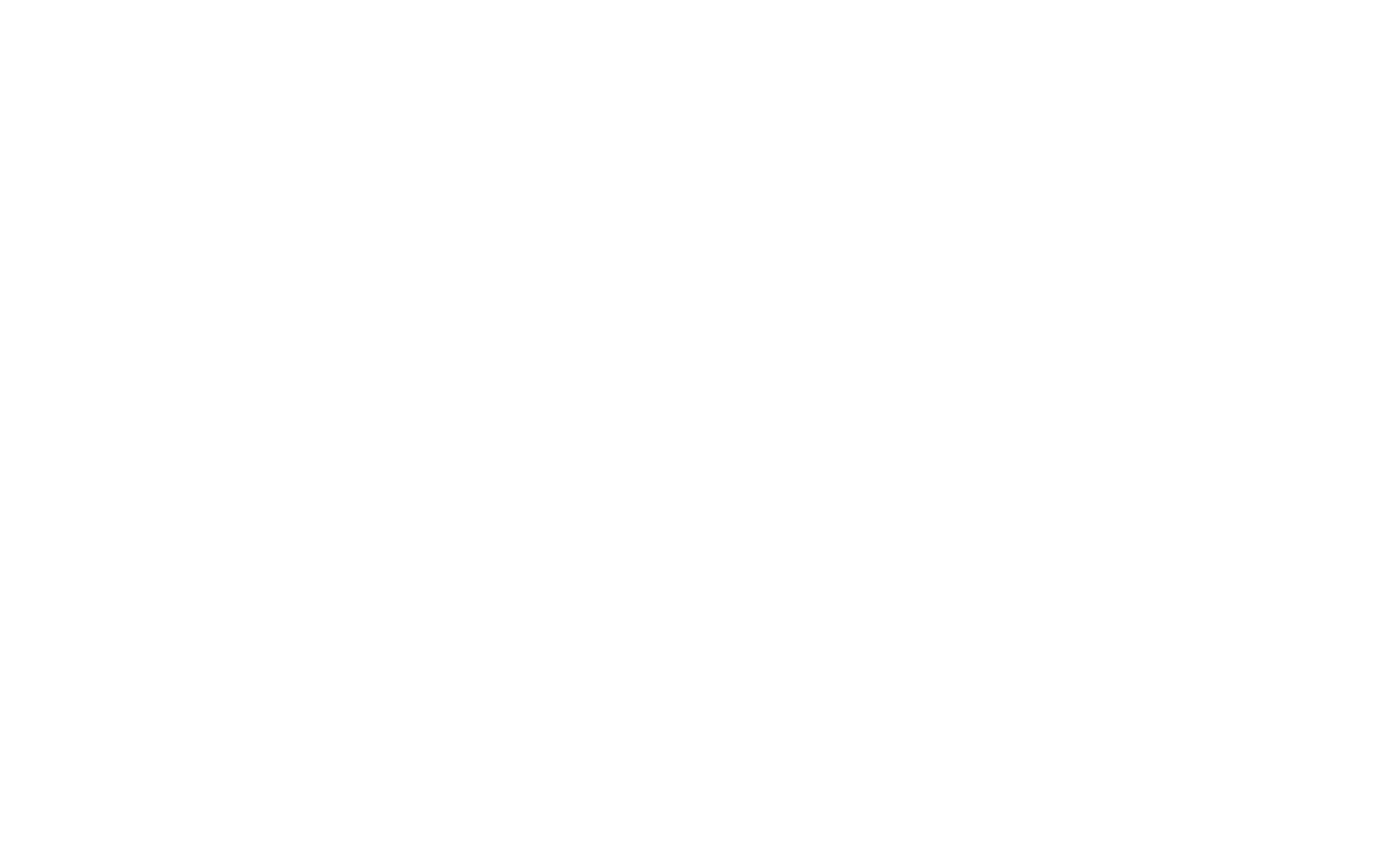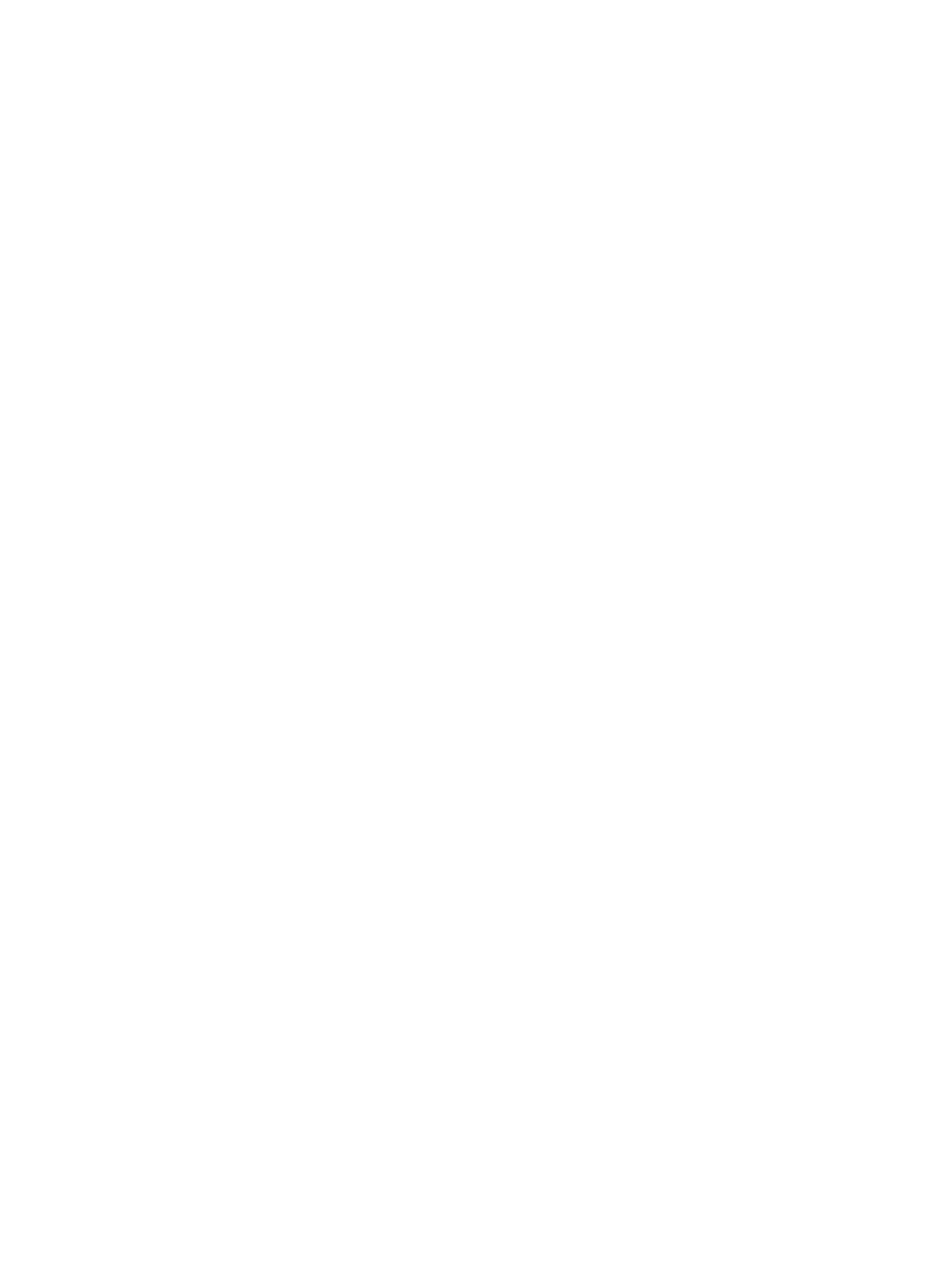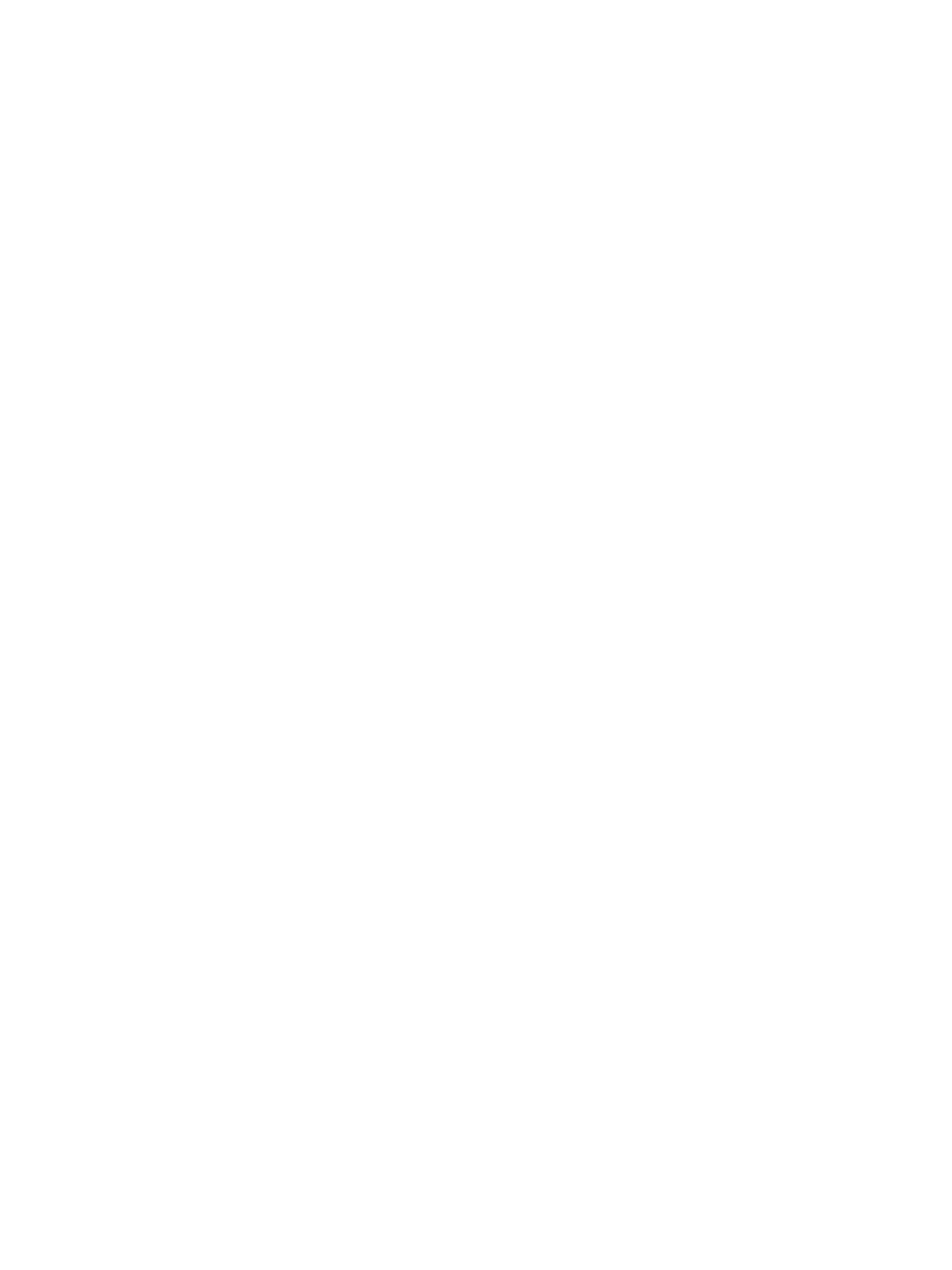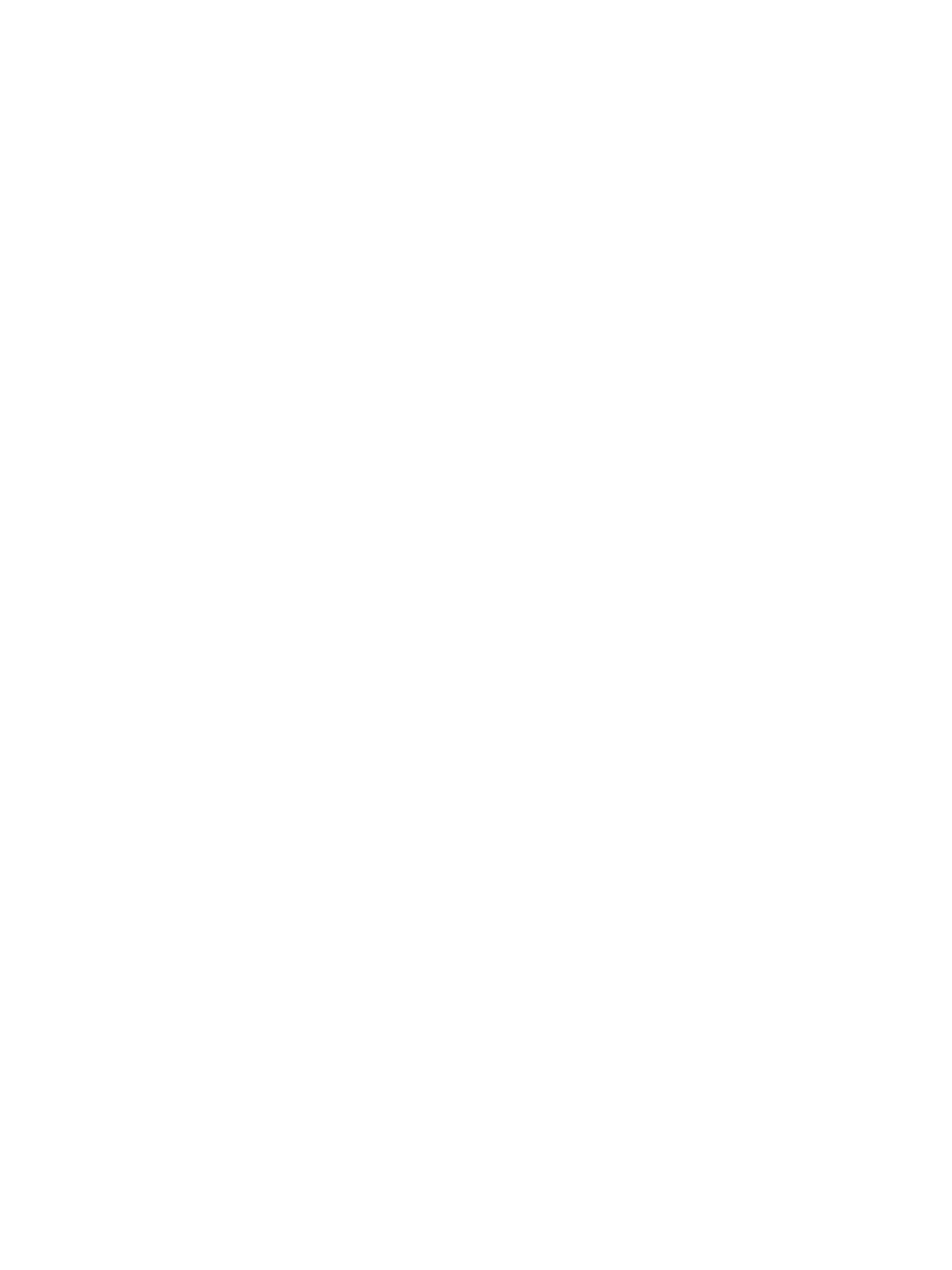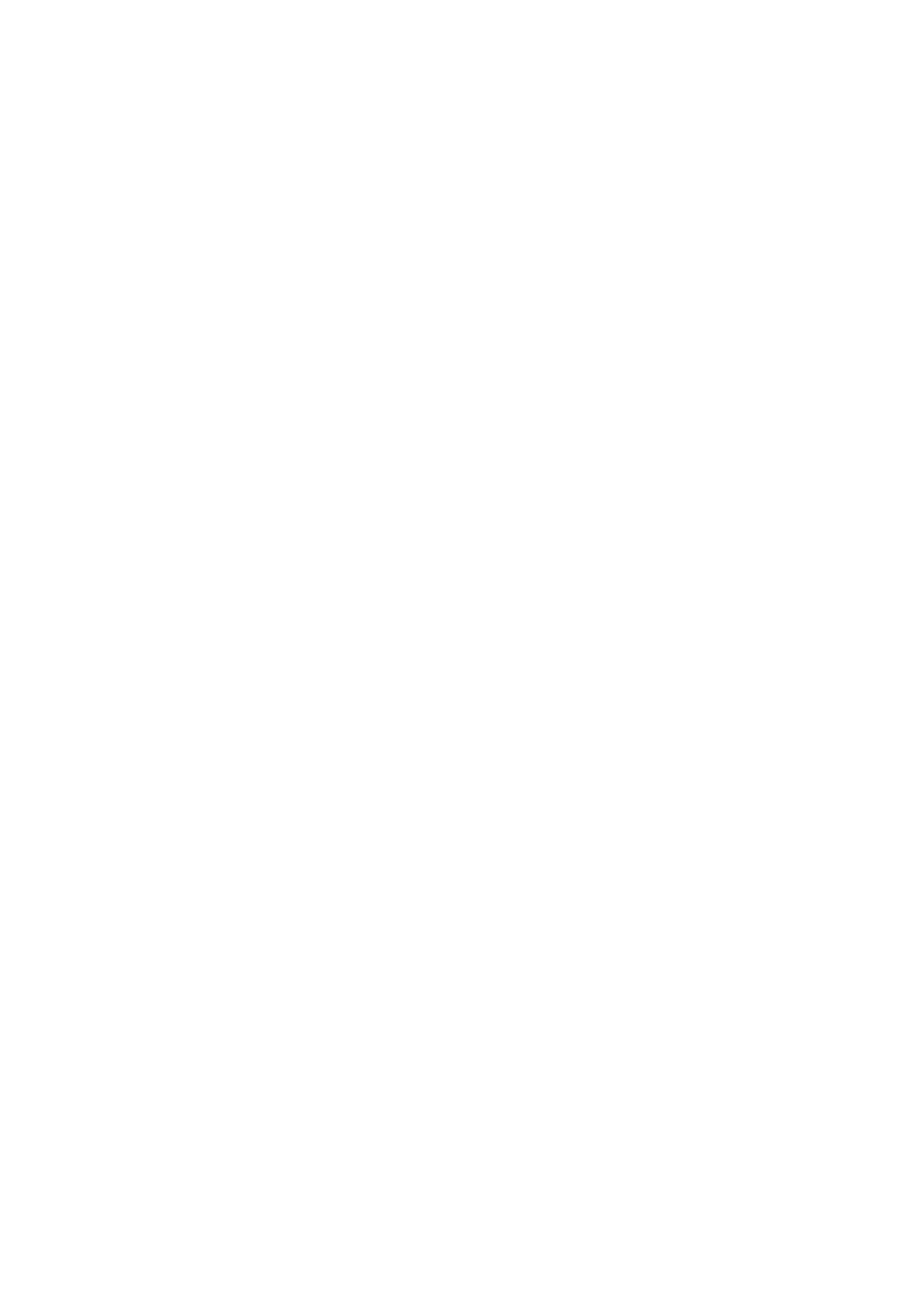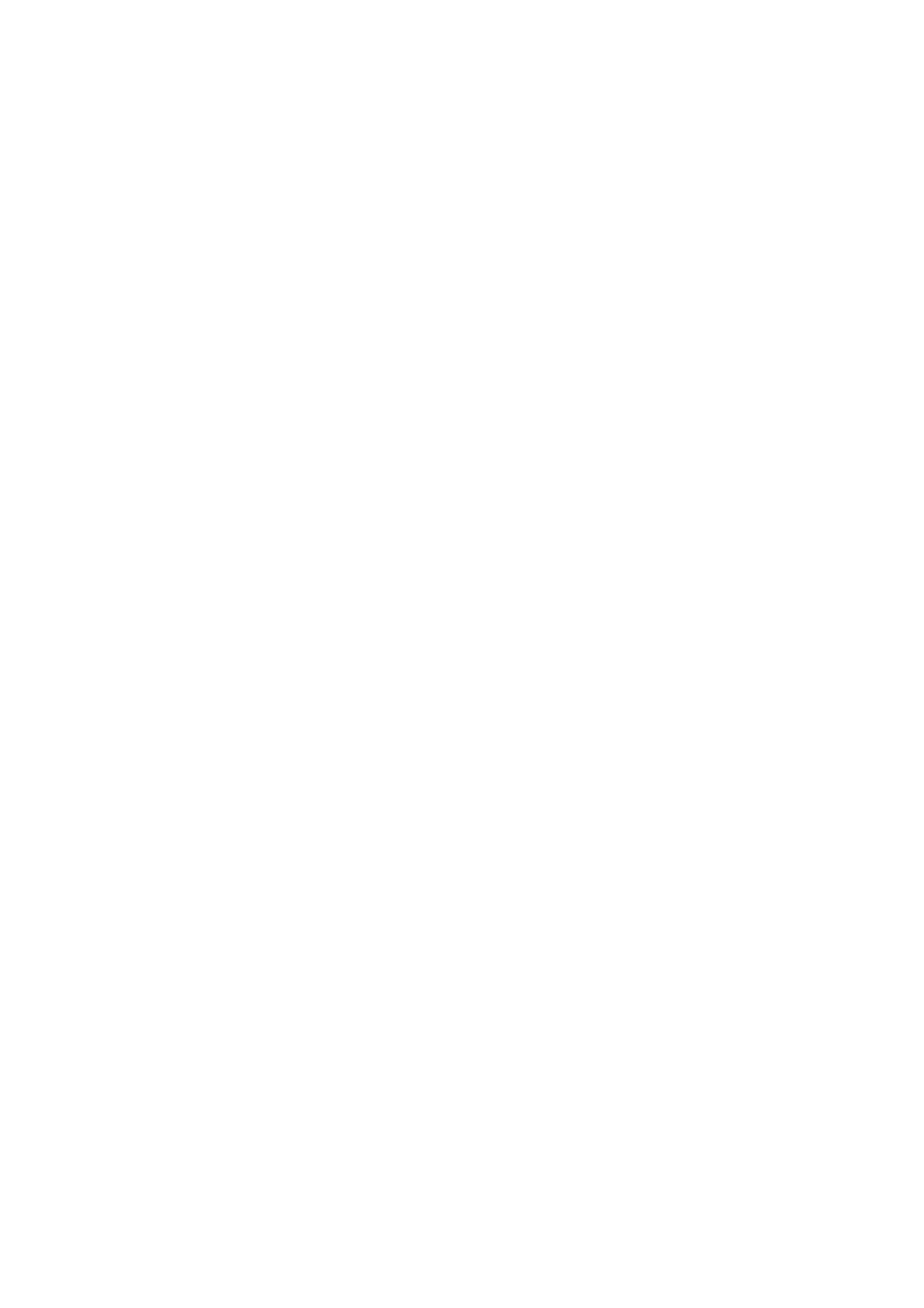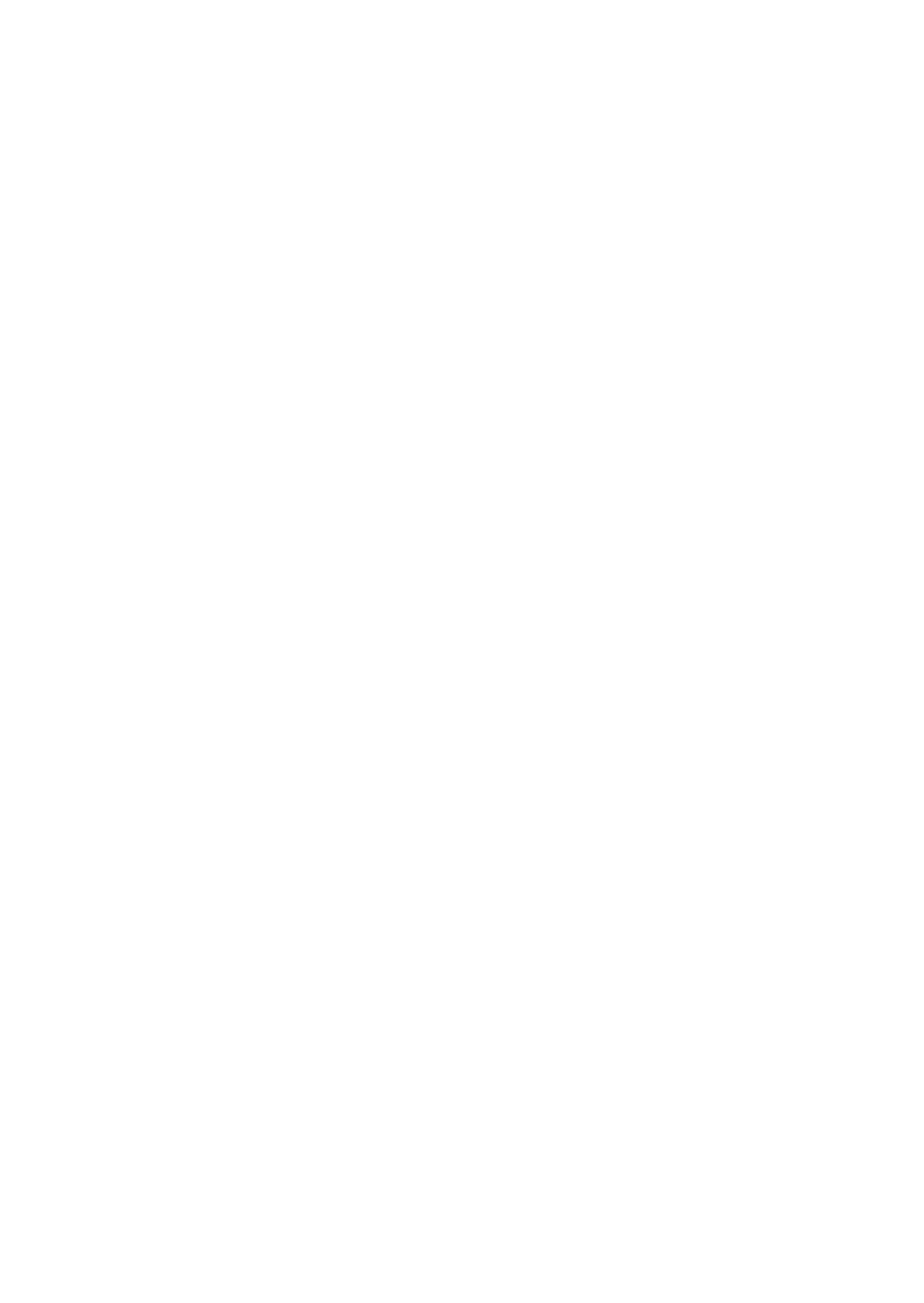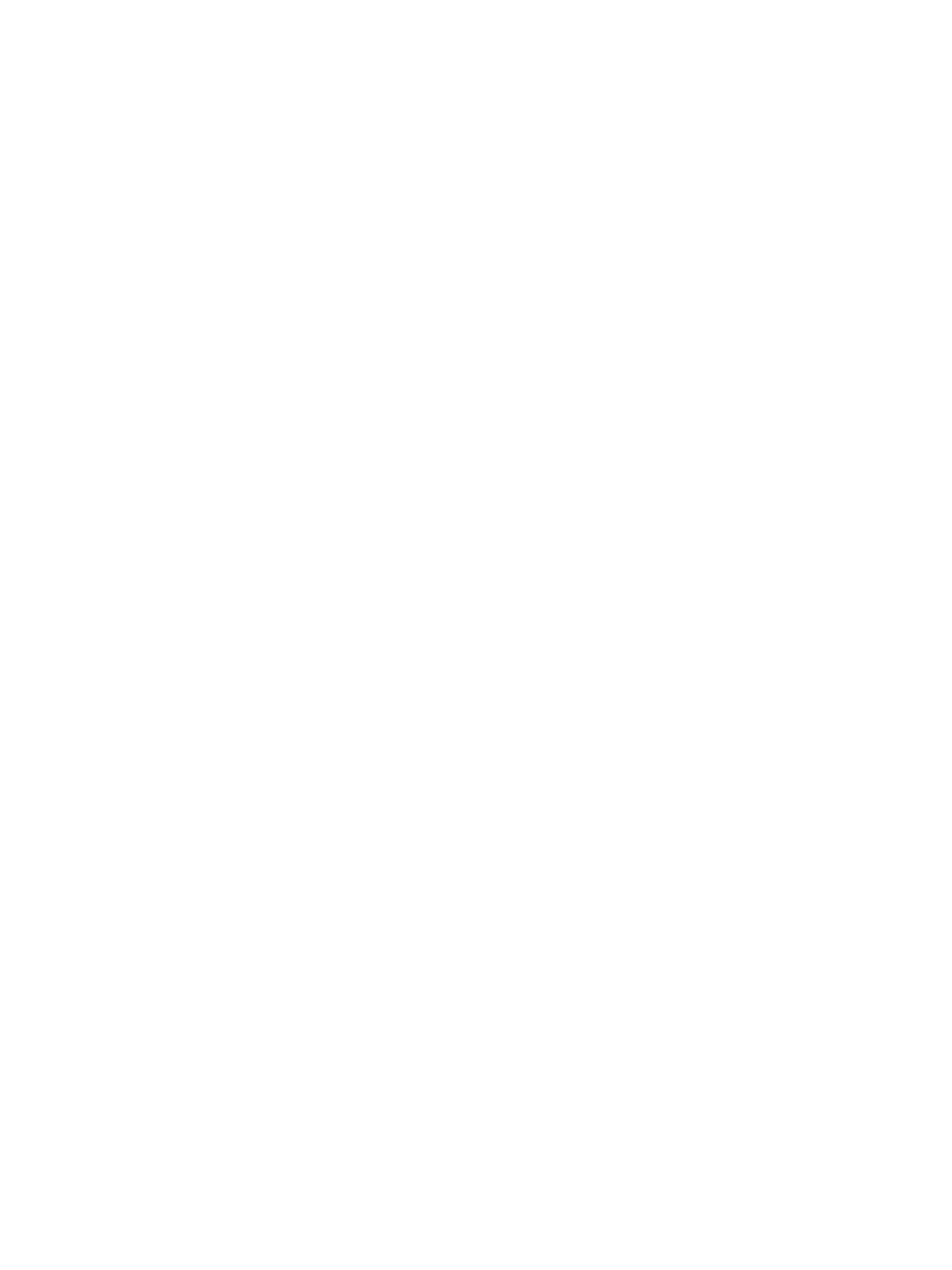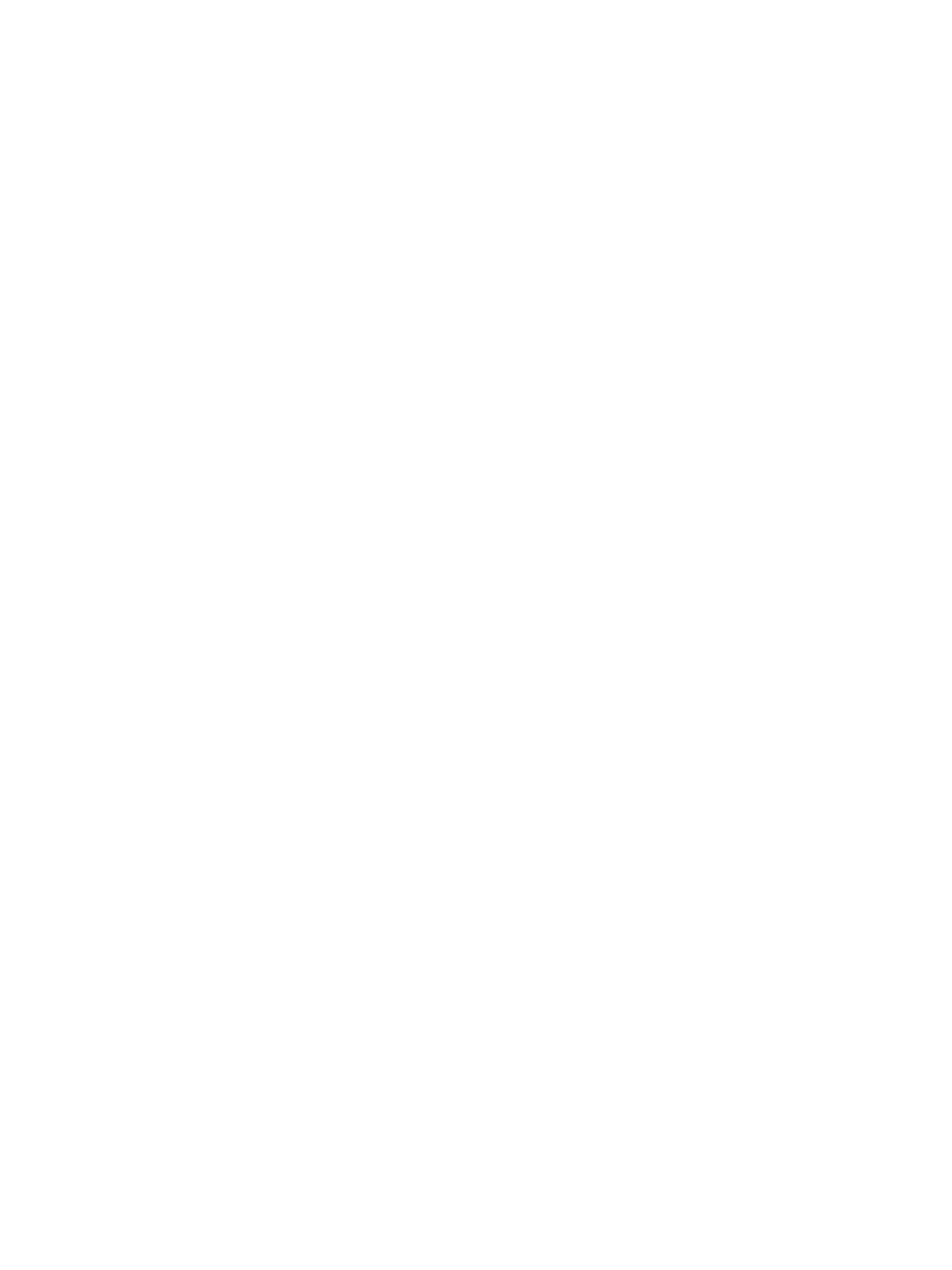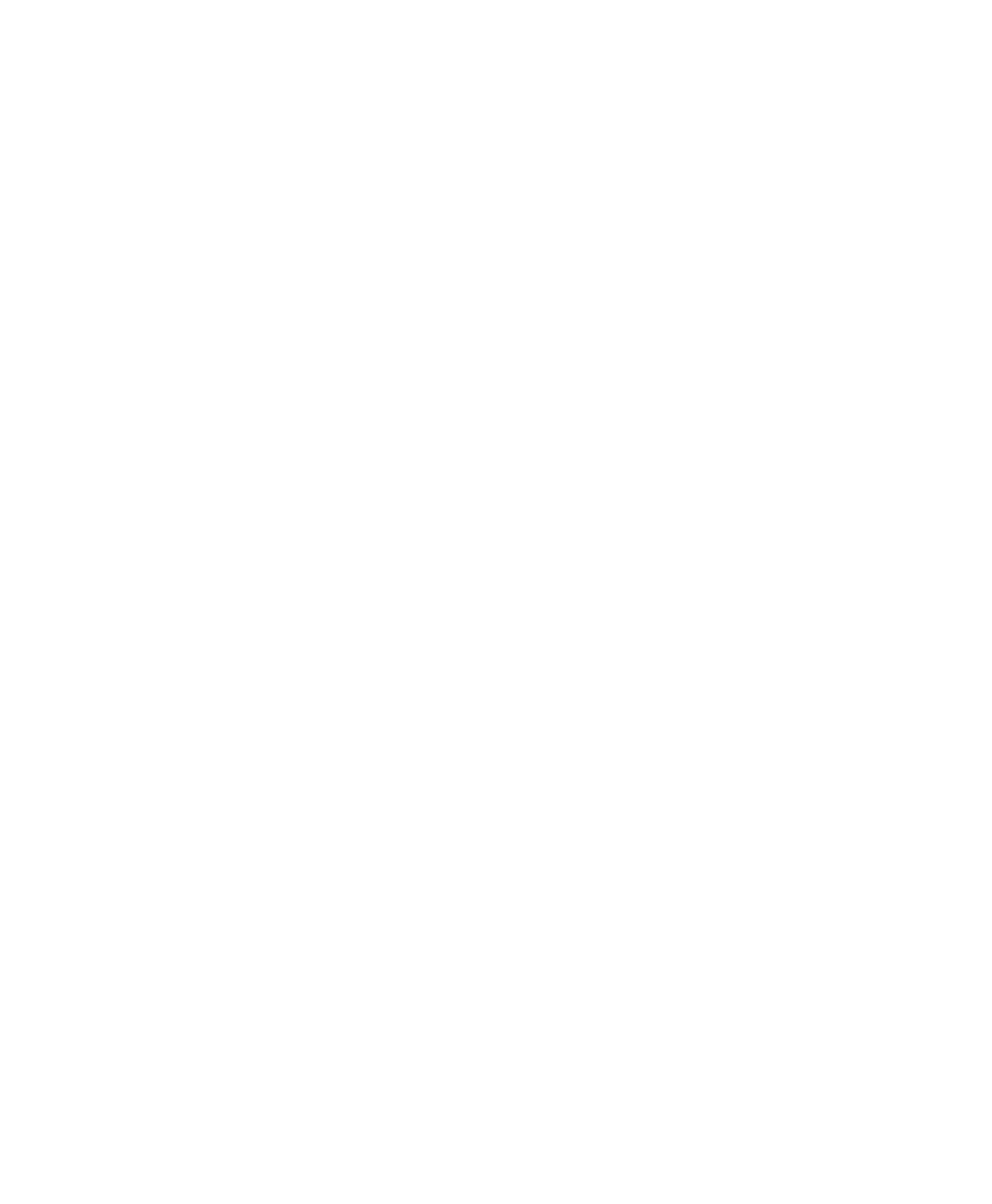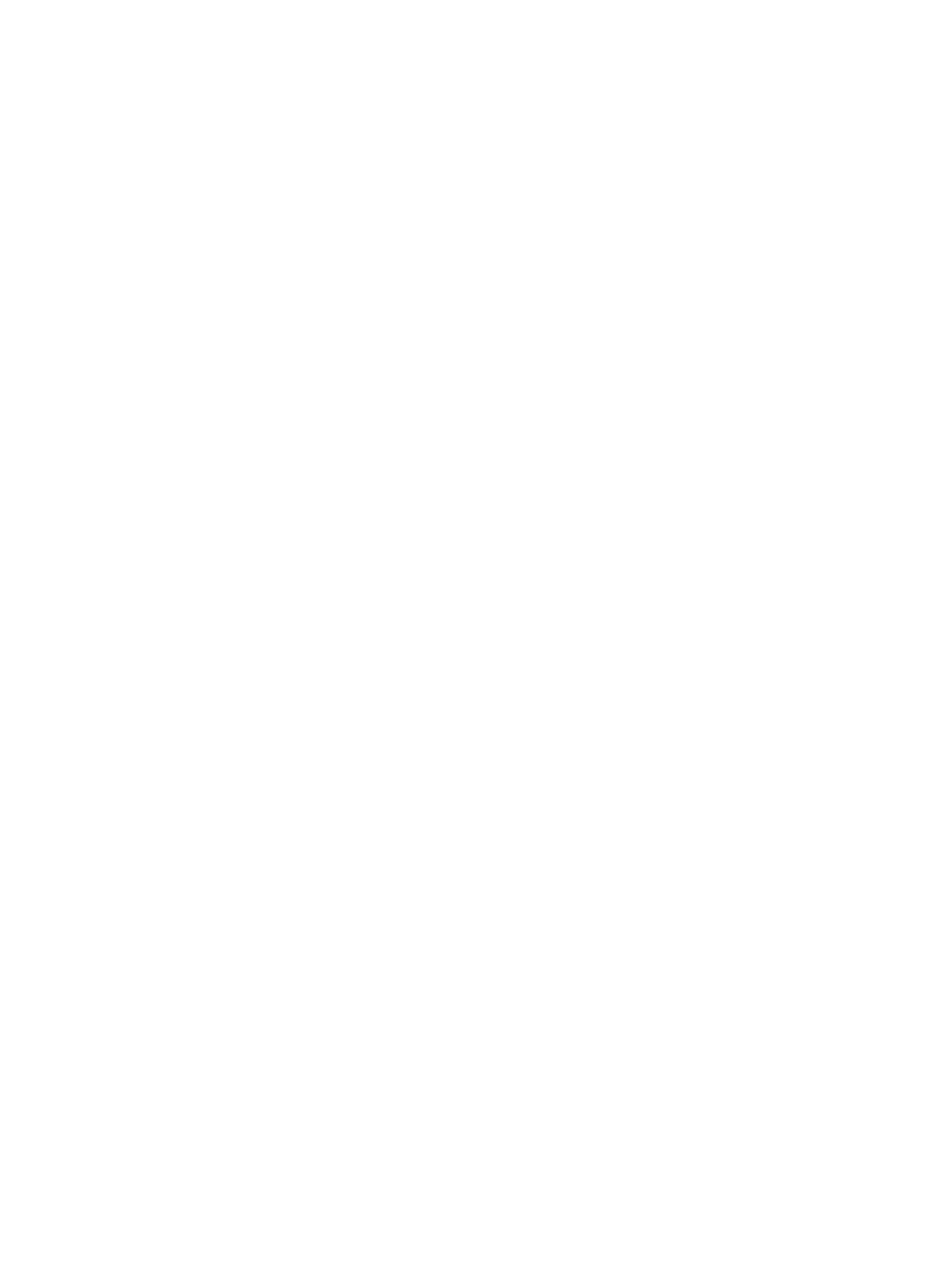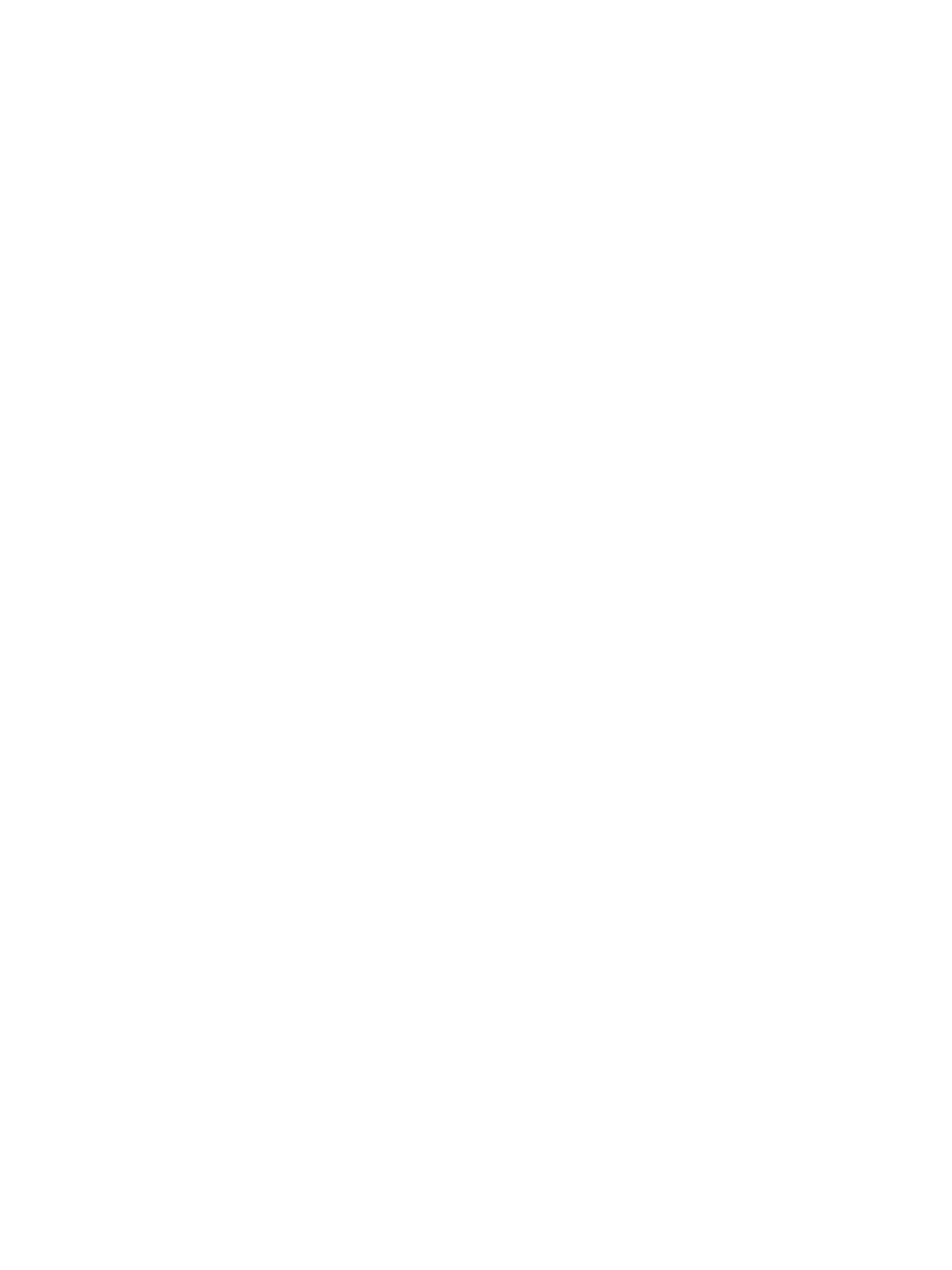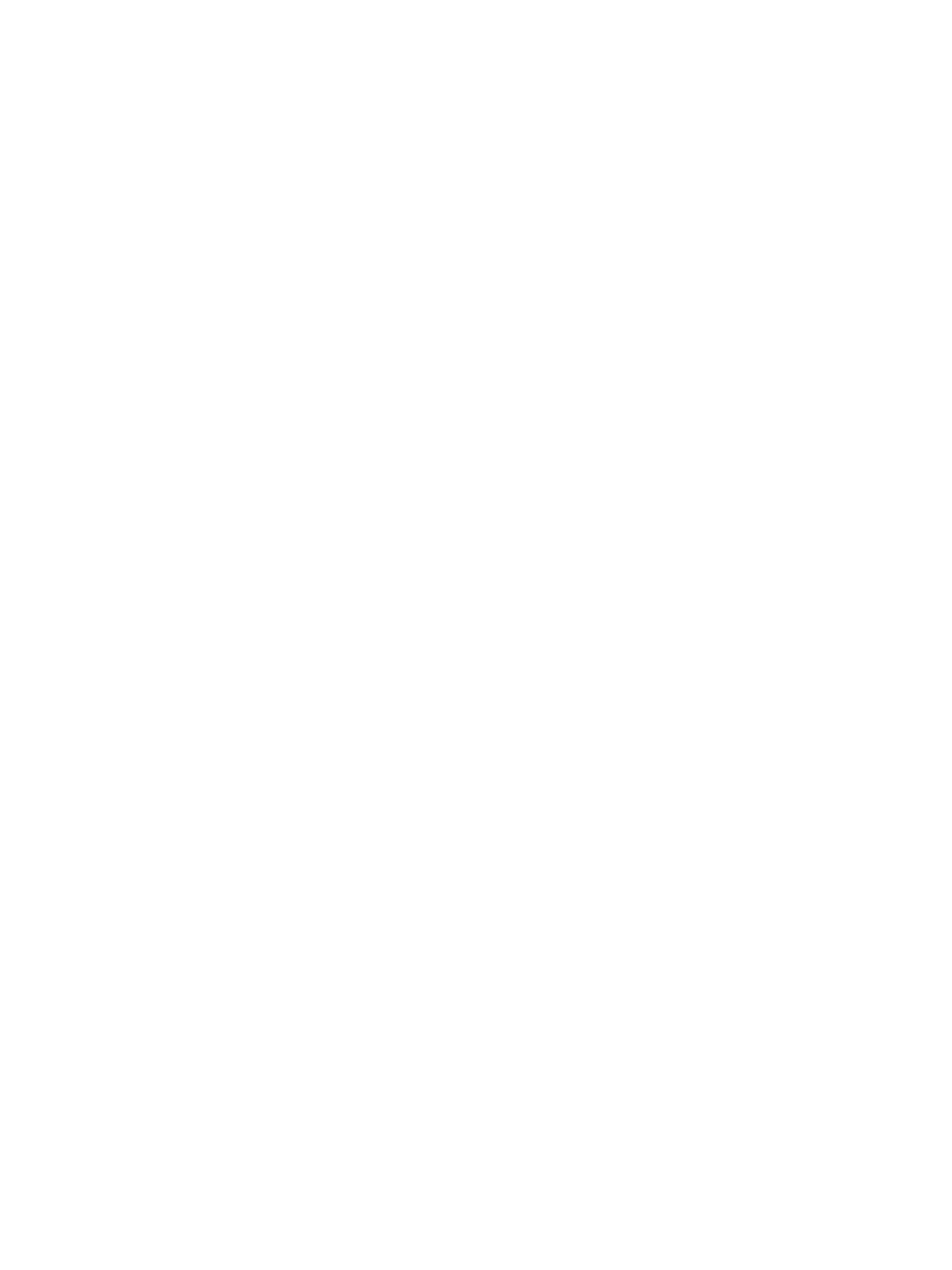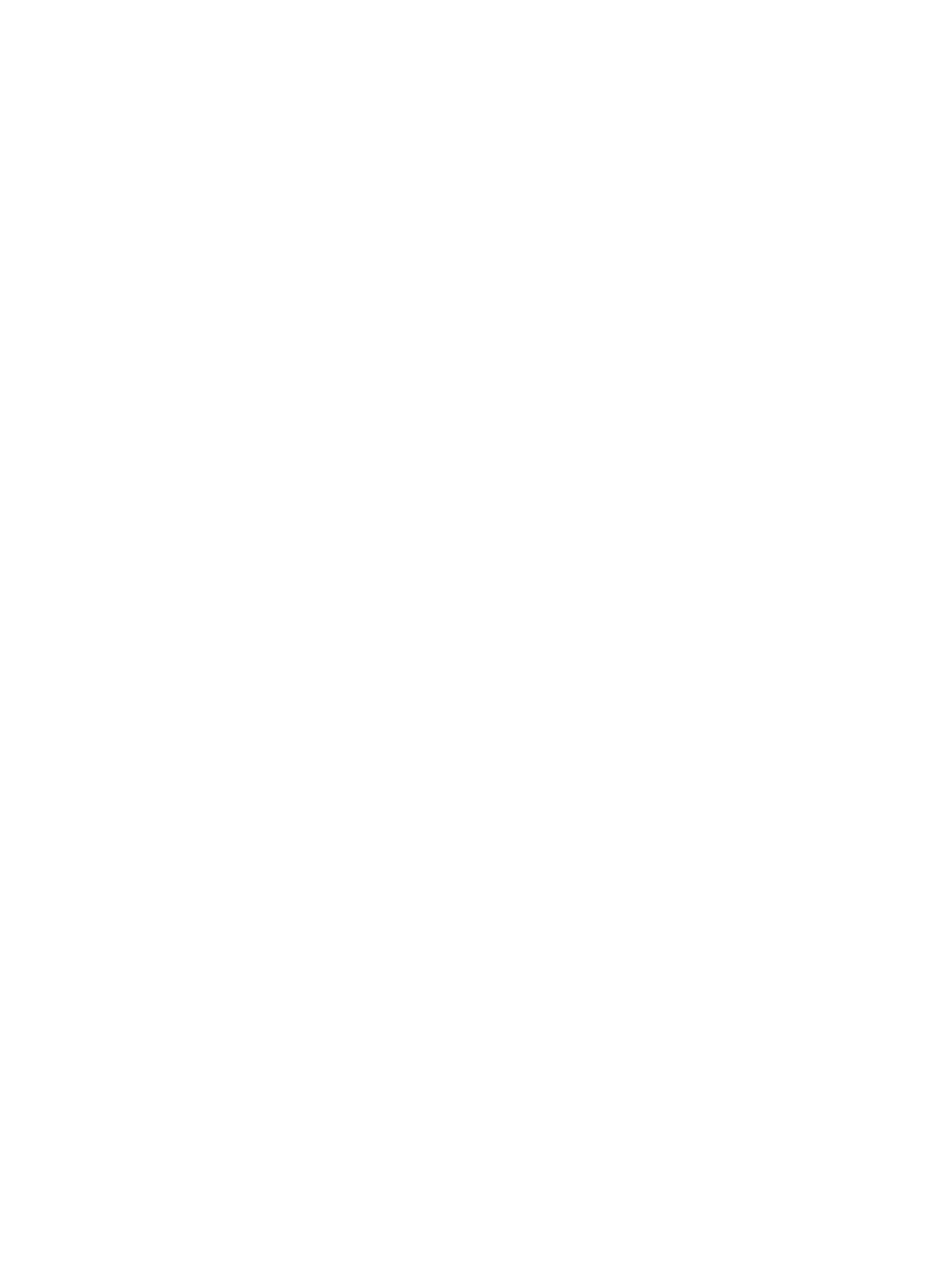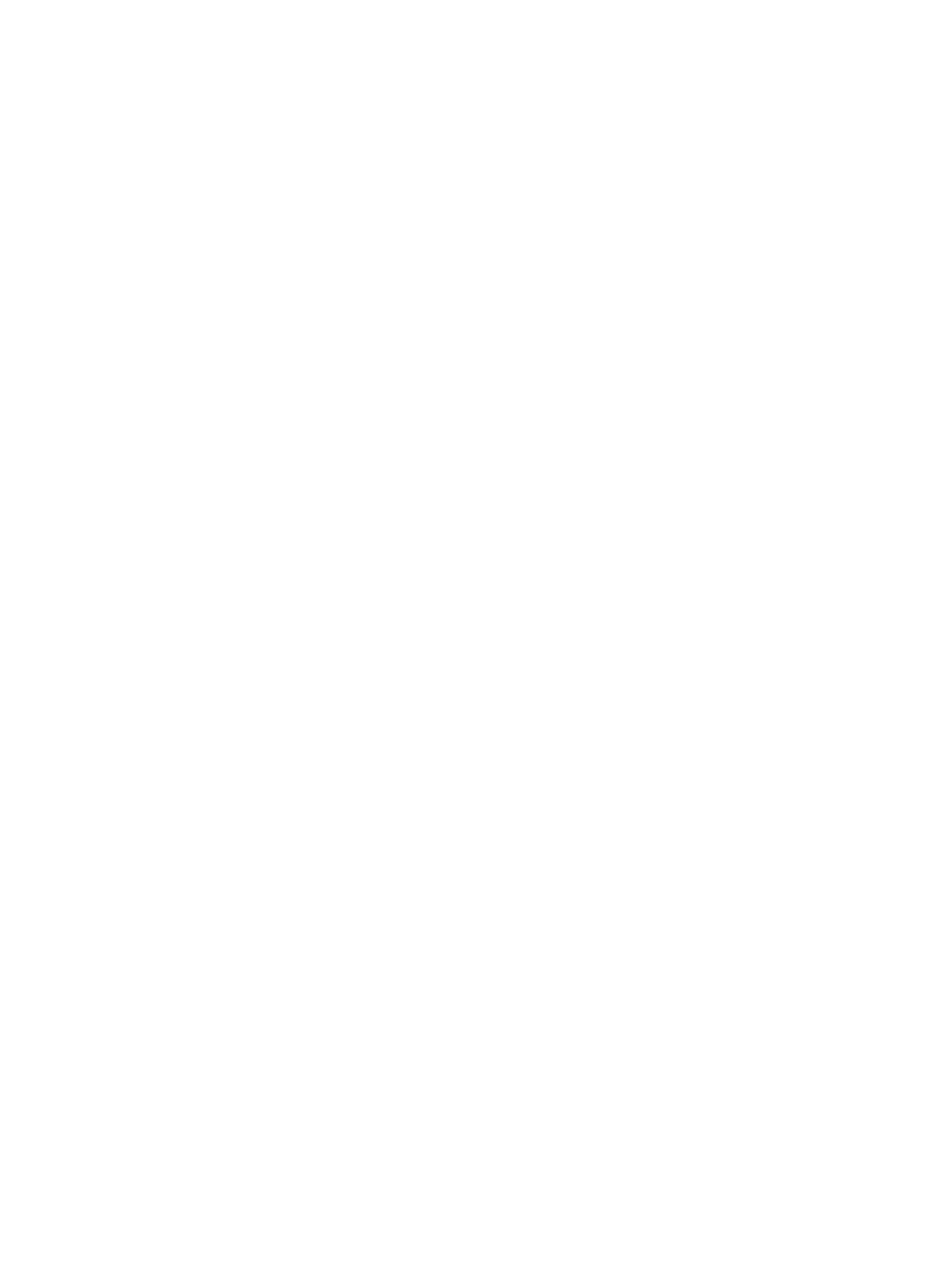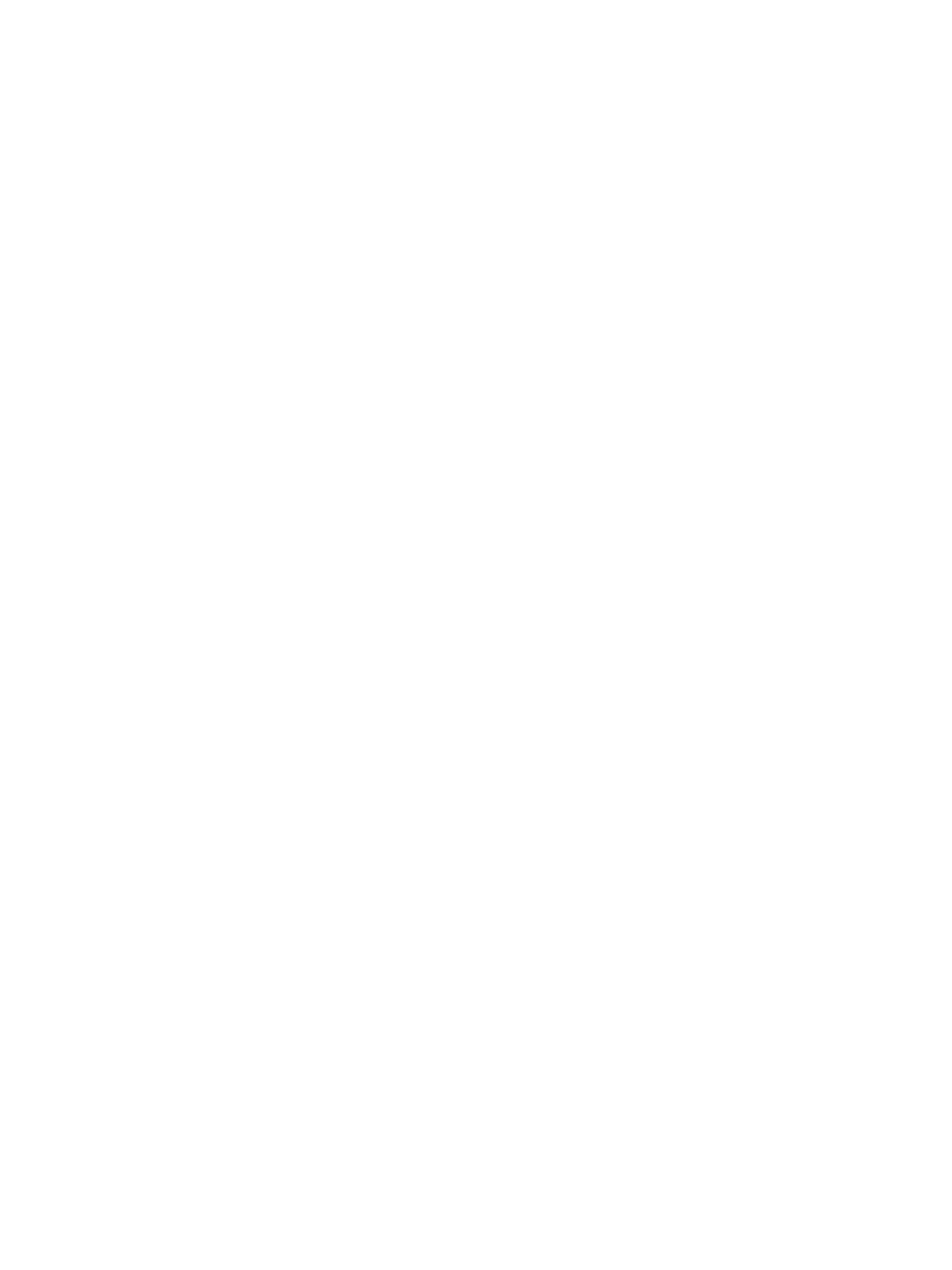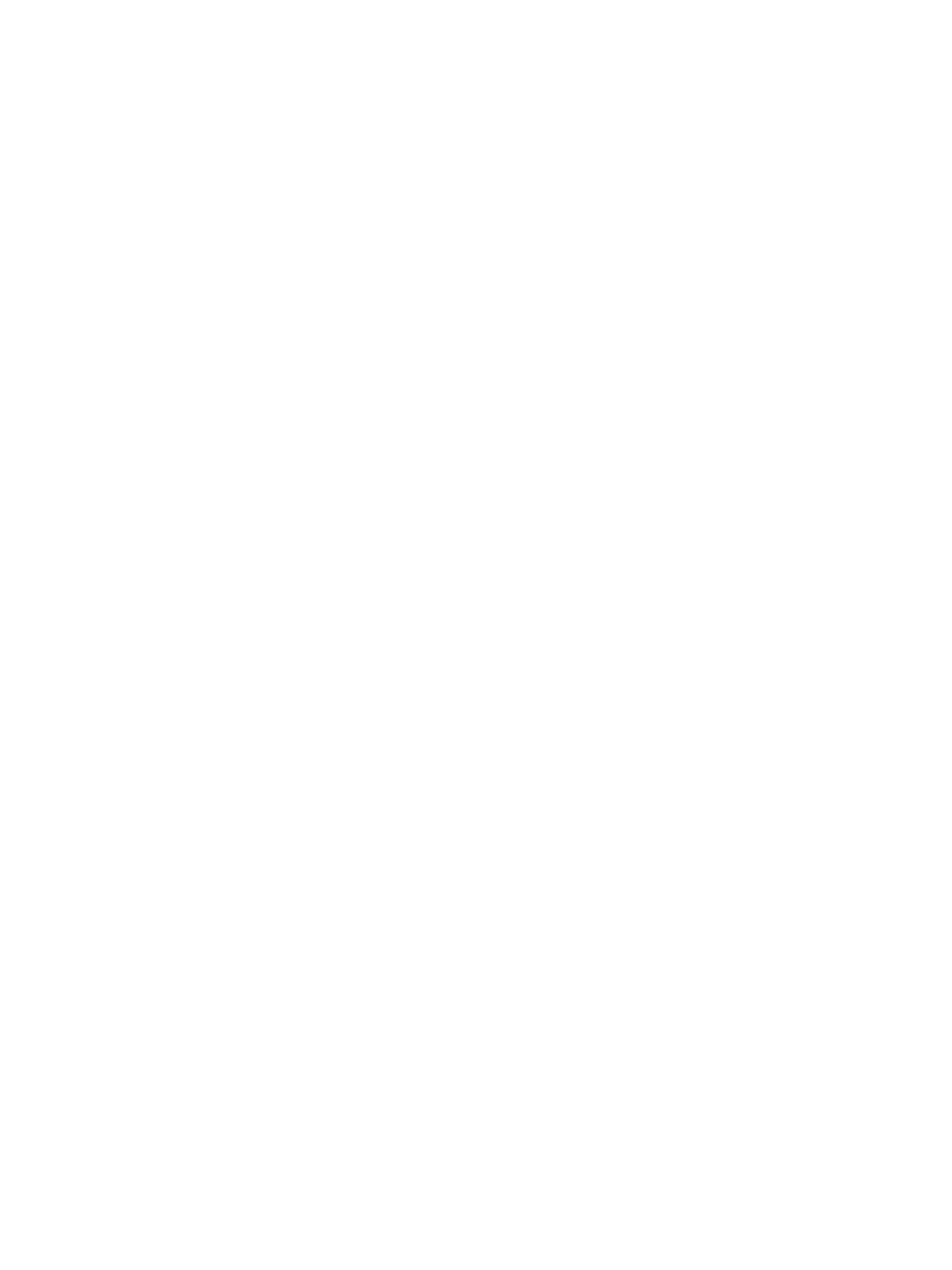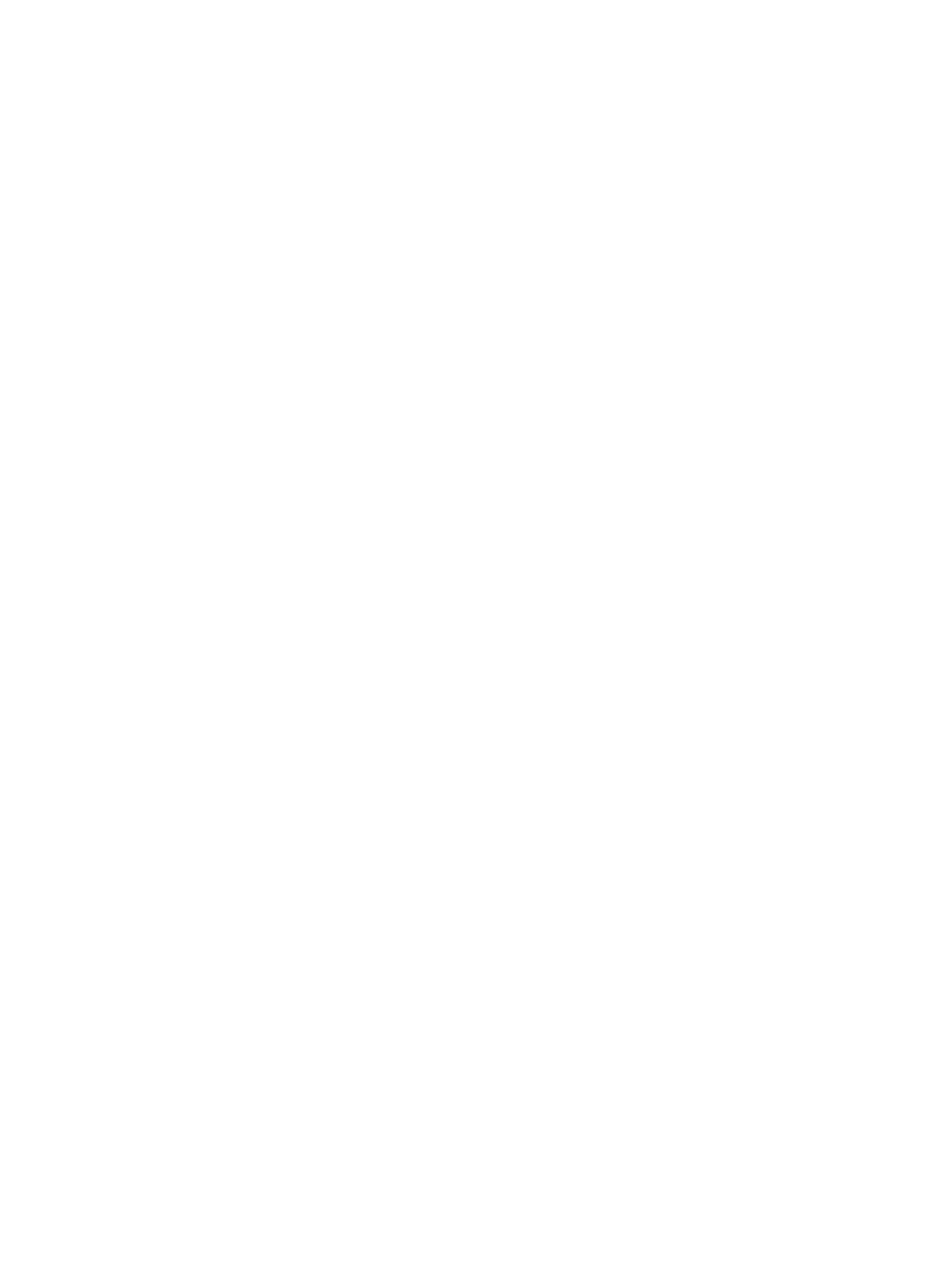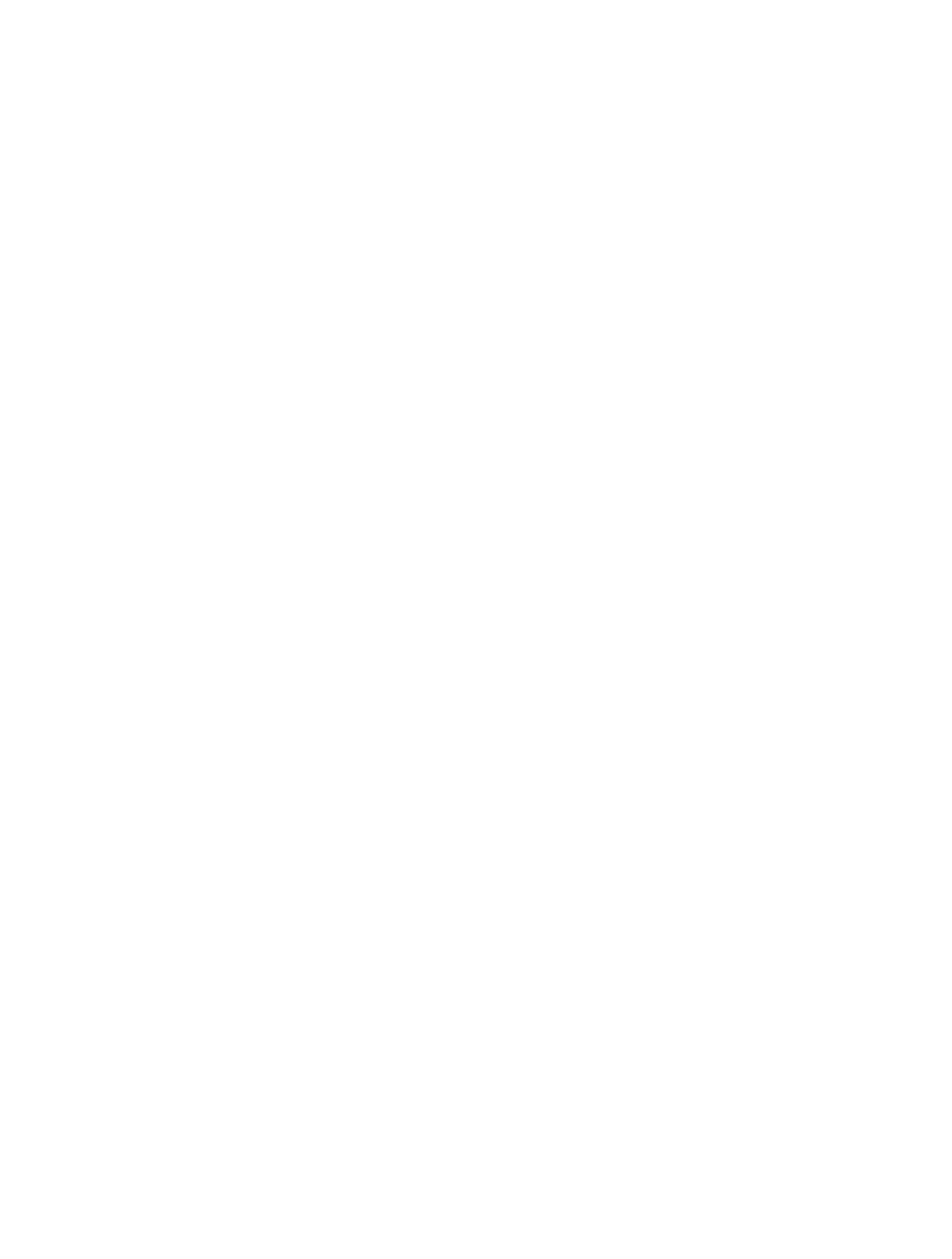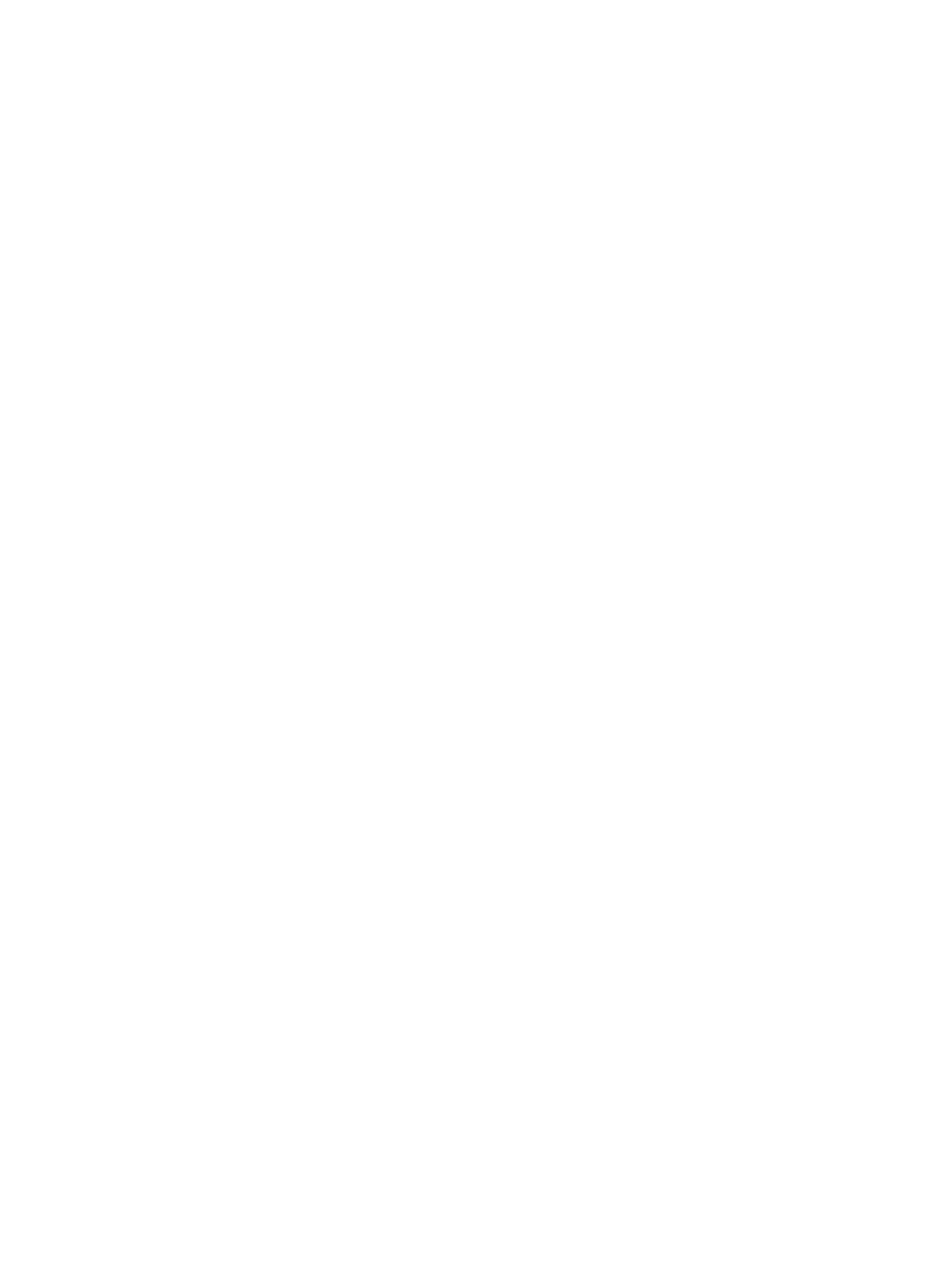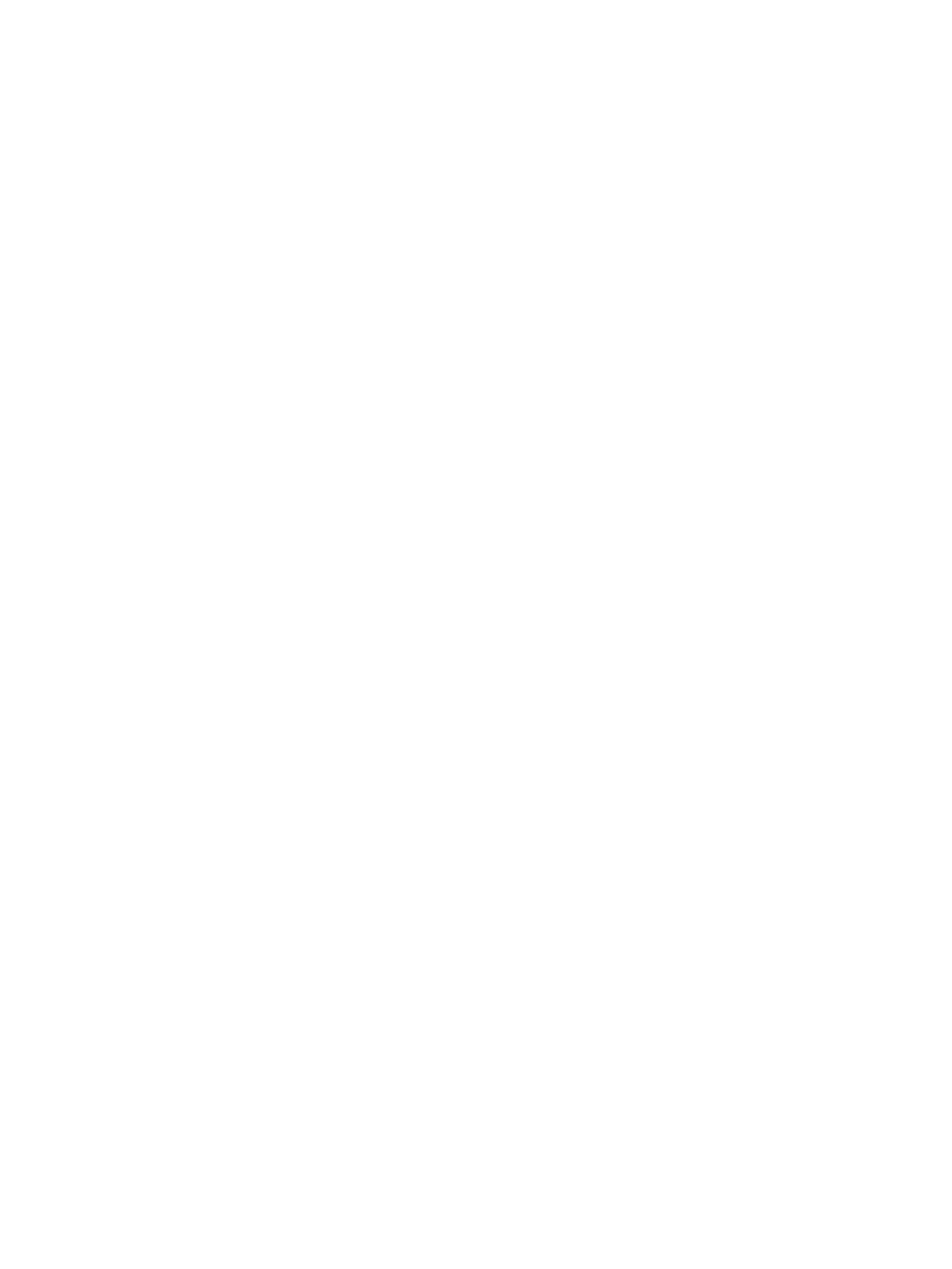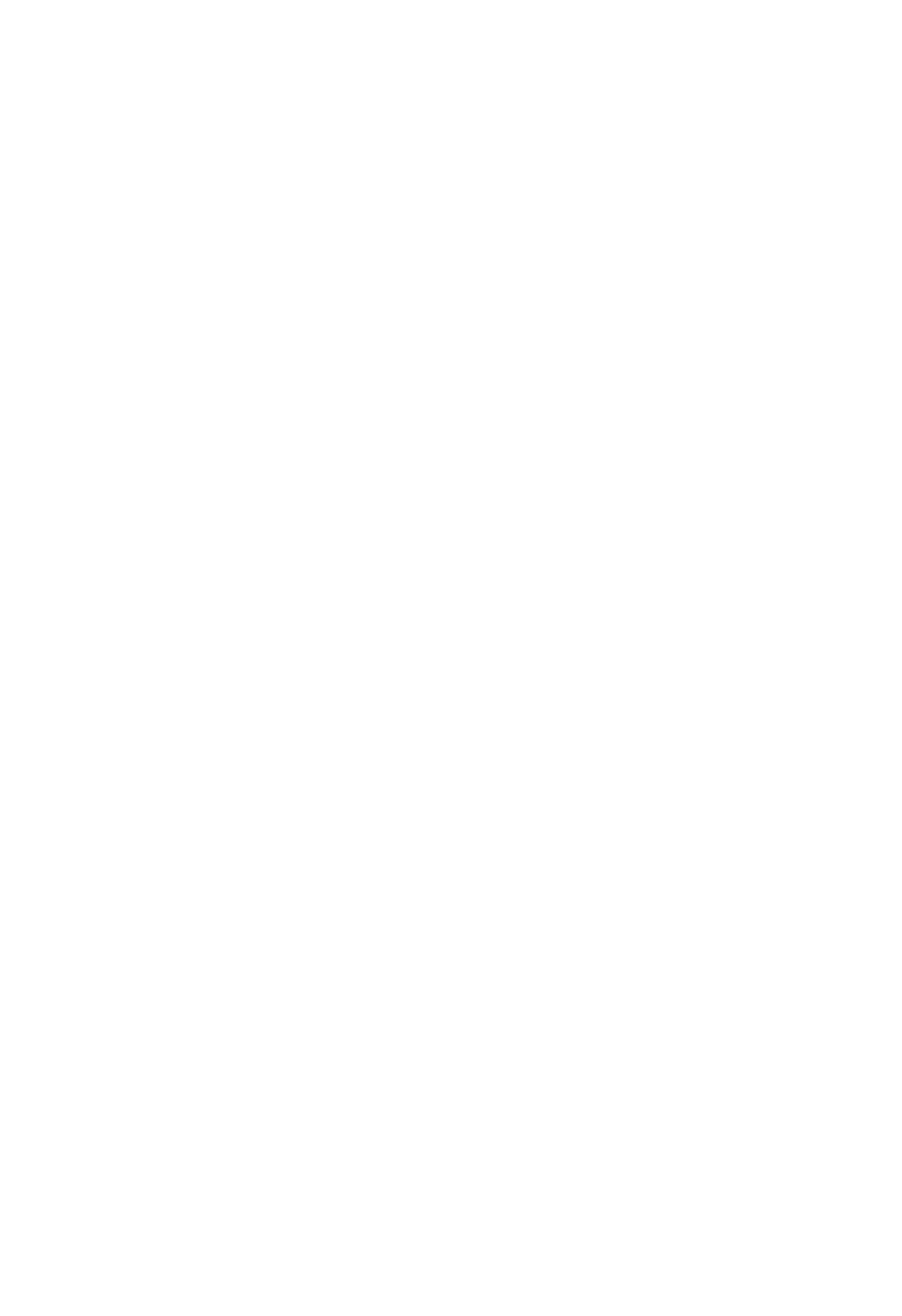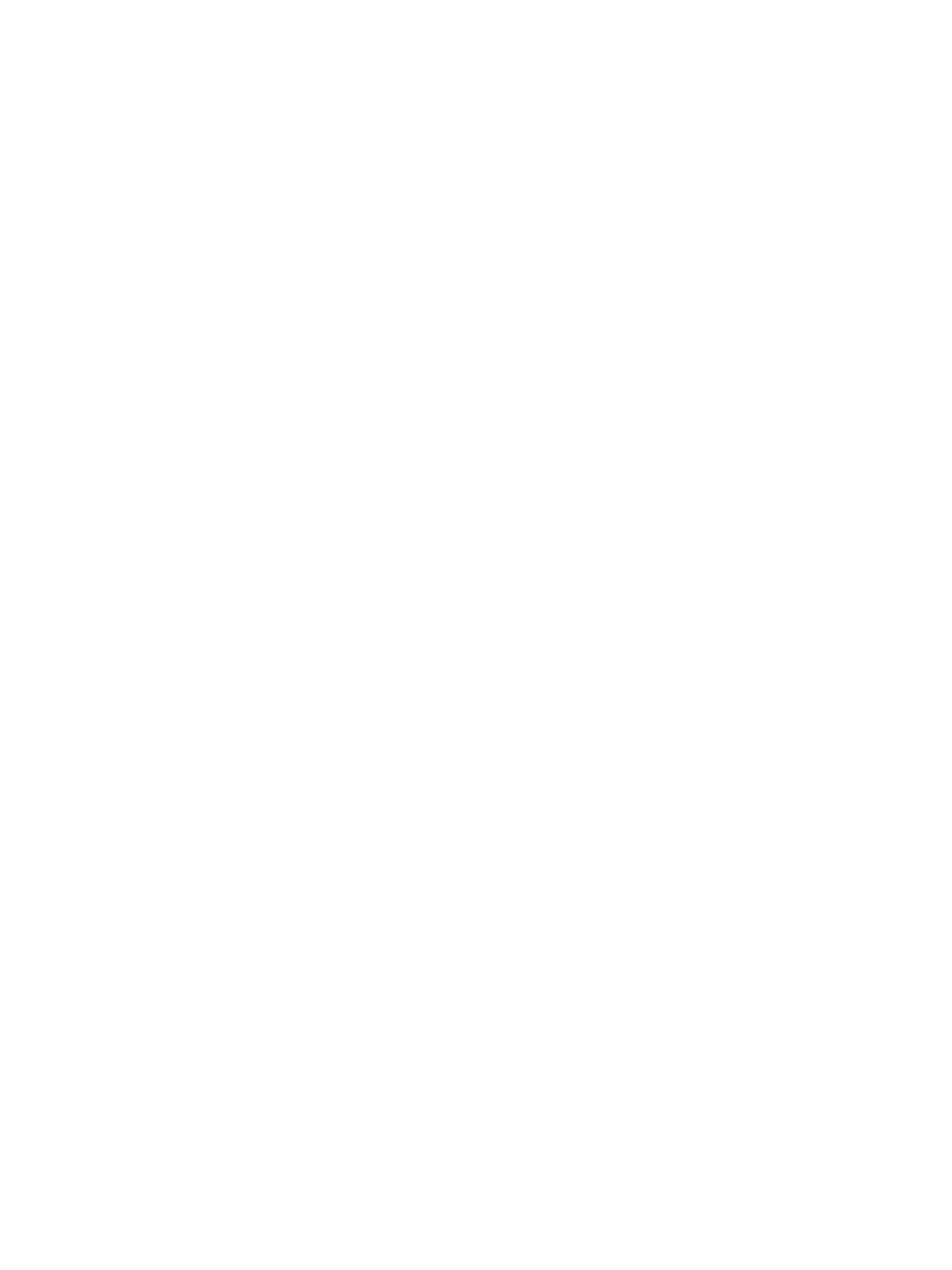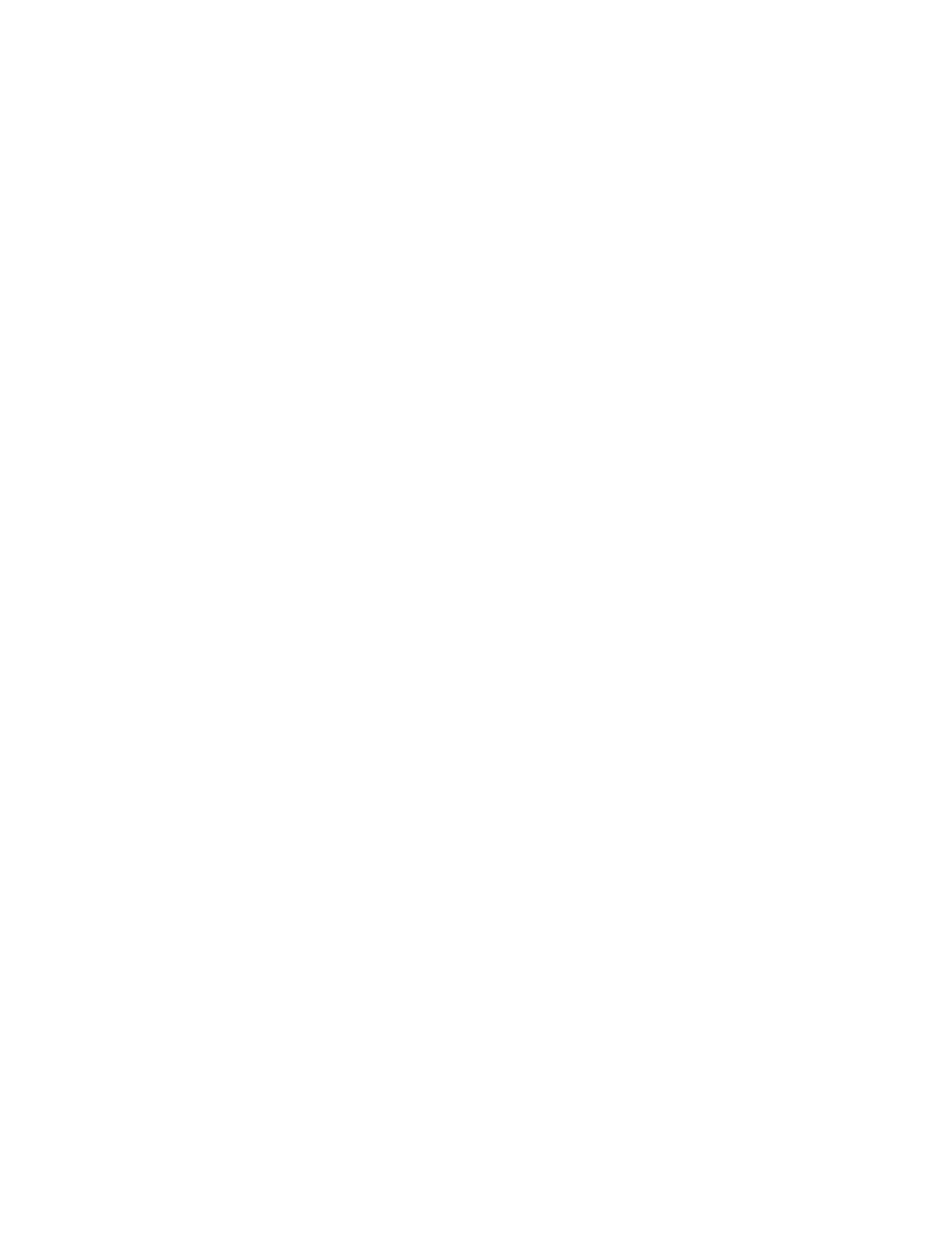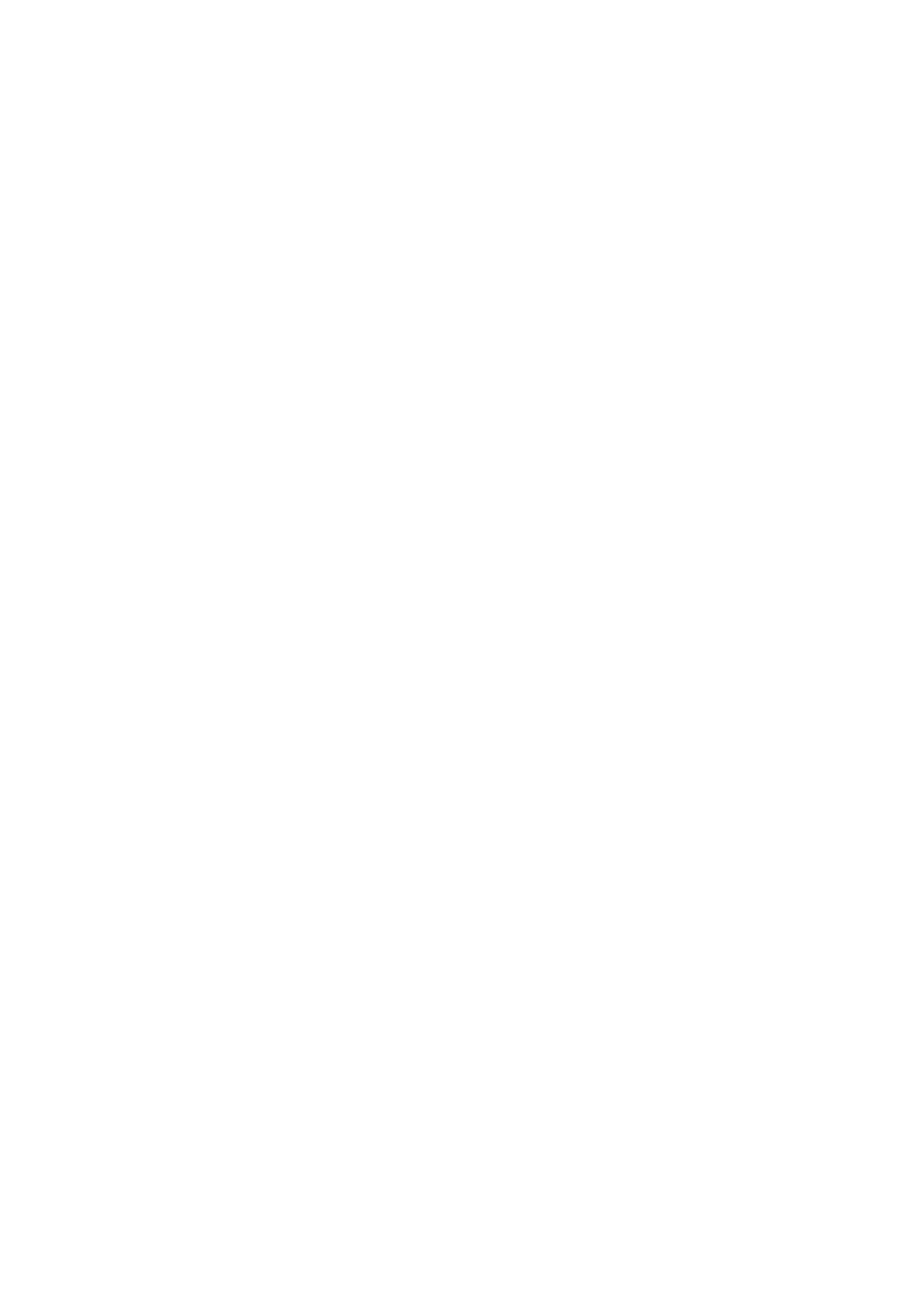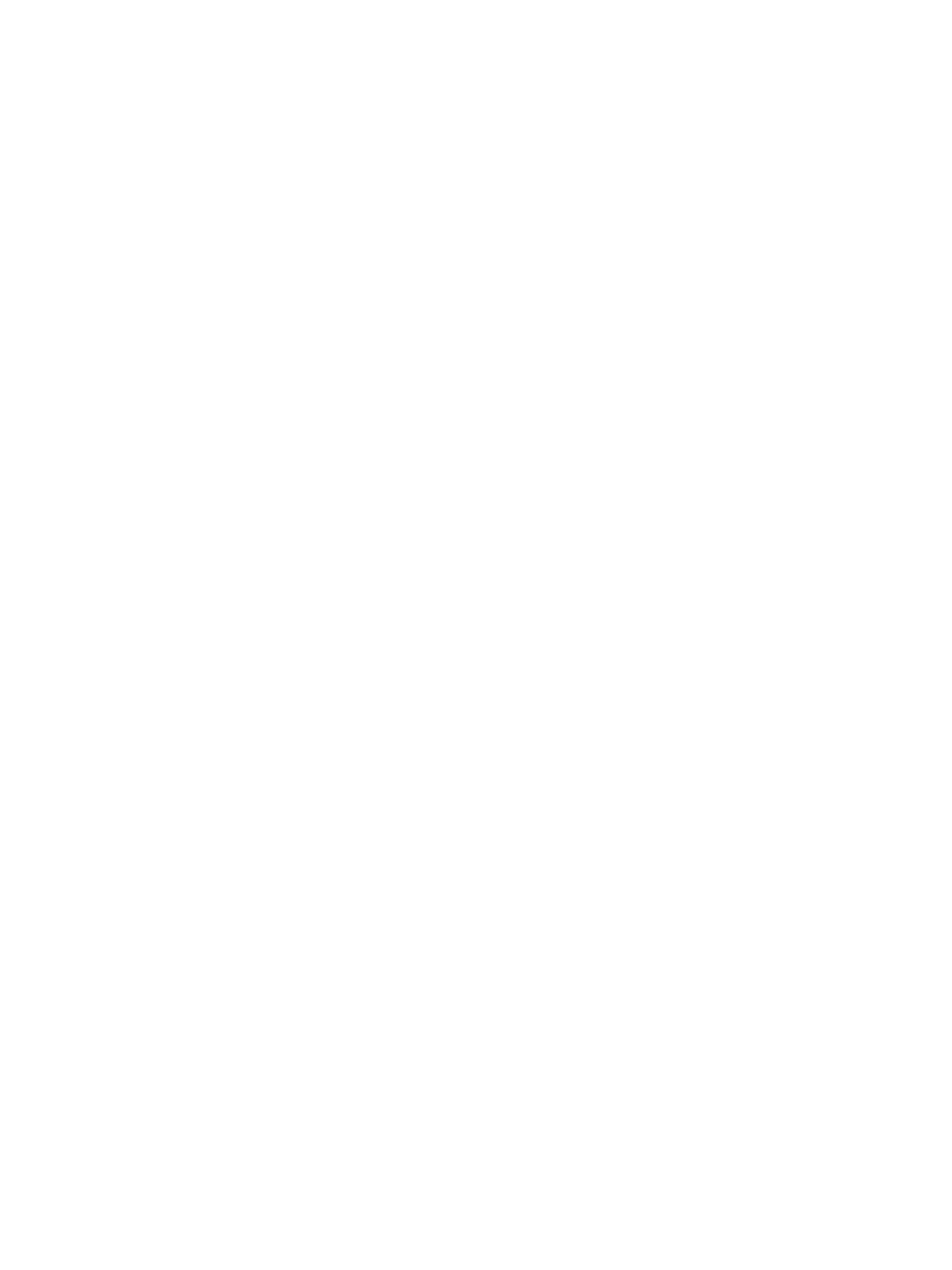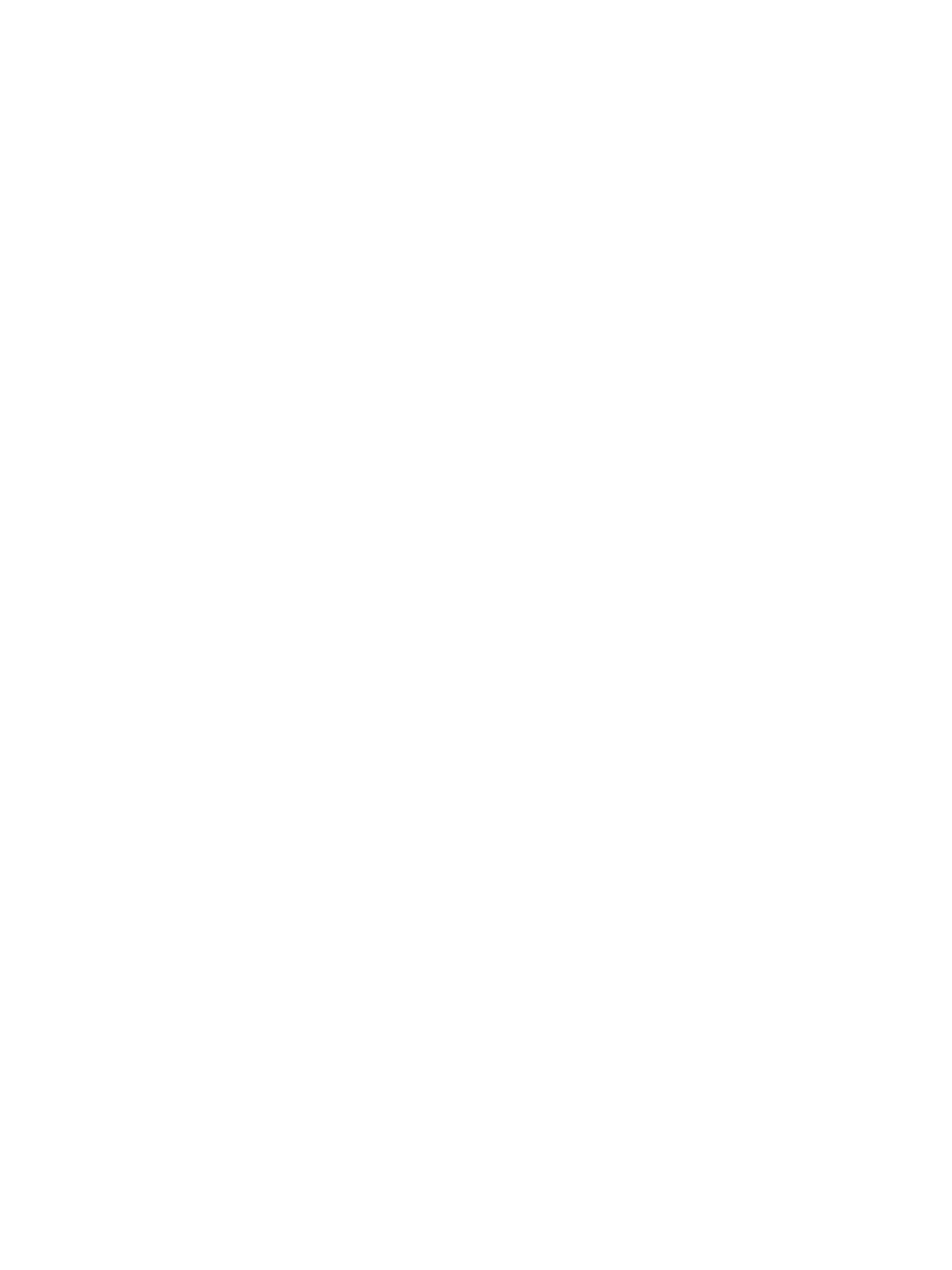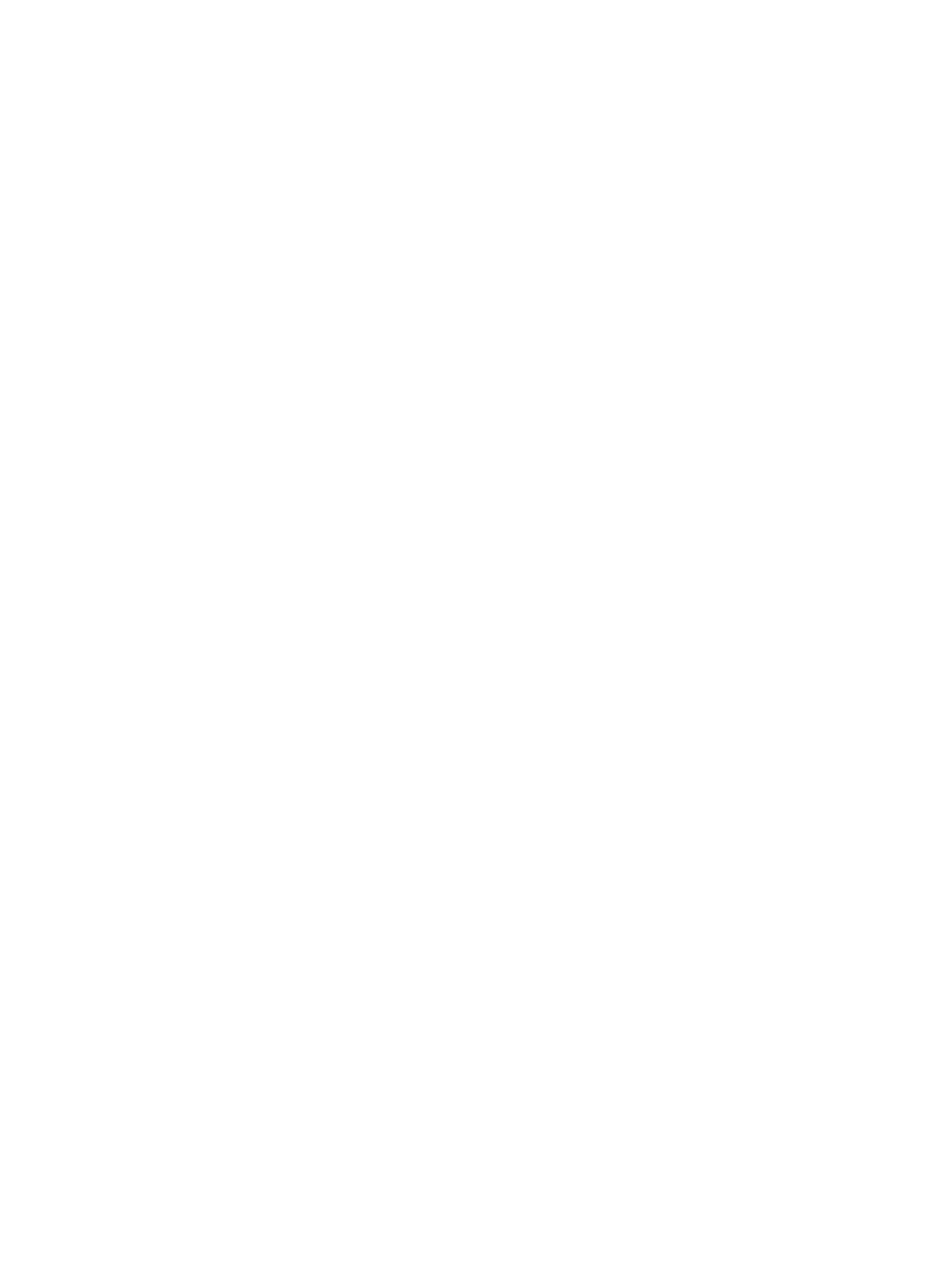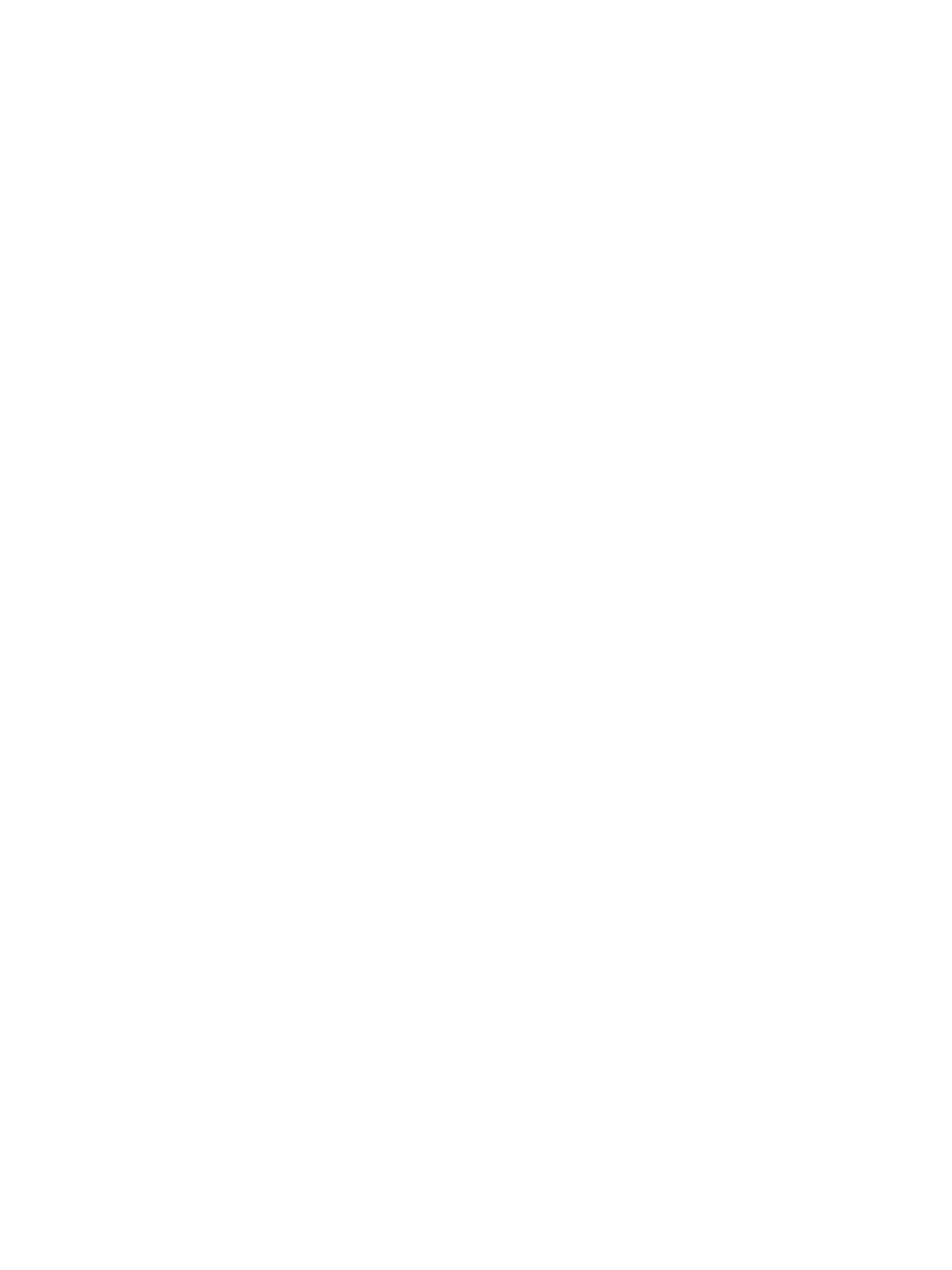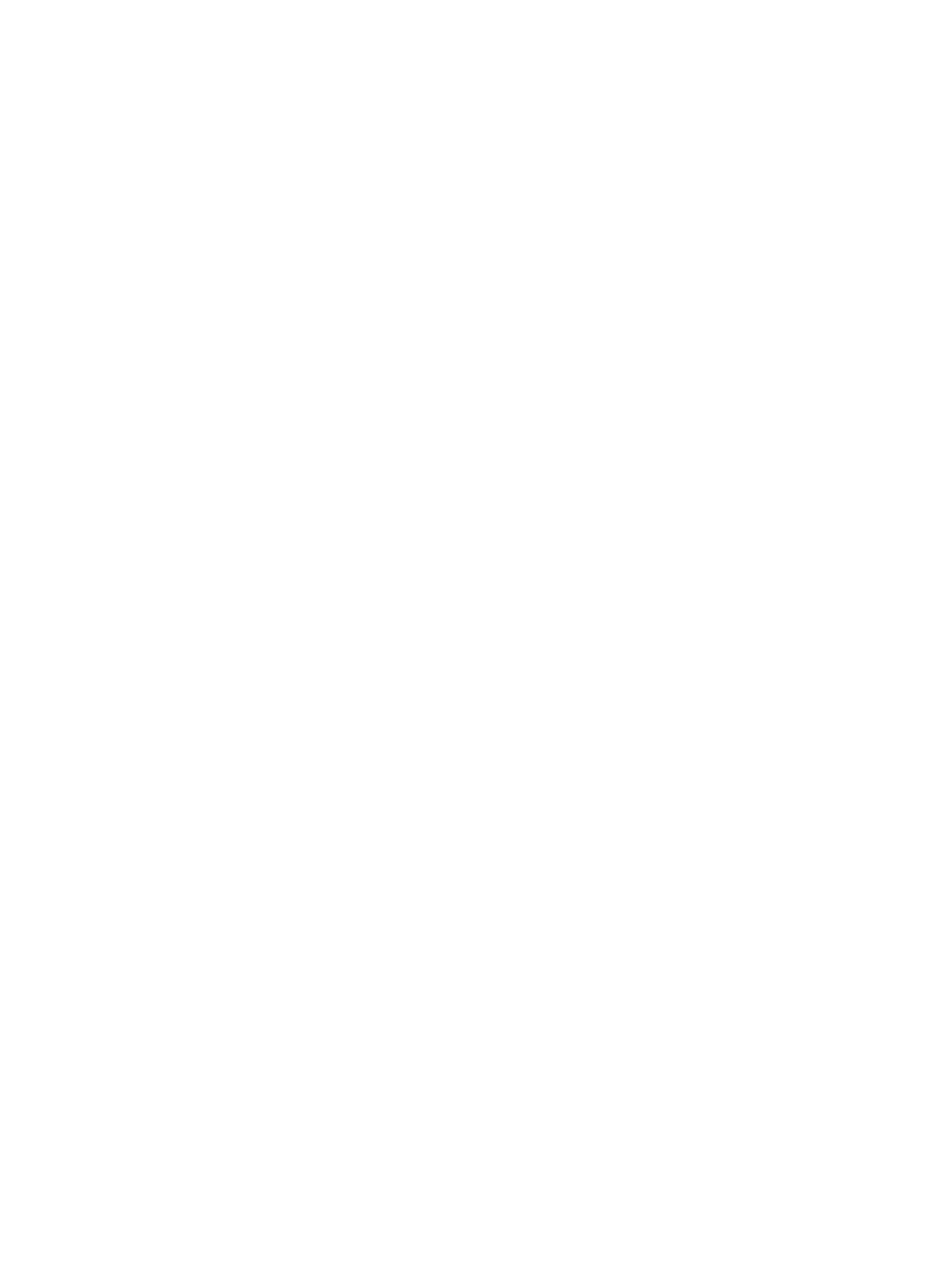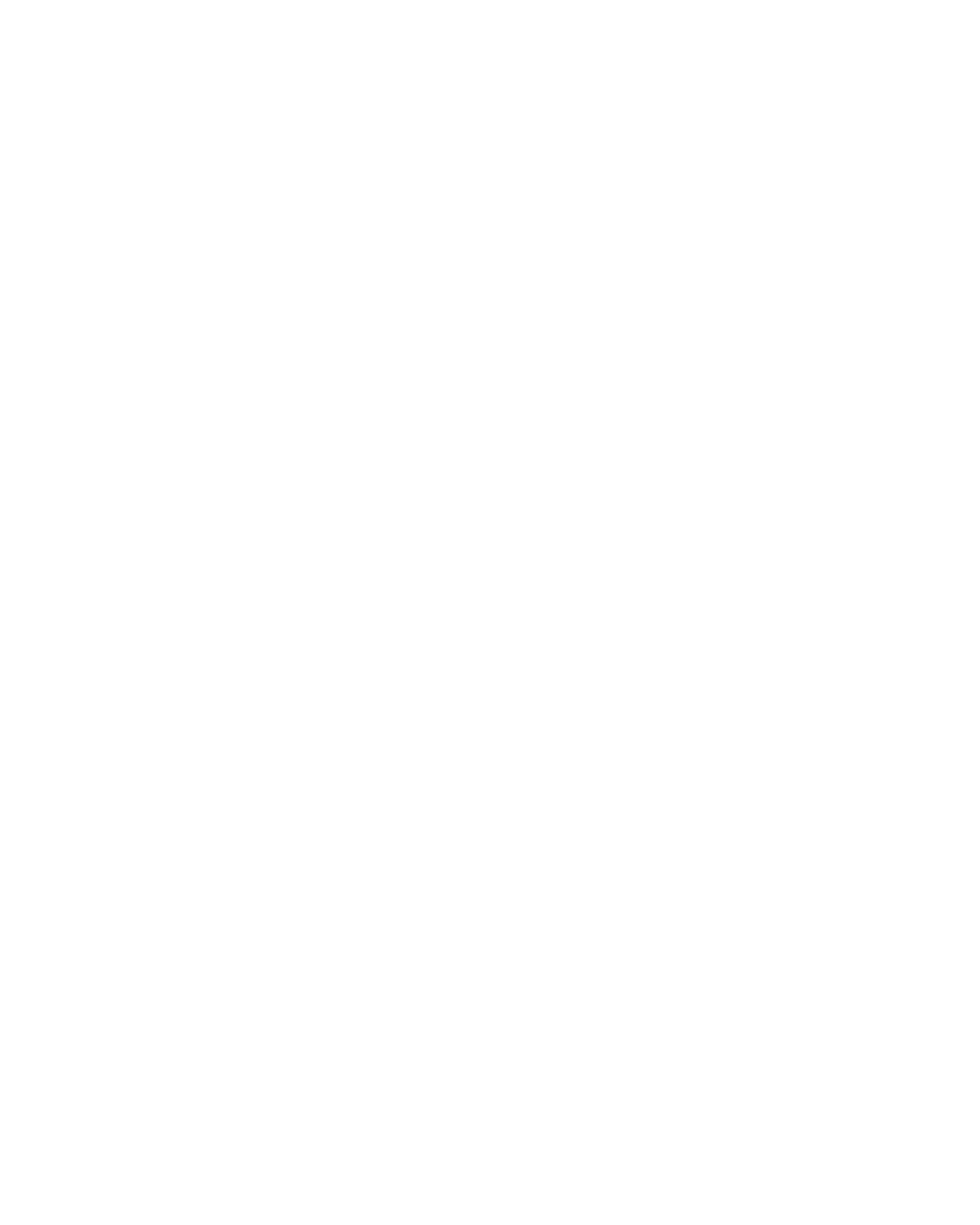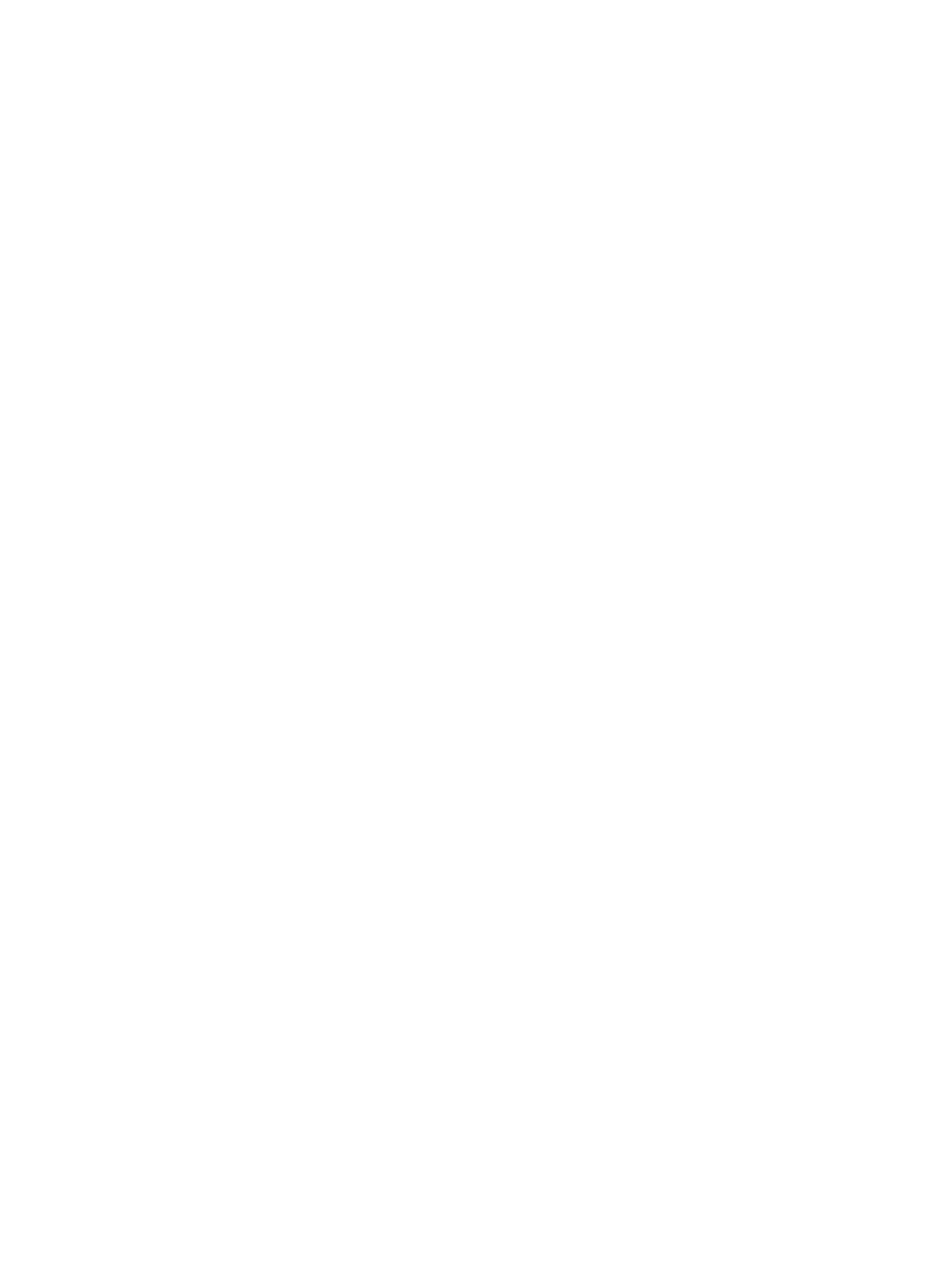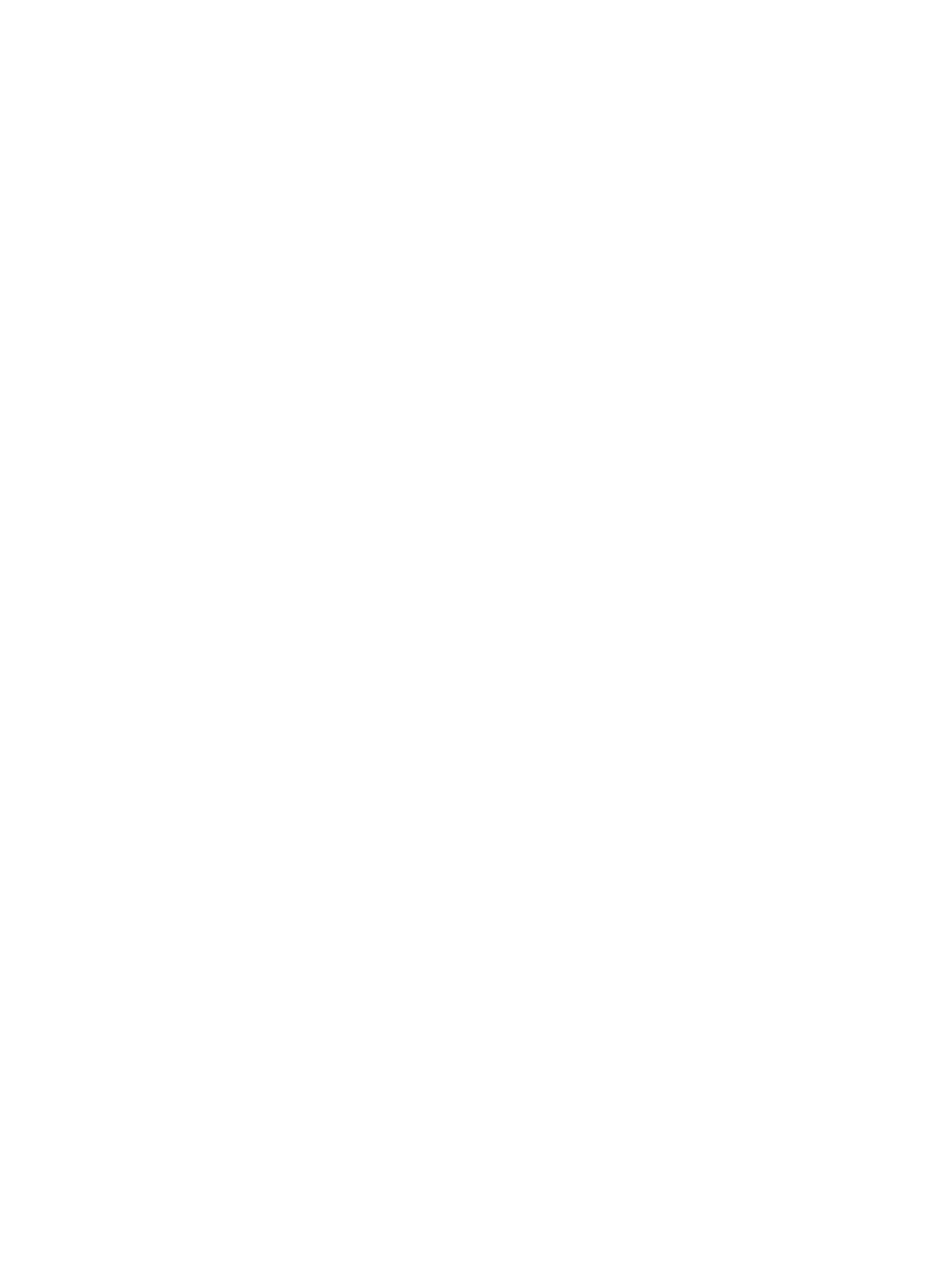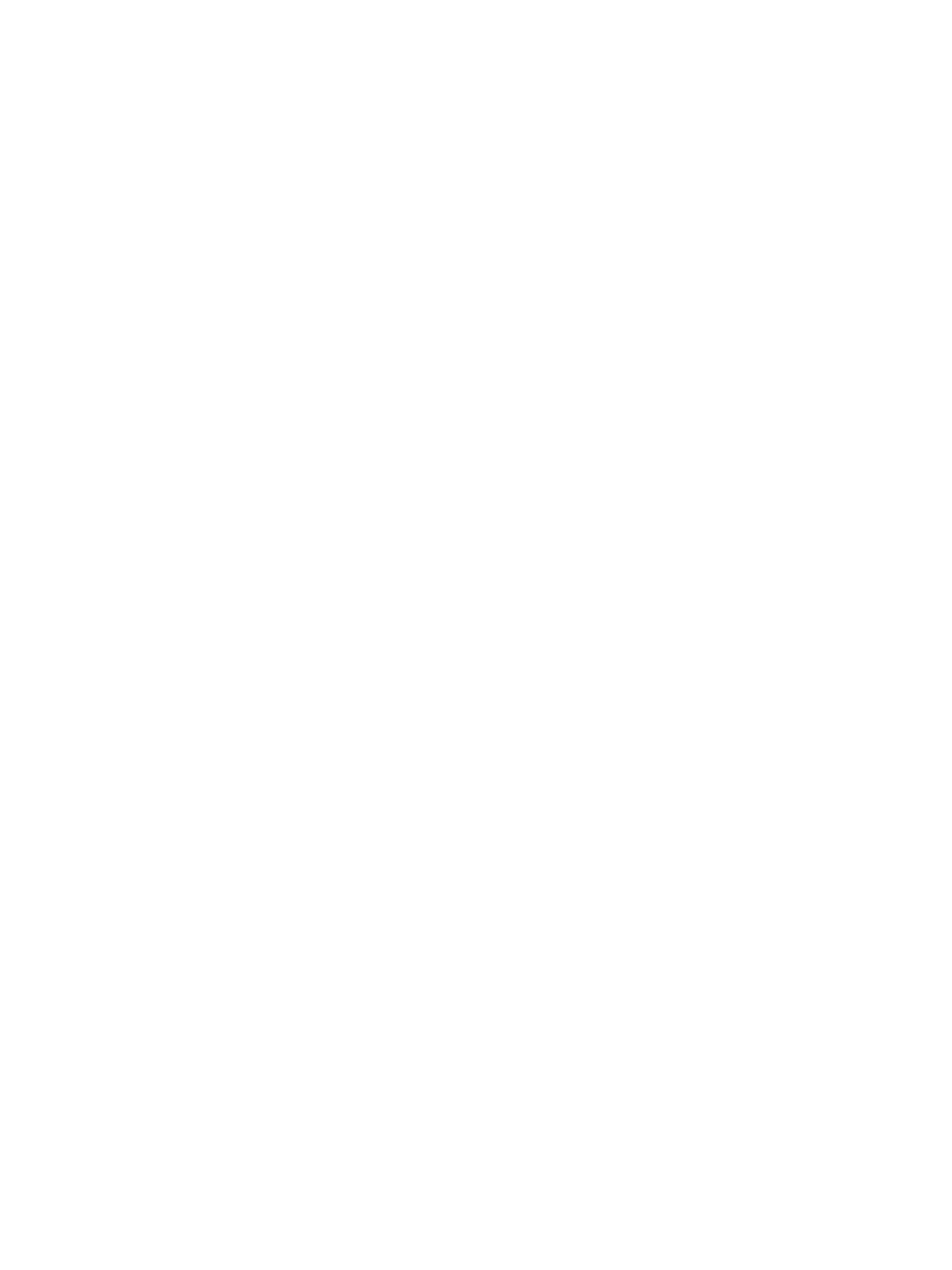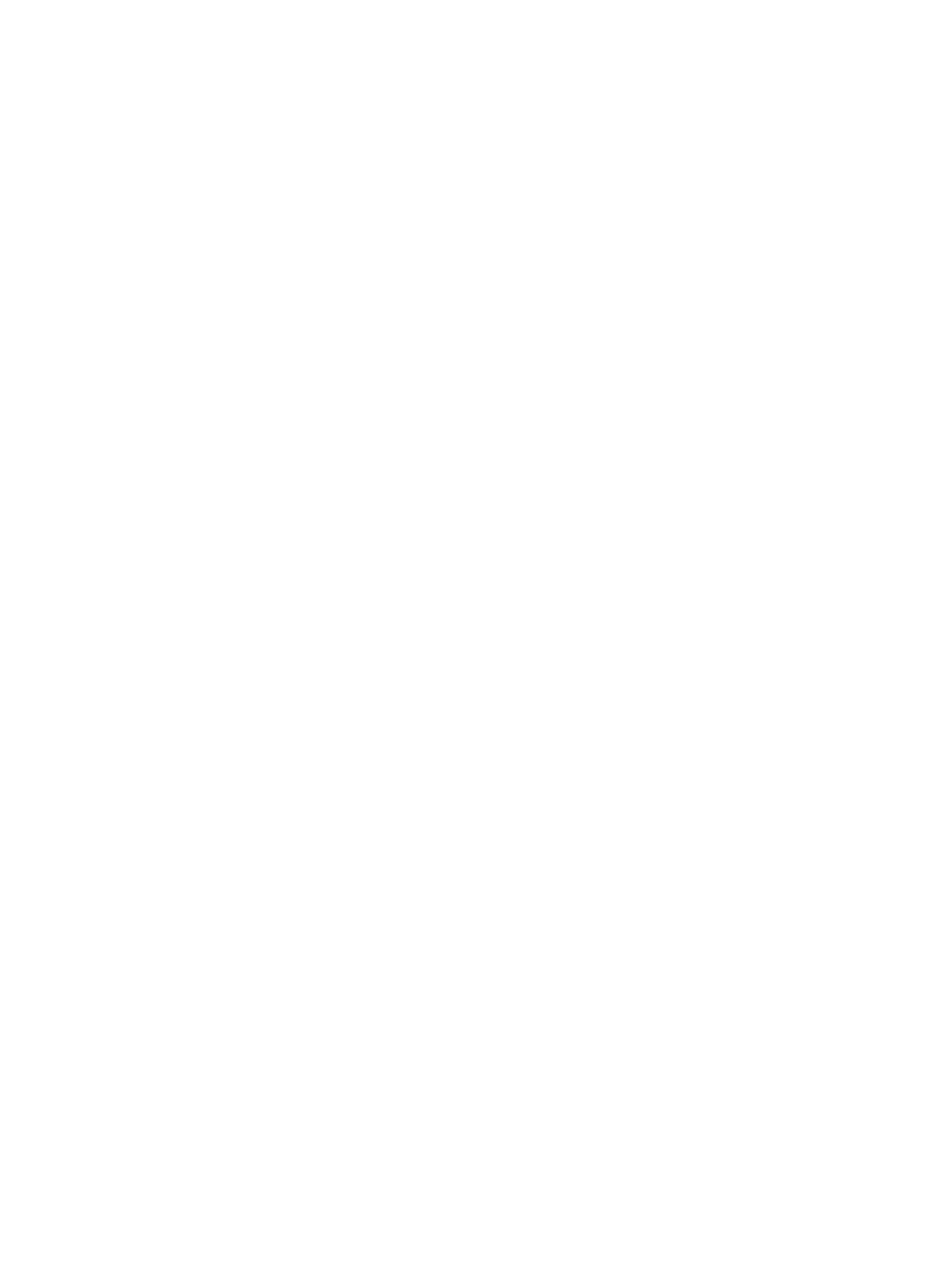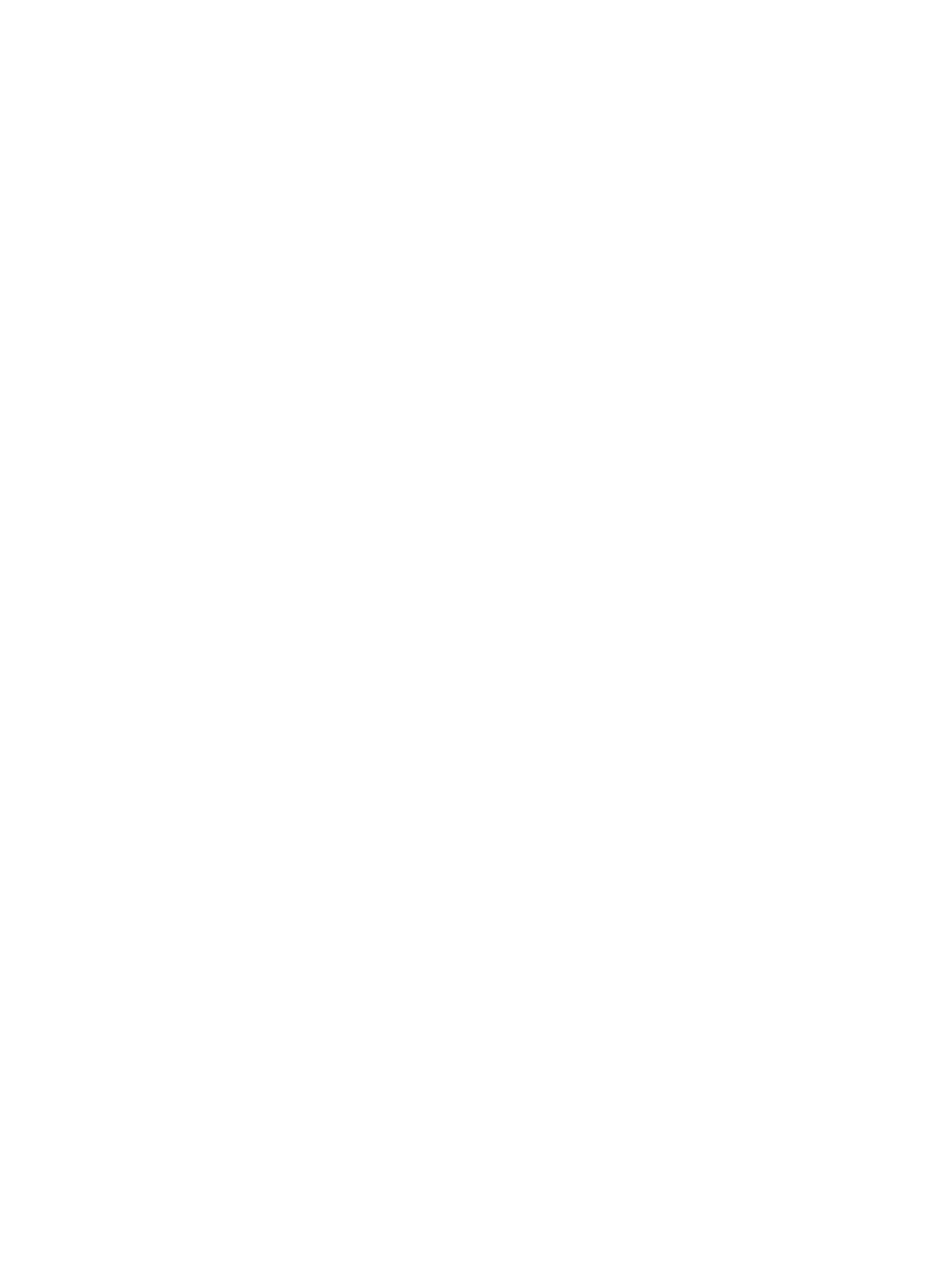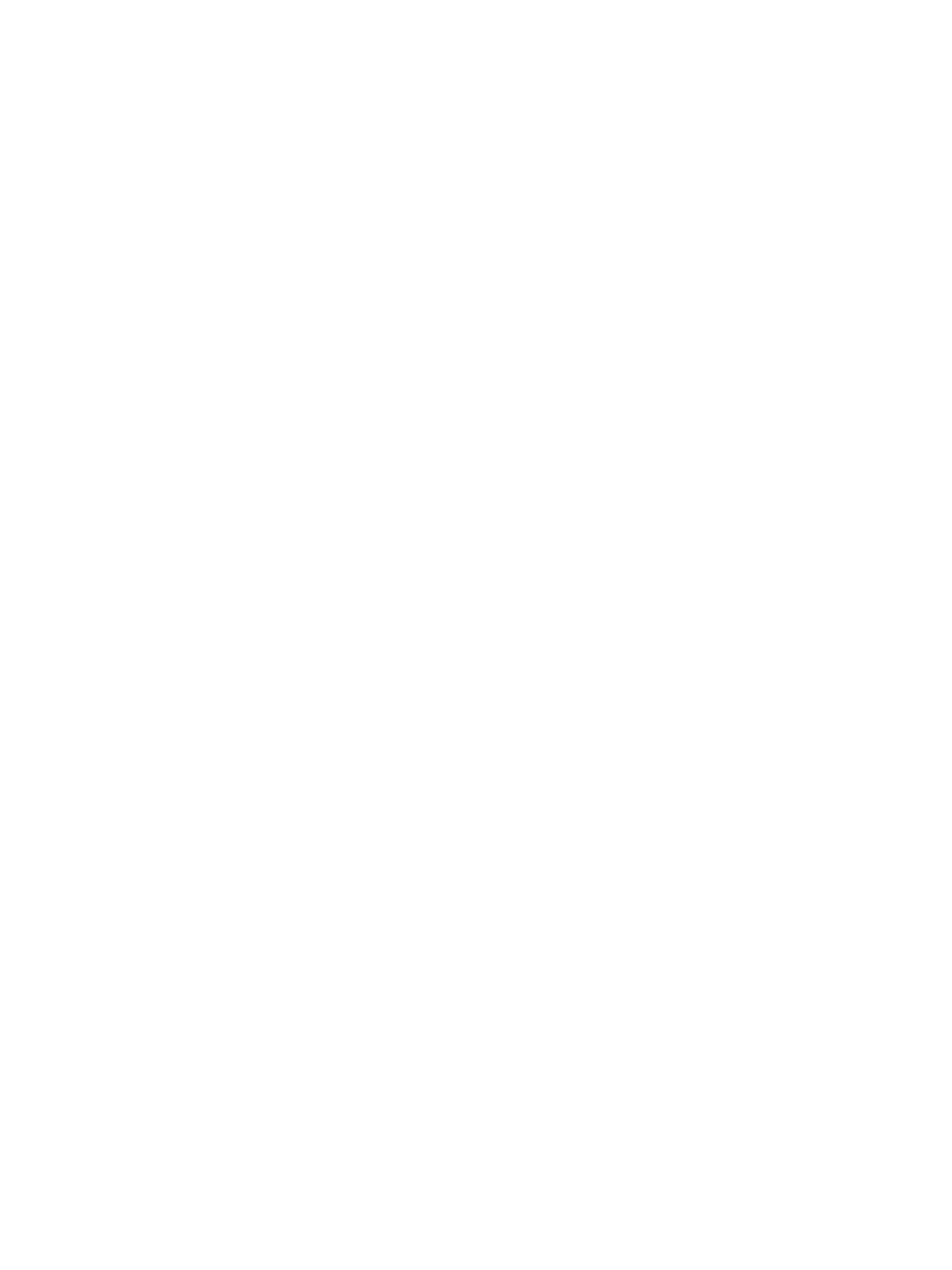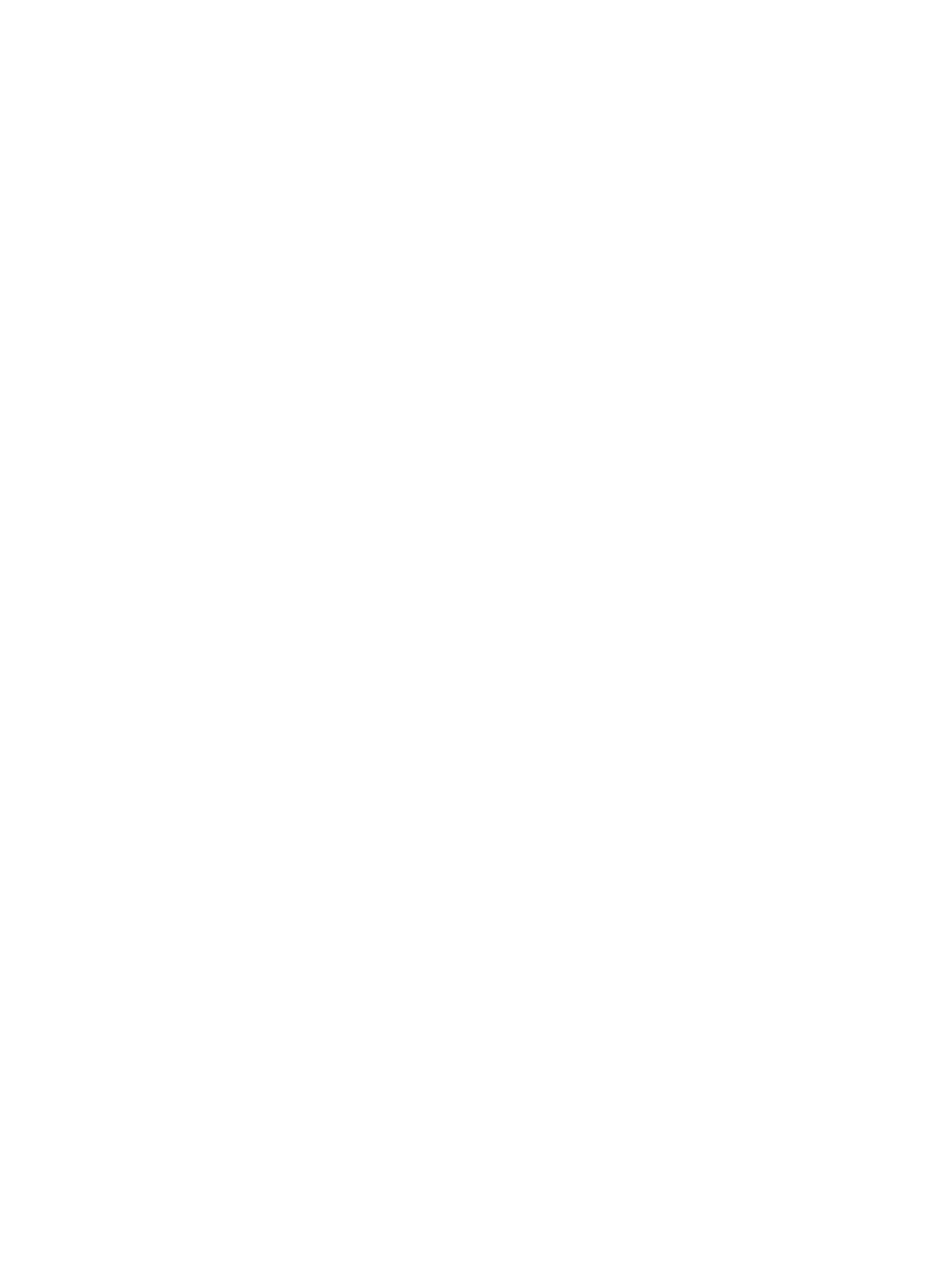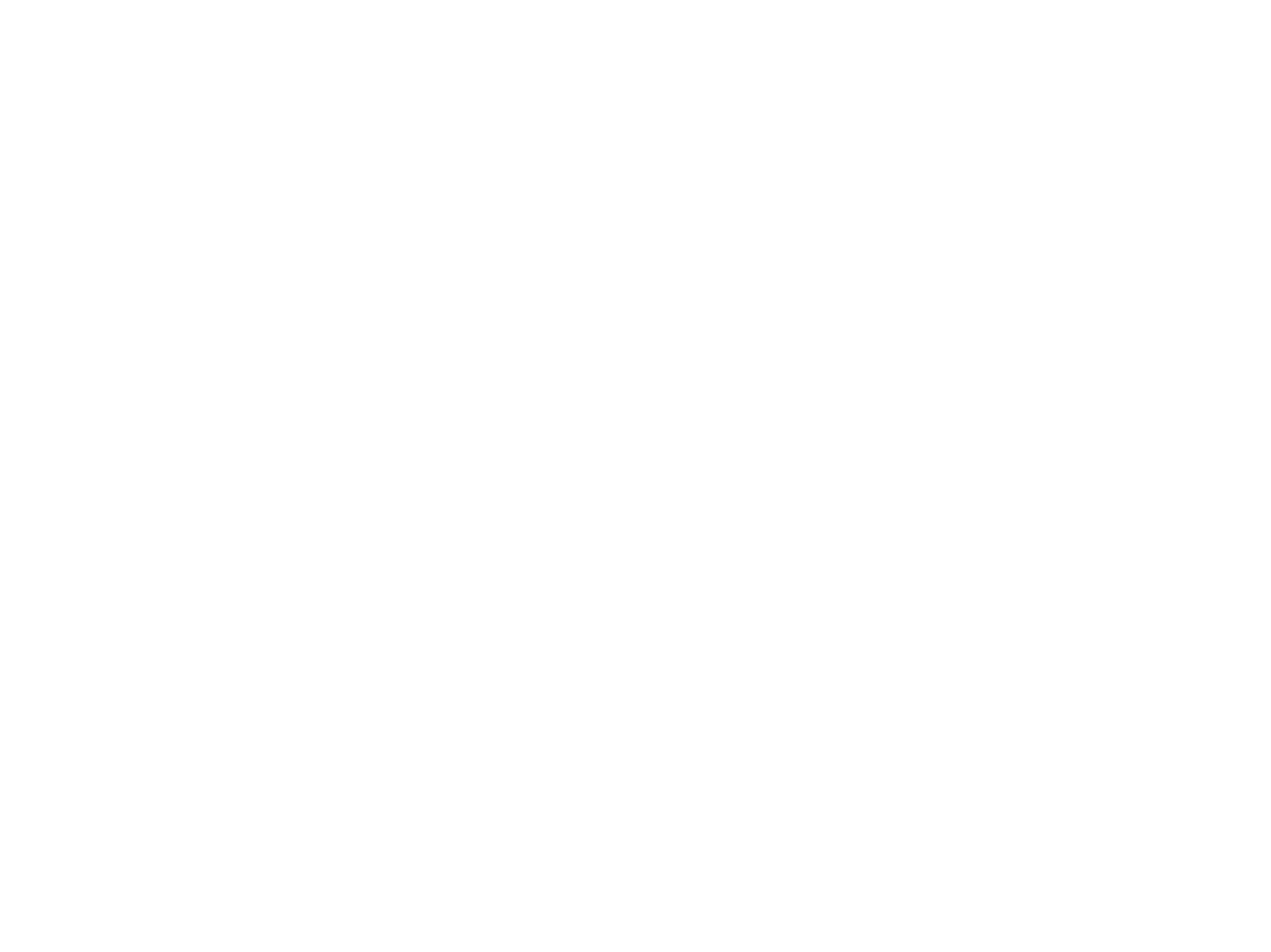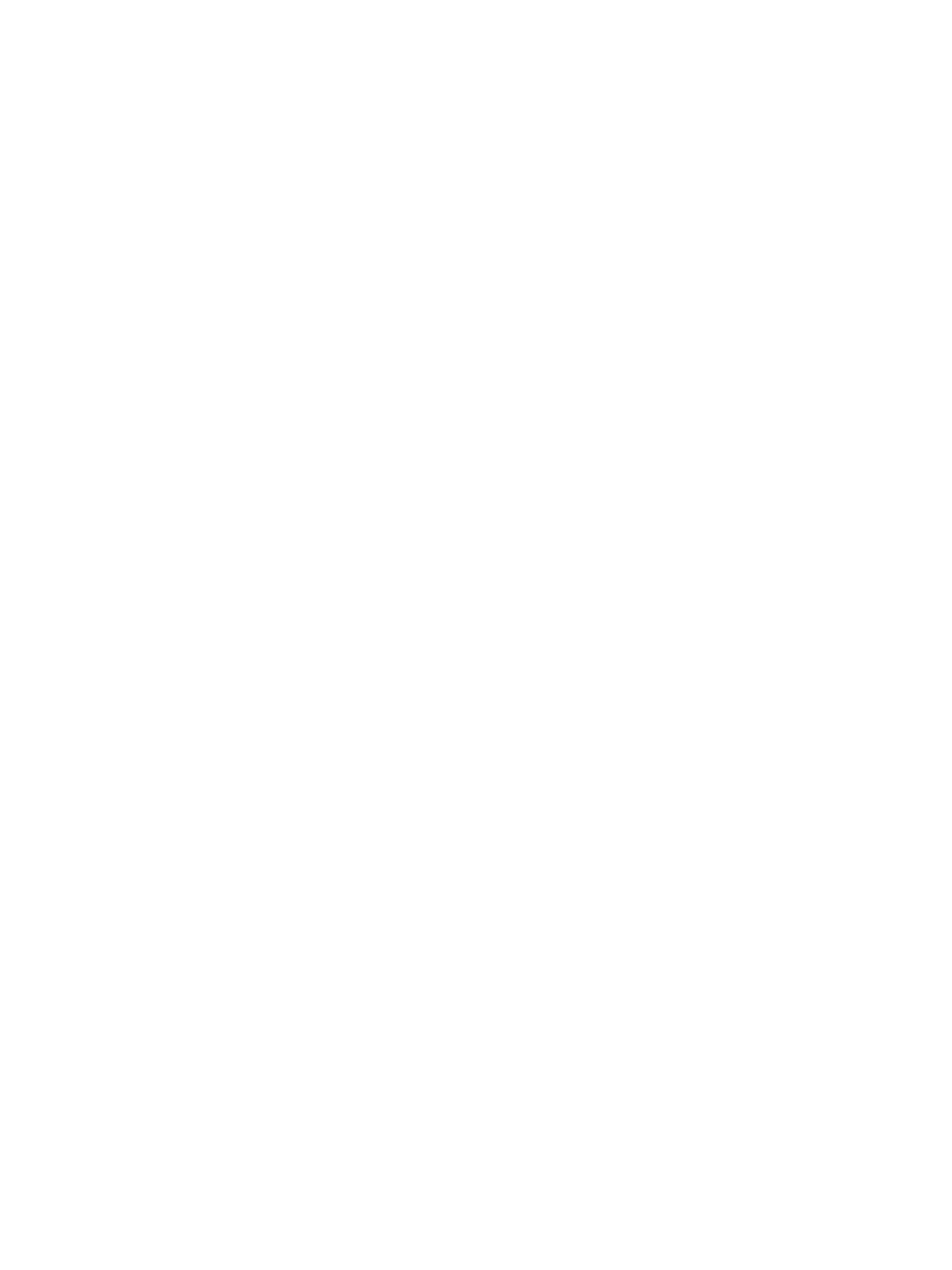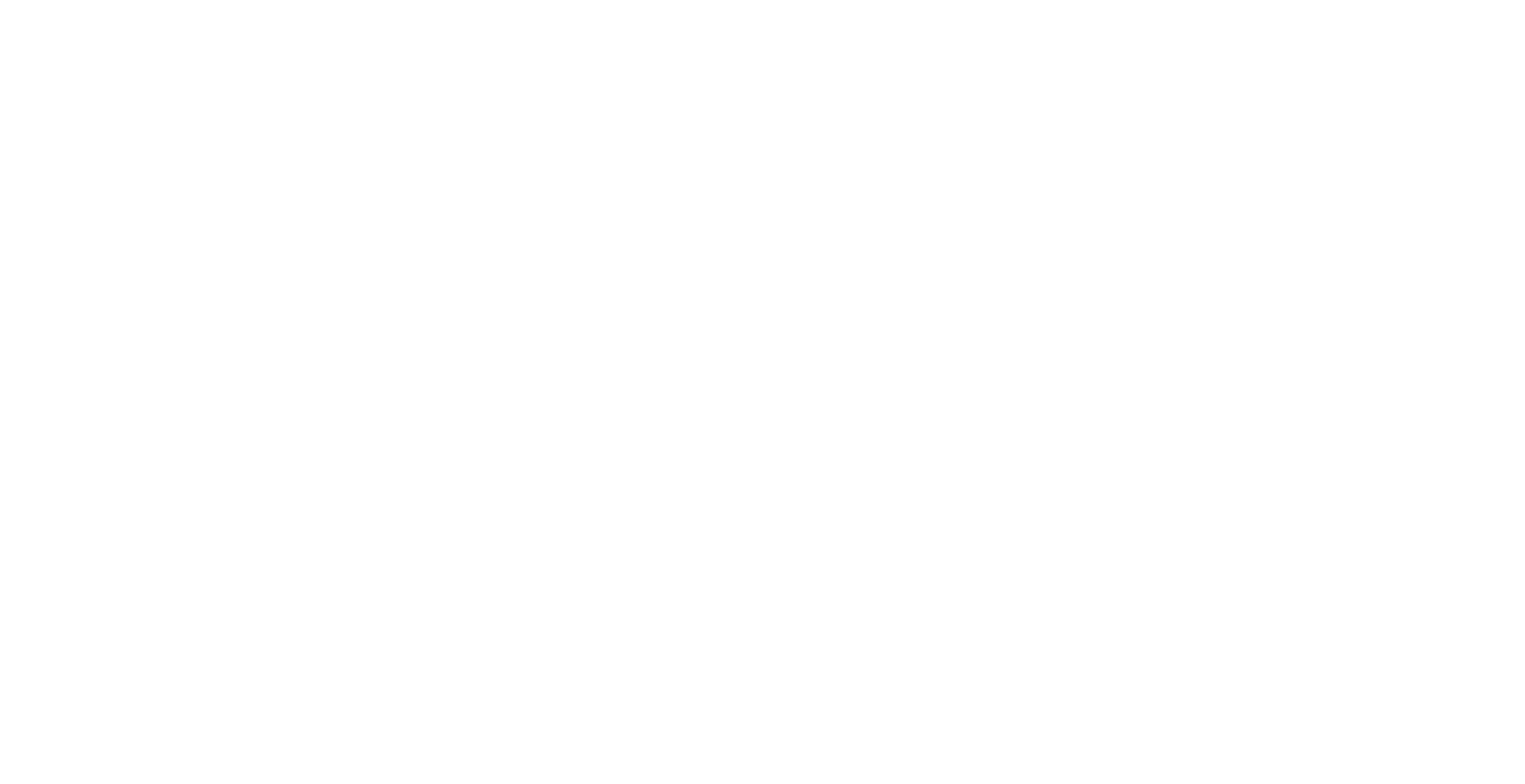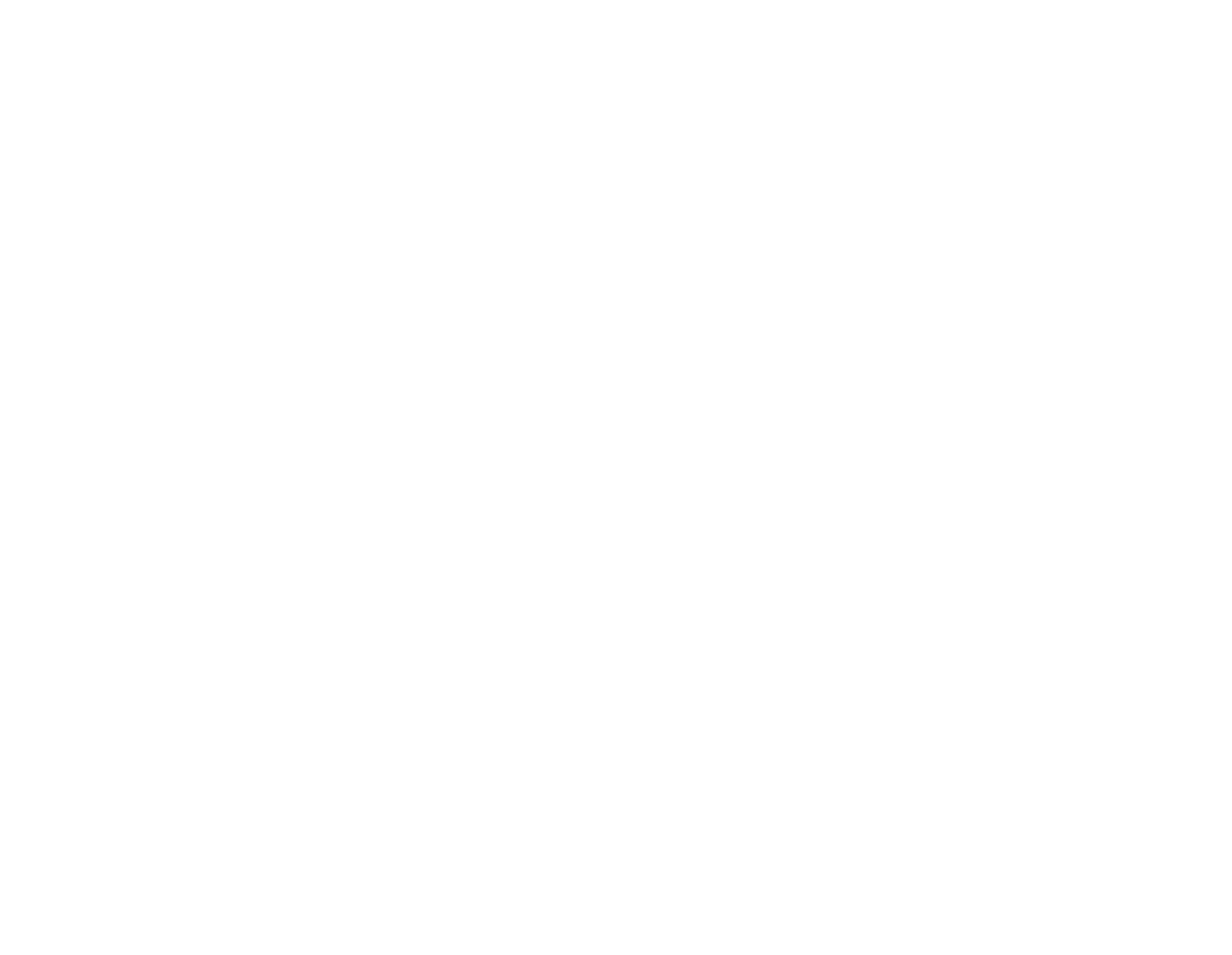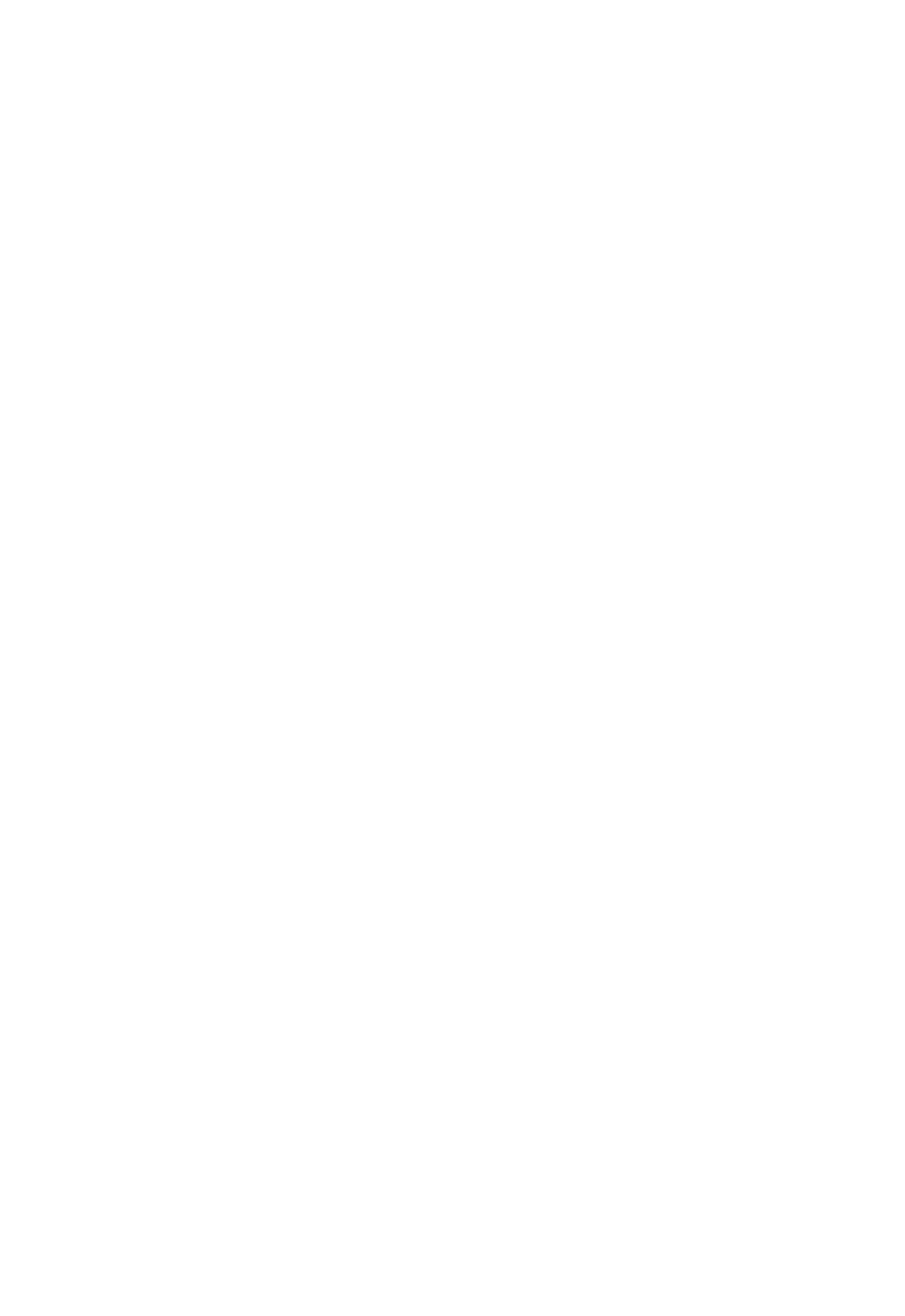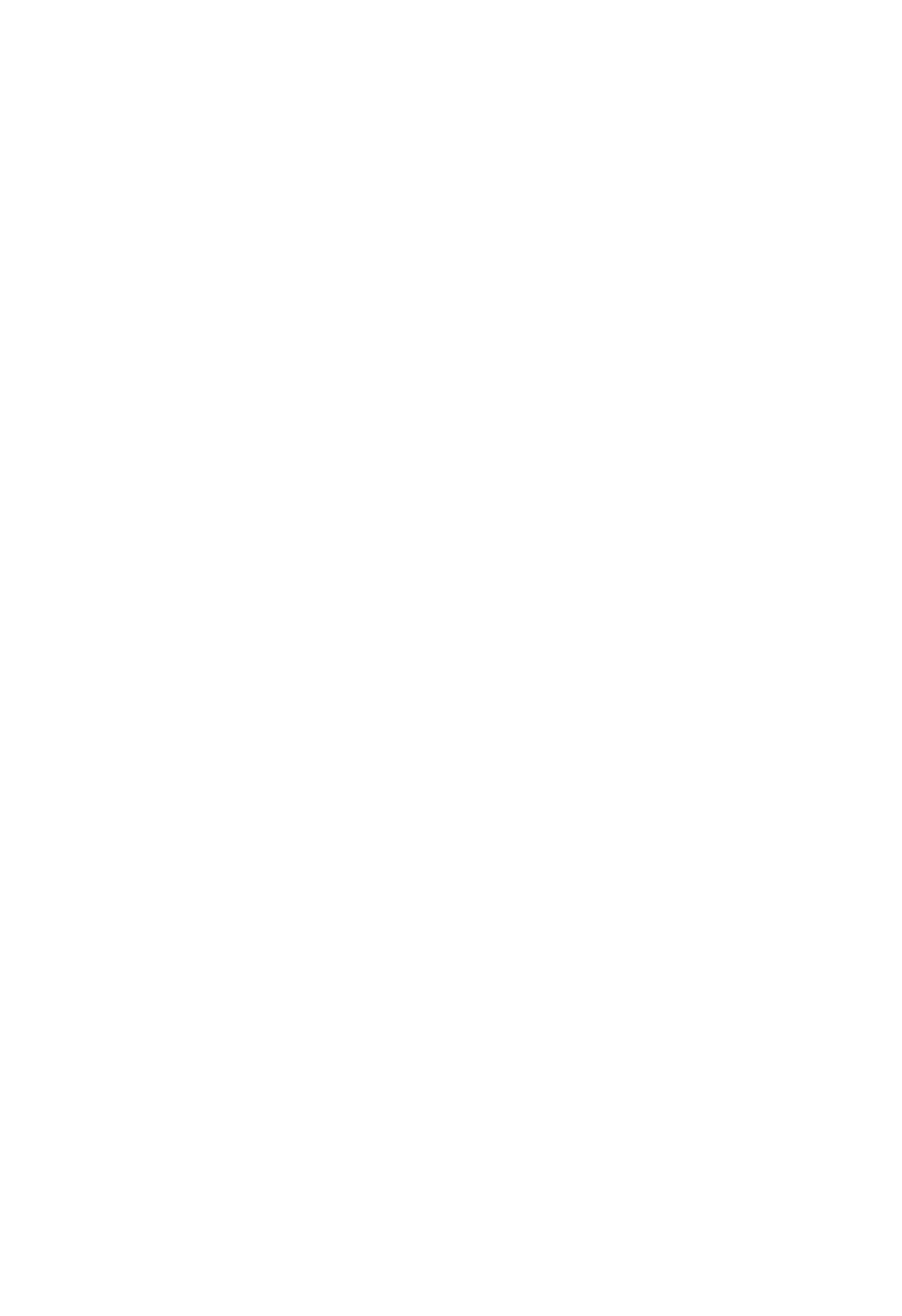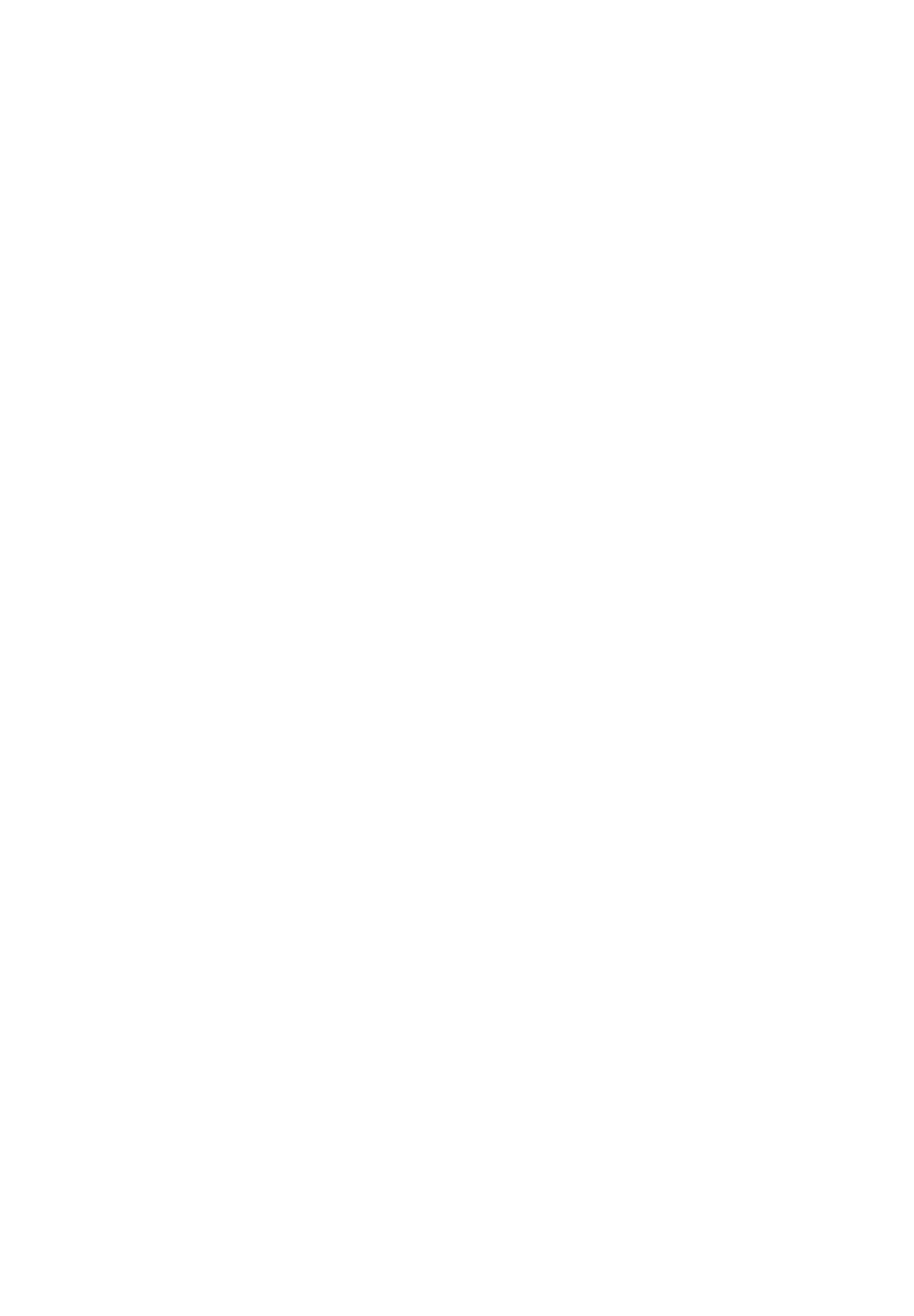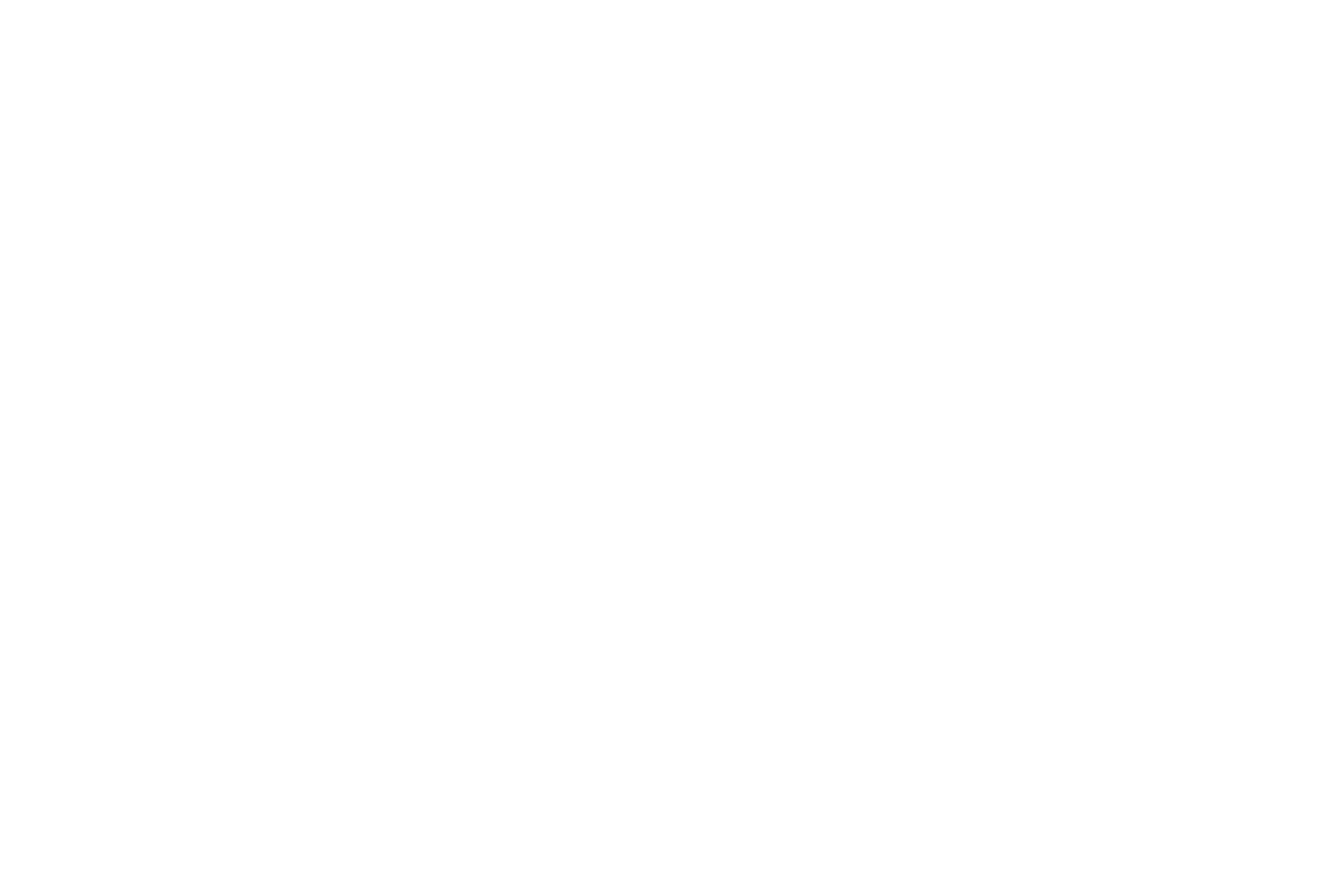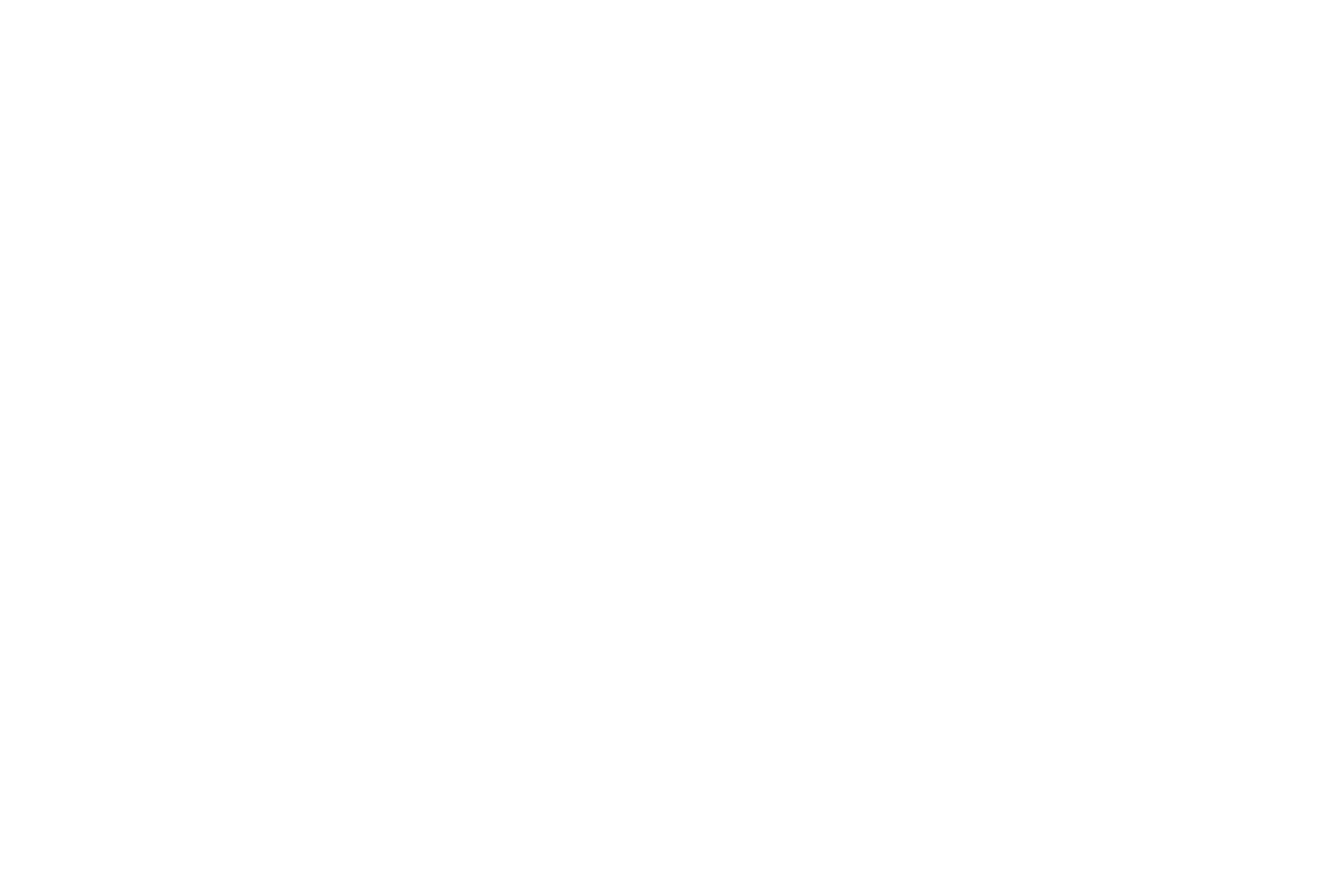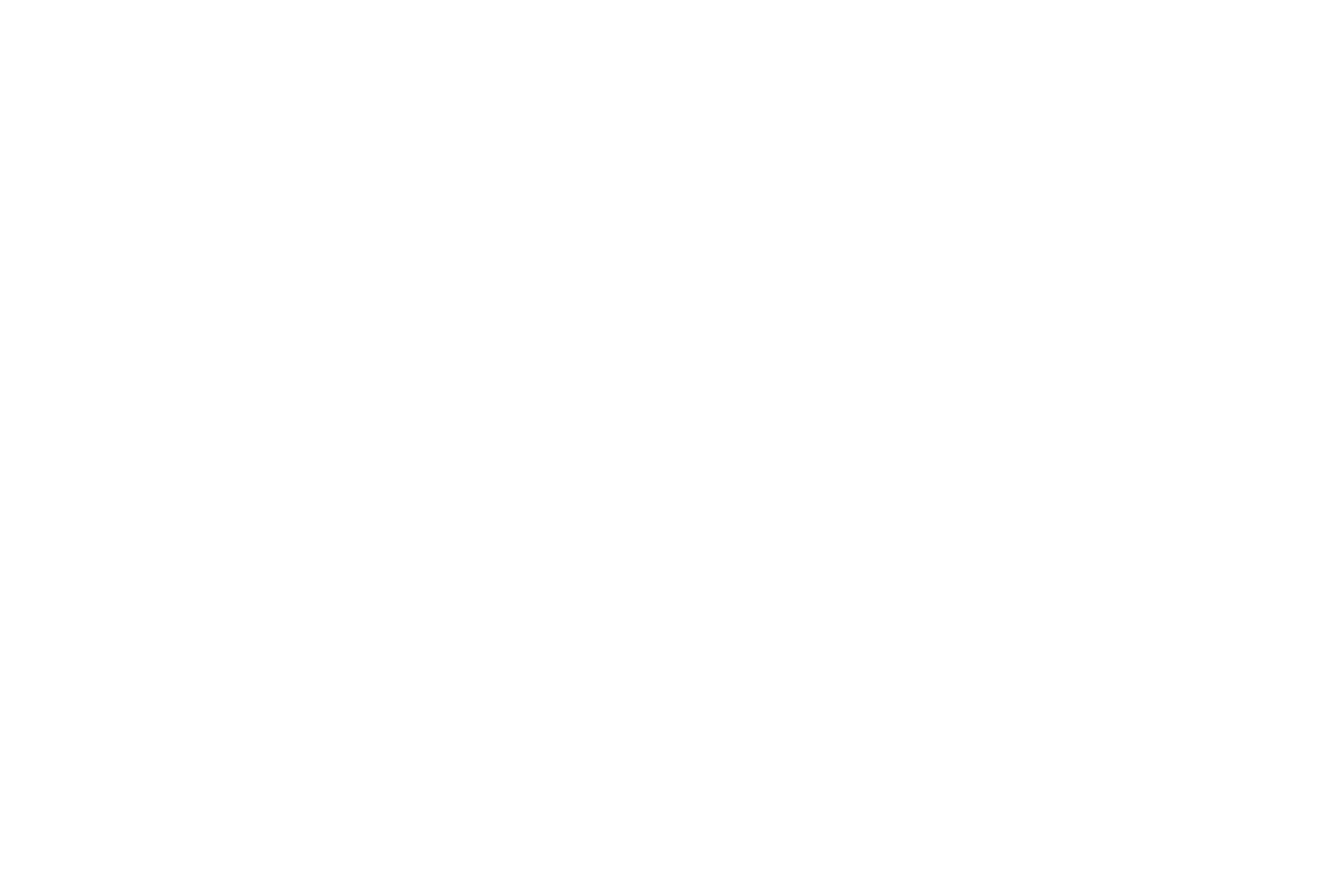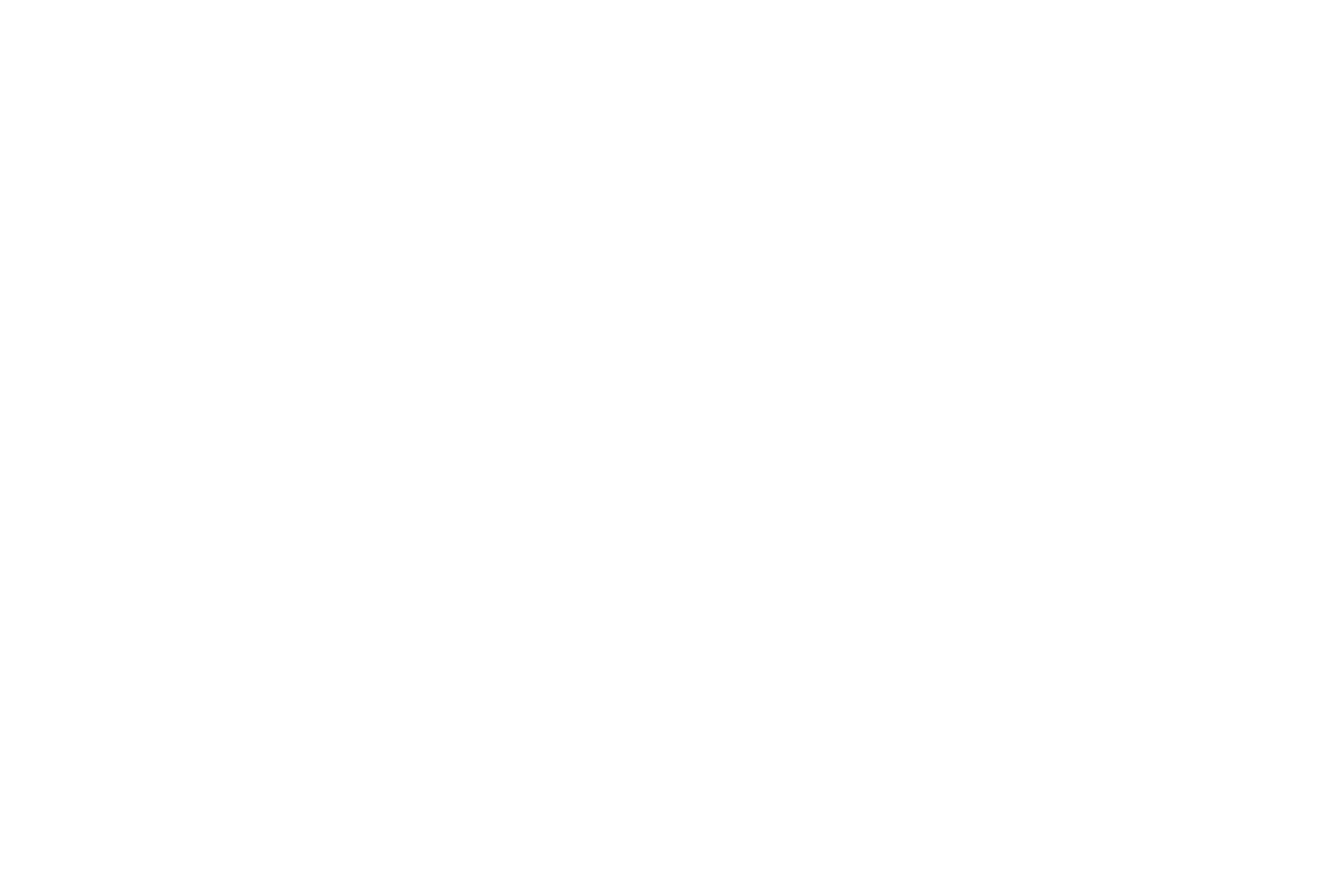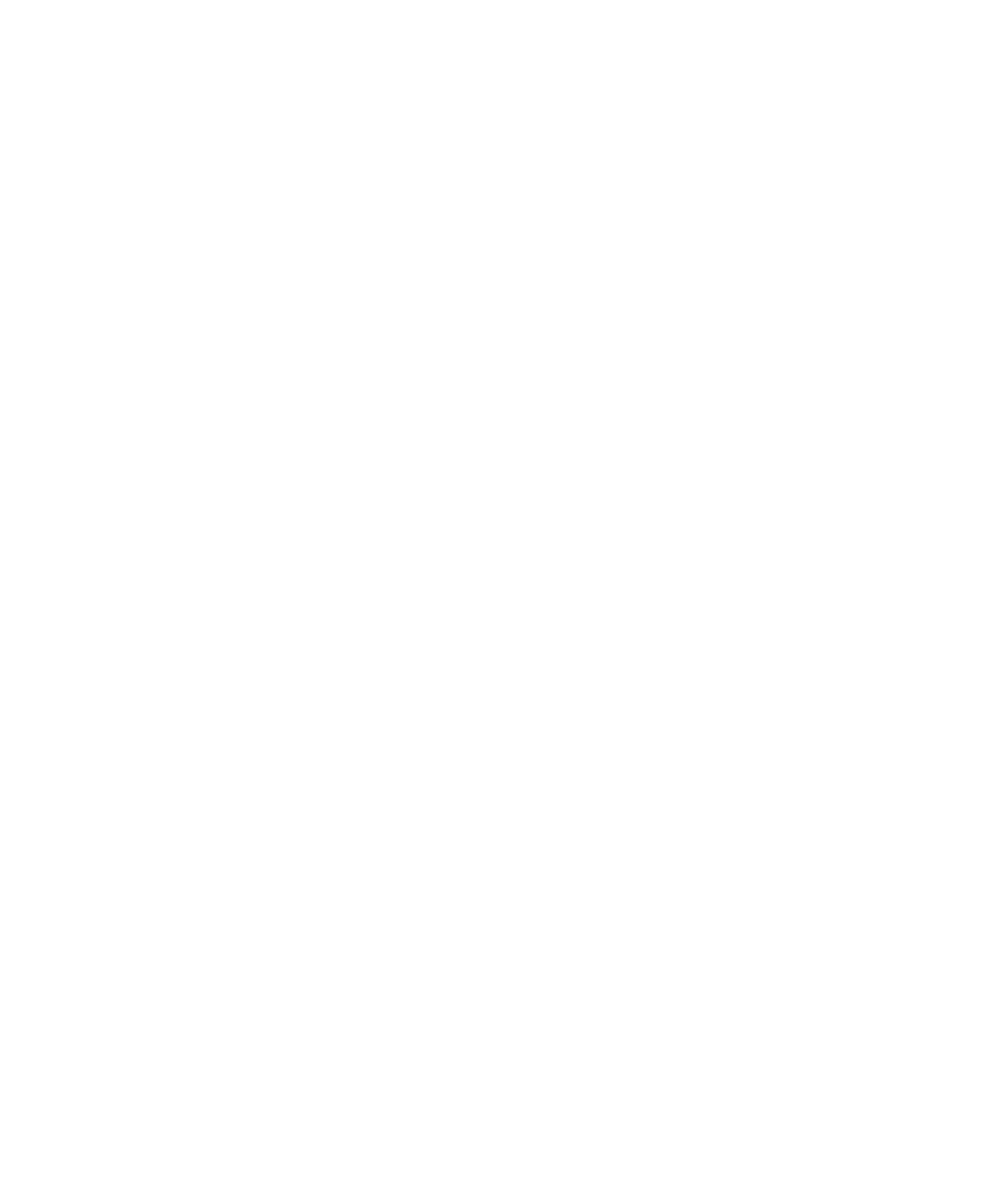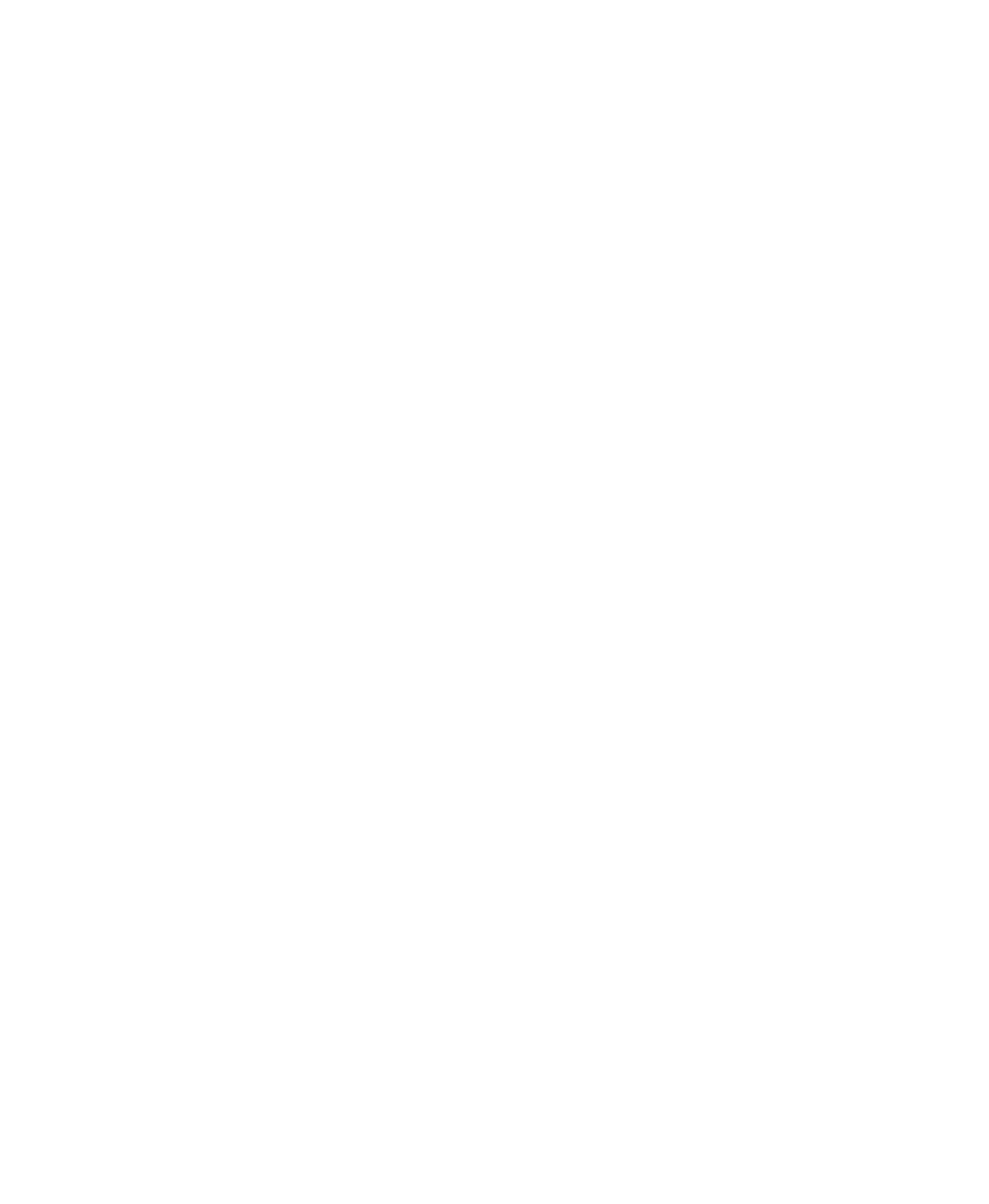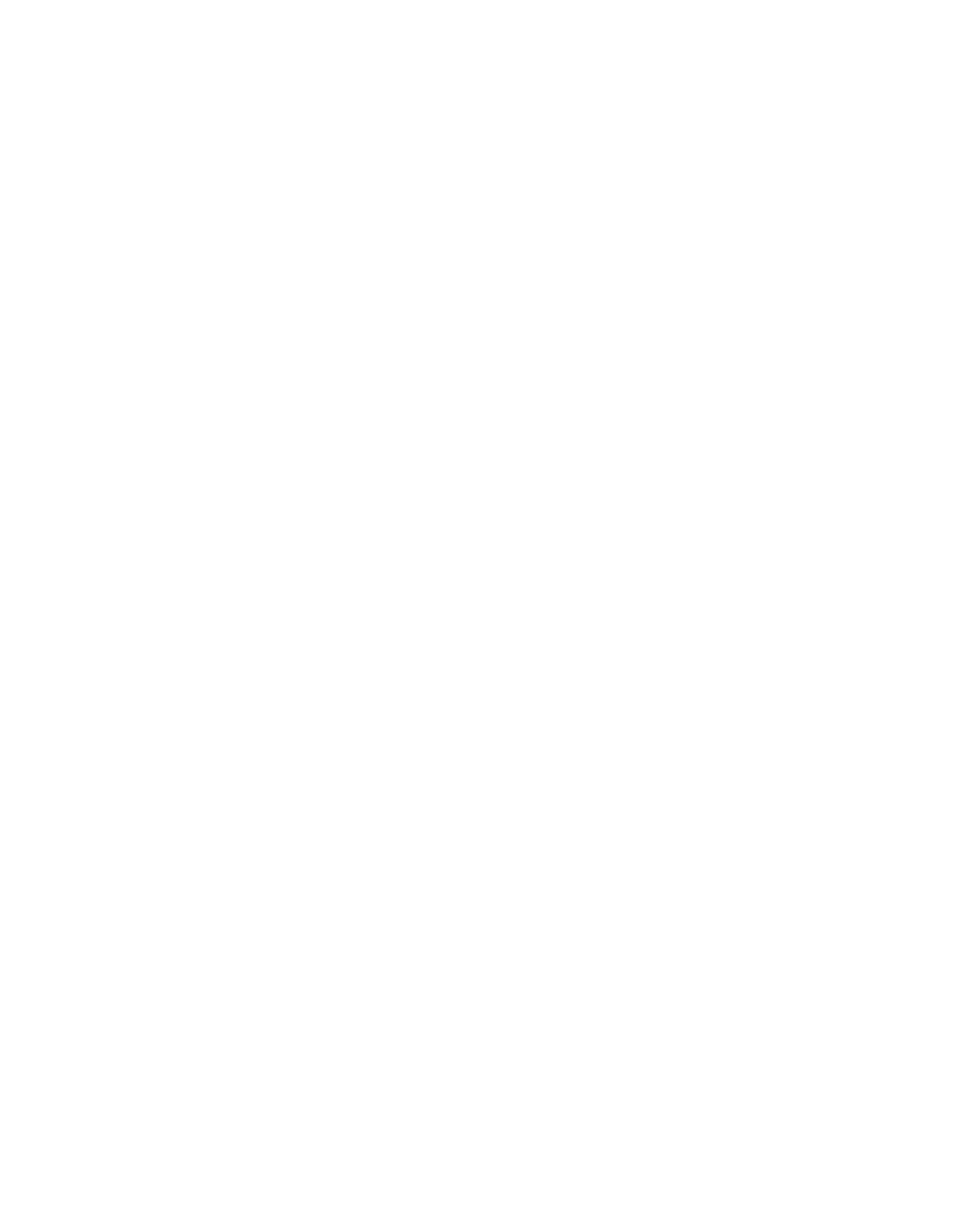Le jardin – un symbole riche et complexe – exprime une large gamme de significations. Les jardins peuvent être des phares d’espoir, des lieux où la vie peut s’épanouir même dans les moments les plus sombres.
Ils incarnent l’ordre opposé au chaos du monde extérieur. Le jardin est un espace où même une seule personne peut dompter et organiser la nature sauvage.
Mais pour moi, le jardin n’est pas un symbole de domination. Dans mon pays, on y cultive des fruits et des fleurs – une alliance de l’utile et du beau.
Le jardin est un lieu où le désir de créer et de faire grandir quelque chose de nouveau prend une forme absolue.
Mon désir de créer en tant qu’artiste fait écho à celui des jardiniers.
Pour moi, le jardin est un refuge sûr, un abri naturel contre tout ce qui est effrayant dans le monde – un endroit où l’on peut sentir solidement le sol sous ses pieds, ressentir qu’on peut contrôler certaines choses sans les dominer.
Dans mon jardin, poussent toutes sortes de choses, et cela n’est possible que grâce au respect et à la douceur envers la nature, et non à sa soumission.
Quand la destruction se répand autour de moi, j’ai instinctivement envie de créer un espace sûr. De protéger tout ce qui m’est cher.
Le jardin, en tant que symbole de ce lieu sûr, apparaît dans mon art depuis longtemps.
En 2023, j’ai créé le projet «Le Jardinier», dédié avant tout à la personne habitant le jardin. Cette fois, le héros principal est le jardin lui-même et tout ce qu’il contient.
Ils incarnent l’ordre opposé au chaos du monde extérieur. Le jardin est un espace où même une seule personne peut dompter et organiser la nature sauvage.
Mais pour moi, le jardin n’est pas un symbole de domination. Dans mon pays, on y cultive des fruits et des fleurs – une alliance de l’utile et du beau.
Le jardin est un lieu où le désir de créer et de faire grandir quelque chose de nouveau prend une forme absolue.
Mon désir de créer en tant qu’artiste fait écho à celui des jardiniers.
Pour moi, le jardin est un refuge sûr, un abri naturel contre tout ce qui est effrayant dans le monde – un endroit où l’on peut sentir solidement le sol sous ses pieds, ressentir qu’on peut contrôler certaines choses sans les dominer.
Dans mon jardin, poussent toutes sortes de choses, et cela n’est possible que grâce au respect et à la douceur envers la nature, et non à sa soumission.
Quand la destruction se répand autour de moi, j’ai instinctivement envie de créer un espace sûr. De protéger tout ce qui m’est cher.
Le jardin, en tant que symbole de ce lieu sûr, apparaît dans mon art depuis longtemps.
En 2023, j’ai créé le projet «Le Jardinier», dédié avant tout à la personne habitant le jardin. Cette fois, le héros principal est le jardin lui-même et tout ce qu’il contient.
Le protagoniste principal de ce projet, c’est mon cœur — et tout ce que j’y ai mis. Il est ici représenté comme un contenant symbolique, une sorte de coffret pour tout ce qui est heureux, effrayant, drôle, douloureux, sensible, vécu, vu par Alice. Ce cœur contient déjà beaucoup, mais il reste toujours de la place pour encore plus.
«Le cœur d’Alice est une matrice artistique
où naissent les embryons d’œuvres,
où les images grandissent, deviennent adultes,
…
Une créature en apparence petite,
mais qui peut contenir un champ,
une forêt, une rivière, une montagne.
Et un humain, n’en parlons même pas.»
— Ievguenia Nekrasova, Texte sur le cœur
Le titre fait écho à la chanson Heart-Shaped Box de Nirvana. L’œuvre de Kurt Cobain m’inspire profondément : il semble retourner son être à l’envers pour en révéler l’intérieur. Je m’inscris dans une démarche similaire. Mon art est basé sur l’auto-artification : une fusion intime entre moi et mes créations. Chaque pièce du projet est un autoportrait métaphorique, une relique d’archives émotionnelles personnelles. Le vécu personnel prend racine dans le mythe, par lequel je dialogue avec le monde.
«Le cœur d’Alice est une matrice artistique
où naissent les embryons d’œuvres,
où les images grandissent, deviennent adultes,
…
Une créature en apparence petite,
mais qui peut contenir un champ,
une forêt, une rivière, une montagne.
Et un humain, n’en parlons même pas.»
— Ievguenia Nekrasova, Texte sur le cœur
Le titre fait écho à la chanson Heart-Shaped Box de Nirvana. L’œuvre de Kurt Cobain m’inspire profondément : il semble retourner son être à l’envers pour en révéler l’intérieur. Je m’inscris dans une démarche similaire. Mon art est basé sur l’auto-artification : une fusion intime entre moi et mes créations. Chaque pièce du projet est un autoportrait métaphorique, une relique d’archives émotionnelles personnelles. Le vécu personnel prend racine dans le mythe, par lequel je dialogue avec le monde.
Dans ce projet, j’endosse différents rôles. Ici, je suis artiste/jardinière: je cultive mon cœur dans le jardin, je crée une plantation de mes larmes sous serre, et je deviens tour à tour mauvaise herbe, plante cultivée ou arbre déraciné. Chaque photo raconte une histoire de relation avec la nature et avec moi-même — mes émotions, mon ressenti. Je fais littéralement germer mes états intérieurs, je leur donne une forme végétale, et parfois je deviens moi-même partie du monde végétal.
La relation avec le lieu où je vis est essentielle dans ma pratique artistique. Toutes les images ont été prises dans l’Oural, dans le jardin de la grand-mère de mon mari, un endroit où je passe beaucoup de temps. Chaque brin d’herbe ici me connaît. J’y travaille, je m’y repose, je mange des légumes et des baies fraîches, j’aide à faire pousser les fleurs. Chaque fois que je tombe amoureuse d’un lieu, j’ai envie de le fixer par l’art. À travers mes œuvres, je dialogue avec le monde — non seulement avec les humains, mais aussi avec les lieux qui m’entourent.
Ce jardin a absorbé beaucoup de mes larmes, de mon rire, de ma peine et de ma joie. C’est un lieu auquel j’ai offert beaucoup de mes sentiments, et auquel j’en offrirai encore.
La relation avec le lieu où je vis est essentielle dans ma pratique artistique. Toutes les images ont été prises dans l’Oural, dans le jardin de la grand-mère de mon mari, un endroit où je passe beaucoup de temps. Chaque brin d’herbe ici me connaît. J’y travaille, je m’y repose, je mange des légumes et des baies fraîches, j’aide à faire pousser les fleurs. Chaque fois que je tombe amoureuse d’un lieu, j’ai envie de le fixer par l’art. À travers mes œuvres, je dialogue avec le monde — non seulement avec les humains, mais aussi avec les lieux qui m’entourent.
Ce jardin a absorbé beaucoup de mes larmes, de mon rire, de ma peine et de ma joie. C’est un lieu auquel j’ai offert beaucoup de mes sentiments, et auquel j’en offrirai encore.
On dit que «les yeux sont le miroir de l’âme», donc les fenêtres sont le miroir de l’âme de la maison. Encadrées de moulures sculptées, elles paraissent mystérieuses et hypnotiques.
Une théorie suggère que l’origine des symboles ornant les encadrements de fenêtres remonte au paganisme. La partie supérieure symbolise le monde céleste, la partie médiane – notre monde, et la partie inférieure – le monde souterrain, inconnu.
Mais le projet «Magique encadrement de fenêtre» n’a pas commencé par l’étude de la symbolique de l’architecture en bois russe, il a commencé par une image brumeuse, un souvenir d’enfance qui a laissé une empreinte indélébile dans ma conscience.
La route principale et presque unique du village, des maisons en bois de chaque côté, à gauche les champs dans le brouillard, à droite le murmure mystérieux de la forêt. Partout l’odeur du bain inondé, le crépuscule tombe, au loin les chiens aboient, les gens allument la lumière. Les maisons, les encadrements, les fenêtres. Dans une fenêtre, un géranium rouge, dans une autre la faible lumière d’une lampe et une mélodie à peine audible, dans la suivante le bruit de la vaisselle, quelqu’un dîne, et dans une autre, l’obscurité totale, car les propriétaires ont quitté la maison pour toujours. Et dans chaque fenêtre, une histoire unique, comme ces encadrements qui entourent ces fenêtres. Une simple magie domestique.Ainsi est née la série infinie des «Magique encadrement de fenêtre», à l’intérieur desquels je place désormais non plus des scènes domestiques, mais mes symboles personnels.
Le projet a sa propre morphologie ou un certain ensemble d’attributs et d’éléments récurrents. À la base – un vieil encadrement, trouvé ou racheté, souvent sauvé du sort de brûler dans le poêle au lieu du bois. À l’intérieur de l’encadrement, des rideaux en velours, qui incarnent la présence de quelque chose de magique dans chaque œuvre. Au centre de l’encadrement – un objet sacré,
qu’il s’agisse d’une larme, symbole de la douleur, ou d’un oiseau, symbole de l’espoir.
Une théorie suggère que l’origine des symboles ornant les encadrements de fenêtres remonte au paganisme. La partie supérieure symbolise le monde céleste, la partie médiane – notre monde, et la partie inférieure – le monde souterrain, inconnu.
Mais le projet «Magique encadrement de fenêtre» n’a pas commencé par l’étude de la symbolique de l’architecture en bois russe, il a commencé par une image brumeuse, un souvenir d’enfance qui a laissé une empreinte indélébile dans ma conscience.
La route principale et presque unique du village, des maisons en bois de chaque côté, à gauche les champs dans le brouillard, à droite le murmure mystérieux de la forêt. Partout l’odeur du bain inondé, le crépuscule tombe, au loin les chiens aboient, les gens allument la lumière. Les maisons, les encadrements, les fenêtres. Dans une fenêtre, un géranium rouge, dans une autre la faible lumière d’une lampe et une mélodie à peine audible, dans la suivante le bruit de la vaisselle, quelqu’un dîne, et dans une autre, l’obscurité totale, car les propriétaires ont quitté la maison pour toujours. Et dans chaque fenêtre, une histoire unique, comme ces encadrements qui entourent ces fenêtres. Une simple magie domestique.Ainsi est née la série infinie des «Magique encadrement de fenêtre», à l’intérieur desquels je place désormais non plus des scènes domestiques, mais mes symboles personnels.
Le projet a sa propre morphologie ou un certain ensemble d’attributs et d’éléments récurrents. À la base – un vieil encadrement, trouvé ou racheté, souvent sauvé du sort de brûler dans le poêle au lieu du bois. À l’intérieur de l’encadrement, des rideaux en velours, qui incarnent la présence de quelque chose de magique dans chaque œuvre. Au centre de l’encadrement – un objet sacré,
qu’il s’agisse d’une larme, symbole de la douleur, ou d’un oiseau, symbole de l’espoir.
C’est une œuvre dédiée à ma grand-mère maternelle, qui a joué un rôle important dans la formation de ma personnalité, bien que le temps passé à ses côtés ait été très court.
J’ai passé mes premières années en étroite relation avec elle, elle m’a beaucoup appris, ses histoires fantastiques qu’elle racontait avant de dormir sont restées à jamais gravées dans mon imagination.
Puisque les souvenirs les plus vifs liés à elle remontent à mon enfance, avec le temps ils se sont enveloppés de quelque chose de mystique et de fantastique. Par exemple, j’ai une association assez claire avec son image — une vache noire céleste.
Je sais d’où cela vient : tout cela à cause de son immense manteau noir. Quand il neigeait dehors, elle ressemblait à la nuit, et les flocons sur son manteau semblaient des étoiles.
Elle me paraissait si grande, mais c’est parce que j’étais petite. Je tends souvent à idéaliser son image et notre relation, je fantasme sur le fait que si elle était encore vivante, elle serait sûrement l’une des héroïnes principales de mes œuvres et ma complice dans le monde de l’art.
Je m’imagine constamment la filmer avec mes masques, et au début elle ne comprendrait pas ce que c’est, puis elle s’y attacherait, comme maman.
Je me permets d’exagérer son importance dans ma vie, de la romantiser, parce que j’en ai besoin.
C’est une image sacrée, basée sur une personne réelle.
Je fais d’elle ma déesse personnelle, car je veux garder en mémoire quelque chose qui, avec le temps, a commencé à s’échapper, à s’oublier. Regarder ses photos ne suffit pas, car elles ne transmettent pas les sentiments que j’éprouvais pour elle.
Dans cette œuvre est capturé un autre portrait métaphorique de ma grand-mère Galia. Dans son ventre — le souvenir le plus vif d’elle.
J’avais environ 4, peut-être 5 ans. Quand, après minuit, elle m’a emmenée avec ma sœur glisser sur la route du village glacée.
Je courais et glissais droit vers elle, je heurtai son ventre doux, je tombais, je riais, et quoi de mieux que cela cette nuit-là ?
Cette nuit-là, elle m’arrêta et dit: «Regarde le ciel, vois-tu ce point brillant là-bas ? C’est Vénus.»
Un soir ordinaire, une simple glissade sur la glace, mais ce jour-là, je m’en souviens souvent comme d’un des plus poétiques de ma vie.
J’ai passé mes premières années en étroite relation avec elle, elle m’a beaucoup appris, ses histoires fantastiques qu’elle racontait avant de dormir sont restées à jamais gravées dans mon imagination.
Puisque les souvenirs les plus vifs liés à elle remontent à mon enfance, avec le temps ils se sont enveloppés de quelque chose de mystique et de fantastique. Par exemple, j’ai une association assez claire avec son image — une vache noire céleste.
Je sais d’où cela vient : tout cela à cause de son immense manteau noir. Quand il neigeait dehors, elle ressemblait à la nuit, et les flocons sur son manteau semblaient des étoiles.
Elle me paraissait si grande, mais c’est parce que j’étais petite. Je tends souvent à idéaliser son image et notre relation, je fantasme sur le fait que si elle était encore vivante, elle serait sûrement l’une des héroïnes principales de mes œuvres et ma complice dans le monde de l’art.
Je m’imagine constamment la filmer avec mes masques, et au début elle ne comprendrait pas ce que c’est, puis elle s’y attacherait, comme maman.
Je me permets d’exagérer son importance dans ma vie, de la romantiser, parce que j’en ai besoin.
C’est une image sacrée, basée sur une personne réelle.
Je fais d’elle ma déesse personnelle, car je veux garder en mémoire quelque chose qui, avec le temps, a commencé à s’échapper, à s’oublier. Regarder ses photos ne suffit pas, car elles ne transmettent pas les sentiments que j’éprouvais pour elle.
Dans cette œuvre est capturé un autre portrait métaphorique de ma grand-mère Galia. Dans son ventre — le souvenir le plus vif d’elle.
J’avais environ 4, peut-être 5 ans. Quand, après minuit, elle m’a emmenée avec ma sœur glisser sur la route du village glacée.
Je courais et glissais droit vers elle, je heurtai son ventre doux, je tombais, je riais, et quoi de mieux que cela cette nuit-là ?
Cette nuit-là, elle m’arrêta et dit: «Regarde le ciel, vois-tu ce point brillant là-bas ? C’est Vénus.»
Un soir ordinaire, une simple glissade sur la glace, mais ce jour-là, je m’en souviens souvent comme d’un des plus poétiques de ma vie.
Dans le projet «Le russe étranger», je parle de mes sensations dans le contexte d’un pays tout entier: je m’inscris dans ses paysages, je me prête aux images de déesses païennes tout en me sentant, en même temps, petite face à l’immensité de son histoire et de sa culture. L’image du projet voyage entre le monde des photomontages numériques et de la vidéo artistique, les masques textiles et les installations totales. «Le russe étranger» n’est pas seulement le titre du projet, c’est aussi mon état d’être.
La première œuvre de la série est née en 2017, après mon retour d’une expédition dans le village de Yakchina, où je suis née. En triant des photographies, j’ai découvert une image saisissante où je cours dans un champ avec un chien. J’y ai ajouté mon visage masqué – un grand visage qui s’élève comme un soleil à l’horizon. Cette image est devenue le point de départ du projet. Par la suite, j’ai créé une série entière de collages similaires, et tous les masques que j’ai utilisés sont devenus partie intégrante de ce projet-état.
En intégrant mes œuvres au paysage, j’ai toujours voulu les transposer dans la réalité. C’est ainsi qu’est née l’idée d’un projet d’exposition embrassant tout le village, qui «donnerait vie» à mes collages. En 2019, j’ai inauguré à Yakchina l’exposition «Le russe étranger», disposant mes œuvres dans tout le village, sans toutefois perturber la vie des habitants.
Lors du vernissage, j’ai guidé une visite sans parler des œuvres, uniquement de ma vie et de celle du village. Ainsi, les objets ne ressemblaient pas à des artefacts dénués d’âme, ils sont devenus partie du paysage, se sont fondus en lui, et avec les spectateurs, j’ai enfin pénétré dans mes collages.
La première œuvre de la série est née en 2017, après mon retour d’une expédition dans le village de Yakchina, où je suis née. En triant des photographies, j’ai découvert une image saisissante où je cours dans un champ avec un chien. J’y ai ajouté mon visage masqué – un grand visage qui s’élève comme un soleil à l’horizon. Cette image est devenue le point de départ du projet. Par la suite, j’ai créé une série entière de collages similaires, et tous les masques que j’ai utilisés sont devenus partie intégrante de ce projet-état.
En intégrant mes œuvres au paysage, j’ai toujours voulu les transposer dans la réalité. C’est ainsi qu’est née l’idée d’un projet d’exposition embrassant tout le village, qui «donnerait vie» à mes collages. En 2019, j’ai inauguré à Yakchina l’exposition «Le russe étranger», disposant mes œuvres dans tout le village, sans toutefois perturber la vie des habitants.
Lors du vernissage, j’ai guidé une visite sans parler des œuvres, uniquement de ma vie et de celle du village. Ainsi, les objets ne ressemblaient pas à des artefacts dénués d’âme, ils sont devenus partie du paysage, se sont fondus en lui, et avec les spectateurs, j’ai enfin pénétré dans mes collages.
Dans le projet «Petite-fille de Tamerlan», j'explore la culture bachkire, la tisse avec l'Oural et mon histoire personnelle.
Dans ma famille, il y a une figure mystérieuse — mon grand-père du côté paternel.
Son nom et son origine sont restés longtemps inconnus. Ma grand-mère ne voulait raconter à personne qui il était.
Alors, dans mon enfance, j’ai beaucoup fantasmé à ce sujet.
Un jour, j’ai vu dans un livre un portrait dessiné de Tamerlan, et il m’a semblé très ressemblant à mon père. De là est née la fantaisie que je sois la petite-fille de Tamerlan.
Un an avant sa mort, ma grand-mère a levé le secret.
J’ai enfin découvert mon vrai nom de famille — Gazizova (le nom de famille Gorshenina m’a été transmis par le beau-père de mon père, qui n’est pas un parent de sang) — et j’ai retrouvé mes racines dans une petite ville bachkire, Touïmazy.
Nous n’avons jamais réussi à établir des liens chaleureux avec ce nouveau parent retrouvé, mais pour moi, l’essentiel dans cette histoire était de connaître mes racines.
Dans ma famille, il y a une figure mystérieuse — mon grand-père du côté paternel.
Son nom et son origine sont restés longtemps inconnus. Ma grand-mère ne voulait raconter à personne qui il était.
Alors, dans mon enfance, j’ai beaucoup fantasmé à ce sujet.
Un jour, j’ai vu dans un livre un portrait dessiné de Tamerlan, et il m’a semblé très ressemblant à mon père. De là est née la fantaisie que je sois la petite-fille de Tamerlan.
Un an avant sa mort, ma grand-mère a levé le secret.
J’ai enfin découvert mon vrai nom de famille — Gazizova (le nom de famille Gorshenina m’a été transmis par le beau-père de mon père, qui n’est pas un parent de sang) — et j’ai retrouvé mes racines dans une petite ville bachkire, Touïmazy.
Nous n’avons jamais réussi à établir des liens chaleureux avec ce nouveau parent retrouvé, mais pour moi, l’essentiel dans cette histoire était de connaître mes racines.
C’est un projet pseudo-scientifique, rempli de nombreuses rêveries personnelles.
Je me réfère à une époque très ancienne, lorsque l’Oural, la République de Komi et le Bachkortostan étaient recouverts par les eaux de l’océan Ouralien autrefois existant.
J’ai découvert il y a quelques années que je marchais sur un fond marin. Ce fait m’a profondément frappée, et j’ai commencé à imaginer mentalement des coraux et des récifs autour de moi, à me glisser dans la peau d’êtres anciens. En 2020, je suis partie au Bachkortostan, vers les célèbres chikhans, qui sont une preuve vivante que l’océan a vraiment existé. Je me souviens être montée au sommet du chikhan Trataou, où j’ai découvert sous mes pieds de nombreuses empreintes d’êtres marins et des coraux fossilisés. Dans le paysage actuel, où ne se trouvent autour du chikhan que forêts et champs, cette image semblait magique.
Après recherches, j’ai appris que la République de Komi, du point de vue géographique, faisait aussi partie de cet océan.
Le projet se compose de différentes parties, notamment une série d’illustrations où je me relie à des créatures anciennes, vues à l’Institut géologique de Komi. On peut observer des images similaires dans des moulages en plâtre. J’ai scellé mon image sous la forme d’artefacts anciens.
Lors de mon expédition vers les sites locaux, je cherchais avant tout des indices paysagers visuels et des traces du passé marin de cette région, qui pourraient faire partie de mon projet. Mais au cours du voyage et de l’étude de l’histoire de Komi, j’ai découvert un autre thème intéressant, qui a donné naissance à une série supplémentaire intitulée «Là où vivent les Komi, jadis vivait la Tchoud».
À la Galerie Nationale de Komi, on m’a raconté l’histoire d’un peuple ancien, la «Tchoud», qui vivait ici autrefois. Ils étaient païens, et lorsque le christianisme est arrivé dans ces contrées, ils se sont volontairement retirés sous terre pour préserver leur foi.
J’ai été impressionnée par une partie de la série «Création du monde. Mythologie du peuple Komi» de l’artiste Arkadi Moshiev, dédiée à la tragédie du peuple tchoud. J’ai aimé la manière dont il a représenté leur image — des silhouettes blanches voilées et sans visage, se dissolvant dans le paysage local.
Lors de mon voyage dans le parc national Yougyd Va, j’ai endossé l’image de cette «Tchoud» même, et créé ma propre interprétation.
Je me réfère à une époque très ancienne, lorsque l’Oural, la République de Komi et le Bachkortostan étaient recouverts par les eaux de l’océan Ouralien autrefois existant.
J’ai découvert il y a quelques années que je marchais sur un fond marin. Ce fait m’a profondément frappée, et j’ai commencé à imaginer mentalement des coraux et des récifs autour de moi, à me glisser dans la peau d’êtres anciens. En 2020, je suis partie au Bachkortostan, vers les célèbres chikhans, qui sont une preuve vivante que l’océan a vraiment existé. Je me souviens être montée au sommet du chikhan Trataou, où j’ai découvert sous mes pieds de nombreuses empreintes d’êtres marins et des coraux fossilisés. Dans le paysage actuel, où ne se trouvent autour du chikhan que forêts et champs, cette image semblait magique.
Après recherches, j’ai appris que la République de Komi, du point de vue géographique, faisait aussi partie de cet océan.
Le projet se compose de différentes parties, notamment une série d’illustrations où je me relie à des créatures anciennes, vues à l’Institut géologique de Komi. On peut observer des images similaires dans des moulages en plâtre. J’ai scellé mon image sous la forme d’artefacts anciens.
Lors de mon expédition vers les sites locaux, je cherchais avant tout des indices paysagers visuels et des traces du passé marin de cette région, qui pourraient faire partie de mon projet. Mais au cours du voyage et de l’étude de l’histoire de Komi, j’ai découvert un autre thème intéressant, qui a donné naissance à une série supplémentaire intitulée «Là où vivent les Komi, jadis vivait la Tchoud».
À la Galerie Nationale de Komi, on m’a raconté l’histoire d’un peuple ancien, la «Tchoud», qui vivait ici autrefois. Ils étaient païens, et lorsque le christianisme est arrivé dans ces contrées, ils se sont volontairement retirés sous terre pour préserver leur foi.
J’ai été impressionnée par une partie de la série «Création du monde. Mythologie du peuple Komi» de l’artiste Arkadi Moshiev, dédiée à la tragédie du peuple tchoud. J’ai aimé la manière dont il a représenté leur image — des silhouettes blanches voilées et sans visage, se dissolvant dans le paysage local.
Lors de mon voyage dans le parc national Yougyd Va, j’ai endossé l’image de cette «Tchoud» même, et créé ma propre interprétation.
samoiskusstvlenie est un mot inventé, un terme intime qui unit l’art et la créatrice en une seule essence. Je nourris un lien profond, presque sacré, avec mes œuvres — mes masques et costumes ne sont portés que par moi-même.
Pour moi, il est essentiel que mes créations soient le reflet direct de mon être, que le regard porté sur elles perçoive ma présence au cœur de cet univers que je façonne.
Je souhaite révéler au monde qu’il existe un espace privé, intime, hors de portée de l’usage commun. Ce projet célèbre un art porté, une seconde peau que je crée pour moi-même, et invite chacun à méditer sur les frontières de l’autre, sur ce que l’art peut être — parfois un langage secret, un territoire profondément personnel
Pour moi, il est essentiel que mes créations soient le reflet direct de mon être, que le regard porté sur elles perçoive ma présence au cœur de cet univers que je façonne.
Je souhaite révéler au monde qu’il existe un espace privé, intime, hors de portée de l’usage commun. Ce projet célèbre un art porté, une seconde peau que je crée pour moi-même, et invite chacun à méditer sur les frontières de l’autre, sur ce que l’art peut être — parfois un langage secret, un territoire profondément personnel
Je suis née dans un village, et pendant les premières années de ma vie, cet endroit était tout mon univers. Je ne savais pas ce qui se trouvait au-delà, j’entendais des récits sur les grandes villes et je ne pouvais que les imaginer jusqu’au jour où je suis sortie de ces limites. C’est un très petit coin de terre, avec une route principale et quelques rues secondaires. Autour, le village est entouré de forêts infinies, de champs et d’autres petits hameaux similaires. Dans mon enfance, cet endroit ne me semblait pas petit, il apparaissait comme infini, immense. C’est moi-même qui ai créé cette sensation, grâce à mes fantasmes et à mon imagination d’enfant.
Huarealism est un projet sur l’ampleur intérieure. J’y voyage à travers des paysages sans fin de ma conscience, en jouant avec elle.
«Voilà, je me divise en sept Alice égales et je danse la ronde avec moi-même. Voilà, je m’agrandis jusqu’à la taille de la plus haute montagne de l’Oural et je m’allonge dans la forêt comme dans l’herbe. Voilà, je suis un vaisseau spatial capable d’aller n’importe où, de traverser toutes les univers. Je choisis celui dont la couleur me plaît, je cherche la meilleure planète et je prends toutes les étoiles de son ciel, je les mets dans ma poche, et à la place, je place mon propre soleil dans le firmament, je viens juste de le coudre hier. Maintenant j’ai ma propre planète, car c’est là que se trouve mon astre. Voilà, je deviens une poupée de chiffon à six bras, je tiens sur une étagère et je comprends ce que c’est que d’être un objet créé par l’homme. Voilà, je dessine une queue de sirène sur une photo d’été, et aussitôt je me retrouve dans la mer, coupant les vagues comme un poisson. Voilà, dans un élan de danse, je me décompose jusqu’aux atomes et je deviens la musique elle-même. Voilà, je suis allongée sur la Lune, je regarde la Terre et je me demande ce que font les gens là-bas en ce moment?»
Huarealism est un univers personnel que je construis autour de moi depuis de nombreuses années. Il n’a pas peur des catastrophes, des épidémies, ni d’autres phénomènes apocalyptiques du monde extérieur. Il est sous ma protection, je suis l’architecte principale qui décide s’il doit y avoir tempête ou calme, violer les lois de la physique ou non, modeler la réalité à sa guise ou s’y intégrer. C’est un monde où il y a toujours une place pour moi, où tout fonctionne selon mes règles.
*Le nom est un jeu de mots, une combinaison de mon pseudonyme–Alice Hualice–and d’un «-isme», à la manière du surréalisme, du dadaïsme et d’autres mouvements artistiques.
Huarealism est un projet sur l’ampleur intérieure. J’y voyage à travers des paysages sans fin de ma conscience, en jouant avec elle.
«Voilà, je me divise en sept Alice égales et je danse la ronde avec moi-même. Voilà, je m’agrandis jusqu’à la taille de la plus haute montagne de l’Oural et je m’allonge dans la forêt comme dans l’herbe. Voilà, je suis un vaisseau spatial capable d’aller n’importe où, de traverser toutes les univers. Je choisis celui dont la couleur me plaît, je cherche la meilleure planète et je prends toutes les étoiles de son ciel, je les mets dans ma poche, et à la place, je place mon propre soleil dans le firmament, je viens juste de le coudre hier. Maintenant j’ai ma propre planète, car c’est là que se trouve mon astre. Voilà, je deviens une poupée de chiffon à six bras, je tiens sur une étagère et je comprends ce que c’est que d’être un objet créé par l’homme. Voilà, je dessine une queue de sirène sur une photo d’été, et aussitôt je me retrouve dans la mer, coupant les vagues comme un poisson. Voilà, dans un élan de danse, je me décompose jusqu’aux atomes et je deviens la musique elle-même. Voilà, je suis allongée sur la Lune, je regarde la Terre et je me demande ce que font les gens là-bas en ce moment?»
Huarealism est un univers personnel que je construis autour de moi depuis de nombreuses années. Il n’a pas peur des catastrophes, des épidémies, ni d’autres phénomènes apocalyptiques du monde extérieur. Il est sous ma protection, je suis l’architecte principale qui décide s’il doit y avoir tempête ou calme, violer les lois de la physique ou non, modeler la réalité à sa guise ou s’y intégrer. C’est un monde où il y a toujours une place pour moi, où tout fonctionne selon mes règles.
*Le nom est un jeu de mots, une combinaison de mon pseudonyme–Alice Hualice–and d’un «-isme», à la manière du surréalisme, du dadaïsme et d’autres mouvements artistiques.
Le projet repose sur des notes extraites d’un carnet de voyage, collectées et consignées lors d’un périple à travers le Nord russe dans le cadre d’une résidence artistique au Centre d’art contemporain ARKA (Arkhangelsk).
*description sous la photo.
*description sous la photo.
Le projet est dédié à mes interactions avec ma famille.
Je ne laisse personne essayer mes œuvres textiles – masques et costumes – à l’exception des membres de ma famille et de mes proches ami·es. Depuis 2017, j’ai commencé à impliquer peu à peu mes parents, puis d’autres membres de la famille dans ce que je fais, en leur demandant de poser pour différentes séances photo. Avec le temps, cela m’a semblé former un projet à part entière. Pendant les prises de vue, j’observais leurs comportements. Ma mère est toujours la première à répondre, elle met tout ce qu’on lui propose et manifeste un intérêt sincère. Mon père râle d’abord, mais une fois le moment venu d’essayer, il choisit soigneusement une tenue qui lui convient, puis il interagit avec les œuvres et les adapte toujours à lui-même – par exemple, il met des lunettes par-dessus le masque ou ajoute un bonnet, puis complète le tout avec des gestes qui donnent du caractère. Ma sœur préfère les œuvres qui ne couvrent pas le visage, et mes neveux et nièces, bien qu’ils prennent tout cela comme un jeu, montrent du respect pour les œuvres et interagissent avec elles avec délicatesse. Le processus de création des images reposait toujours sur une communication active entre les œuvres et les personnes.
En 2020, notre première exposition familiale a eu lieu à la galerie La Nouvelle Sincérité à Moscou. En plus des œuvres communes, l’exposition présentait également des projets personnels de mes parents, de mes neveux et nièces, ainsi que de ma grande sœur. On me demande souvent comment ma famille perçoit ce que je fais – cette exposition, intitulée IGO, en est une réponse. Je ne voulais pas idéaliser nos relations – nous avons rencontré de nombreuses difficultés. Avec cette exposition, nous avons essayé de montrer que notre acceptation mutuelle est un processus en cours, qui n’a pas encore trouvé son point d’aboutissement. Ce projet est notre co-création, qui nous aide à apprendre à aller les un·es vers les autres.
Je ne laisse personne essayer mes œuvres textiles – masques et costumes – à l’exception des membres de ma famille et de mes proches ami·es. Depuis 2017, j’ai commencé à impliquer peu à peu mes parents, puis d’autres membres de la famille dans ce que je fais, en leur demandant de poser pour différentes séances photo. Avec le temps, cela m’a semblé former un projet à part entière. Pendant les prises de vue, j’observais leurs comportements. Ma mère est toujours la première à répondre, elle met tout ce qu’on lui propose et manifeste un intérêt sincère. Mon père râle d’abord, mais une fois le moment venu d’essayer, il choisit soigneusement une tenue qui lui convient, puis il interagit avec les œuvres et les adapte toujours à lui-même – par exemple, il met des lunettes par-dessus le masque ou ajoute un bonnet, puis complète le tout avec des gestes qui donnent du caractère. Ma sœur préfère les œuvres qui ne couvrent pas le visage, et mes neveux et nièces, bien qu’ils prennent tout cela comme un jeu, montrent du respect pour les œuvres et interagissent avec elles avec délicatesse. Le processus de création des images reposait toujours sur une communication active entre les œuvres et les personnes.
En 2020, notre première exposition familiale a eu lieu à la galerie La Nouvelle Sincérité à Moscou. En plus des œuvres communes, l’exposition présentait également des projets personnels de mes parents, de mes neveux et nièces, ainsi que de ma grande sœur. On me demande souvent comment ma famille perçoit ce que je fais – cette exposition, intitulée IGO, en est une réponse. Je ne voulais pas idéaliser nos relations – nous avons rencontré de nombreuses difficultés. Avec cette exposition, nous avons essayé de montrer que notre acceptation mutuelle est un processus en cours, qui n’a pas encore trouvé son point d’aboutissement. Ce projet est notre co-création, qui nous aide à apprendre à aller les un·es vers les autres.
Projet réalisé en 2018 dans le cadre d’une résidence artistique textile en Norvège, à la ferme Sondre Green.
Pendant un mois, j’ai vécu et travaillé en Norvège — ma toute première expérience de résidence. L’objectif principal était de comprendre à quel point le lieu dans lequel je travaille habituellement, c’est-à-dire l’Oural, influence ma pratique et mes œuvres. Dans cette atmosphère inhabituelle, entourée de personnes ne parlant pas ma langue, la seule chose familière restait ce que je créais. Il était donc essentiel pour moi d’entrer rapidement en contact avec le territoire.
Mes premières œuvres — des photographies où je m’intègre dans les paysages de la résidence — m’ont aidée à m’adapter, tandis que des artefacts apportés de l’Oural me rappelaient la maison. Peu à peu, j’ai cherché à me fondre dans l’espace : j’ai installé mes travaux dans l’atelier et à l’extérieur, comme une araignée tissant sa toile. Les matériaux étaient glanés dans les environs — feutre d’une écurie abandonnée, branches tombées dans la forêt, vieux objets trouvés chez l’hôtesse de la résidence.
Au-delà de l’exploration du lieu, une autre question s’est imposée : celle du langage artistique. Mon anglais était très limité, personne ne comprenait le russe. Mes pensées circulaient entre l’anglais, le russe et le norvégien. Pourtant, malgré les barrières linguistiques, j’ai eu le sentiment que mes œuvres étaient comprises. C’est ainsi que j’ai pleinement ressenti la puissance du langage de l’art — capable d’exprimer, sans un mot, parfois bien plus que des mots ne pourraient le faire.
Pendant un mois, j’ai vécu et travaillé en Norvège — ma toute première expérience de résidence. L’objectif principal était de comprendre à quel point le lieu dans lequel je travaille habituellement, c’est-à-dire l’Oural, influence ma pratique et mes œuvres. Dans cette atmosphère inhabituelle, entourée de personnes ne parlant pas ma langue, la seule chose familière restait ce que je créais. Il était donc essentiel pour moi d’entrer rapidement en contact avec le territoire.
Mes premières œuvres — des photographies où je m’intègre dans les paysages de la résidence — m’ont aidée à m’adapter, tandis que des artefacts apportés de l’Oural me rappelaient la maison. Peu à peu, j’ai cherché à me fondre dans l’espace : j’ai installé mes travaux dans l’atelier et à l’extérieur, comme une araignée tissant sa toile. Les matériaux étaient glanés dans les environs — feutre d’une écurie abandonnée, branches tombées dans la forêt, vieux objets trouvés chez l’hôtesse de la résidence.
Au-delà de l’exploration du lieu, une autre question s’est imposée : celle du langage artistique. Mon anglais était très limité, personne ne comprenait le russe. Mes pensées circulaient entre l’anglais, le russe et le norvégien. Pourtant, malgré les barrières linguistiques, j’ai eu le sentiment que mes œuvres étaient comprises. C’est ainsi que j’ai pleinement ressenti la puissance du langage de l’art — capable d’exprimer, sans un mot, parfois bien plus que des mots ne pourraient le faire.
© Alice Hualice, 2025